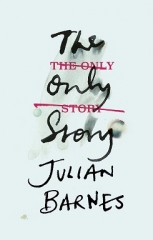Après avoir lu « Les brumes silencieuses de Tobias Spierenburg » par Gwennaëlle Gribaumont dans La Libre Arts du 4 mars dernier, où elle présente l’exposition en cours à la galerie Albert Ier, j’ai immédiatement cherché le site de cette galerie bruxelloise et j’y ai découvert un univers pictural très attirant. Un catalogue reçu m’avait un jour fait visiter une expo de loin, une critique le peut aussi.

© Tobias Spierenburg, Roseaux II, huile sur toile, 80 x 200 cm.
Né en 1977, d’une famille de peintres, cet artiste néerlandais à première vue paysagiste « déploie une peinture de l’effacement où l’arbre, dépouillé d’horizon, devient pure vibration. » (Citations tirées de l’article et du site de la galerie). Après l’immersion dans le paysage, où il prend parfois quelques photographies, c’est plus tard, dans l’atelier, que le souvenir fait naître la toile : « En peignant, j’essaie tout d’abord de rapprocher l’ambiance de ce souvenir le plus nettement possible, jusqu’à ce que l’image devienne diffuse, qu’il ne reste que de la lumière, et que je sois amené à chercher une autre harmonie de couleurs. »
« […] et je peins couche après couche afin d’obtenir une profondeur indéfinissable, pour me rendre compte que ce que je peins, c’est mon état d’âme du moment. » Sensation de flottement, apesanteur, flou – « une esthétique de la disparition », écrit la critique, et aussi un appel à la contemplation, au calme, voire à la méditation. Ces jours-ci, le brouillard matinal nous y invite aussi, en ville.
On peut lire sur le site de la galerie plusieurs textes de Tobias Spierenburg, artiste qui paraît « indifférent aux modes et aux prescriptions du marché ». Le peintre y parle de ses influences, de son art. Il peint aussi des dunes, des nuages. « Souvent, il faut tout un chemin pour accéder à une harmonie naturelle. J’emploie beaucoup de couches transparentes de peinture pour arriver à des couleurs plus subtiles. Ainsi je prends le temps de donner un caractère travaillé à mes peintures dans lesquelles j’essaie de créer des atmosphères poétiques, simples et silencieuses ».

© Tobias Spierenburg, Vallée I, huile sur toile, 92 x 65 cm
Le site de la galerie Albert Ier offre de nombreuses illustrations. Sur celui de la galerie Jamault qui le représente en France, Tobias Spierenburg parle de son travail dans une petite vidéo. « Ses œuvres nous livrent un antidote à la saturation du monde, nous offrant la beauté de l’imperceptible, ce qui n’apparaît qu’à ceux qui acceptent de ralentir », écrit Gwennaëlle Gribaumont.
Exposition Tobias Spierenburg, Galerie Albert Ier, Bruxelles > 05.04.2026