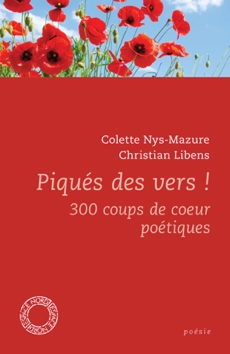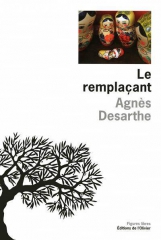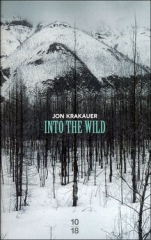« Chez nous, écrit Agnès Desarthe, ce qui permet de sortir du lot, c’est la façon de raconter des histoires. » Le remplaçant (2006) raconte celle du grand-père Bousia (Bouse, Bouz) qui s’appelait en réalité Boris et aussi Baruch, bref, « B.B.B. » ou « triple B » – « Mais peut-être ferais-je mieux de commencer par expliquer que mon grand-père n’est pas mon grand-père. »

Après que le père de sa mère « a été tué à Auschwitz en 1942 », sa grand-mère maternelle a décidé de vivre avec un de leurs amis, devenu veuf de la même façon : « Triple B avait le bon goût de n’être pas à la hauteur du disparu ; ni aussi beau, ni aussi intelligent, ni aussi poétique que le mort qu’il remplaçait. » D’où cette atmosphère amicale que ressentait chez eux leur petite-fille, sans « la malédiction de la conjugalité ».
Ces choses étant dites (ce n’est pas une autobiographie), ne vous méprenez pas sur le ton de ce récit court (moins de cent pages) où la narratrice égrène avec délicatesse le collier des souvenirs du grand-père à la Peugeot 204 vert bouteille, de la même façon qu’elle aimait, fillette, retrouver les « objets typiques » chez ses grands-parents : petit vase en Vallauris, décapsuleur-guitare, service à thé chinois en porcelaine ultrafine, poupée chauffe-théière à la jupe matelassée – une « princesse russe », jeune fille et non matrone, « bref, mon modèle ».
C’est le portrait d’un artisan peu doué, d’un papi qui a reçu des électrochocs pour le guérir d’une dépression – sa mère lui en dira plus long un jour, à elle qui a du mal à retenir : « Un mélange de distraction, de propension à la rêverie, de manque d’esprit de synthèse et d’absence de mémoire fait que je suis incapable de fixer l’information, à la manière de certains organismes qui ne parviennent pas à fixer le magnésium. Je ne comprends jamais ce qu’on me dit. Je comprends autre chose. Il me faut des images, il me faut des métaphores. »
Quand elle écrit son récit, son grand-père, 96 ans, est alité dans une tour du treizième arrondissement à Paris, endormi la plupart du temps. Triple B lui a toujours raconté des histoires, mais elle n’y prêtait pas toujours assez d’attention. « J’aimais l’idée de pouvoir être sa petite-fille, alors que ma mère n’était pas sa fille, comme s’il avait été permis de sauter une case. » Il lui avait confié qu’à Kichiniev, en Bessarabie, il avait appris à sculpter la pierre, à graver des noms sur des tombes, mais qu’au lieu de devenir sculpteur, il était devenu communiste.
Parfois il parlait roumain, yiddish, mais toujours français en présence de ses petits-enfants. Il avait ses expressions favorites : « tout ce qu’il y a de… », « fameux », « pas fameux », « bernique » ou encore « Silence, la queue du chat balance »... Il parlait à sa petite-fille de son frère Refoul, très pauvre ; de son cousin Léon, qui « a crevé la faim » en Belgique avant d’être expulsé, essayant en vain de retourner en Bessarabie. « Les histoires racontées par triple B sont rapides et elliptiques. On saute d’une époque à l’autre comme à l’aide d’un projecteur de diapositives. »
L’intérieur des grands-parents était plus moderne que celui de ses parents : couteau électrique, ventilateur, « placard intégré qui avait tout d’une caverne d’Ali Baba », ascenseur à miroir et rampes en aluminium. Dans la tour de triple B, beaucoup de ses amis s’étaient installés, on lisait sur les boîtes aux lettres « de plus en plus de noms imprononçables, bourrés de consonnes qui se télescopaient. »
Le remplaçant raconte – raconte ou invente, peu importe ici – l’histoire d’une vie, avec ses détours et ses surprises, ses drôleries et ses larmes. Agnès Desarthe a écrit cette « fiction » sur son grand-père au lieu du livre qu’elle projetait de consacrer à un pédagogue polonais, mais elle arrivera à établir un lien, vous pouvez compter sur la conteuse qui sait que « l’enchantement ne doit pas jaillir de la chute, mais plutôt agir tout au long de la narration ».