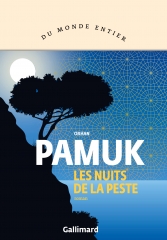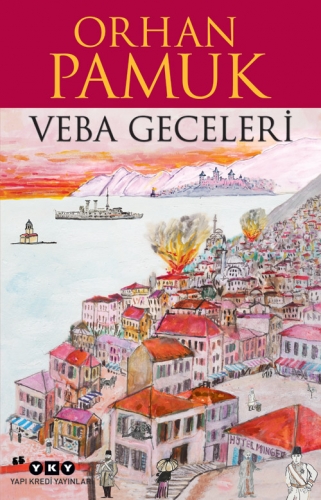Le dernier roman d’Orhan Pamuk, Les nuits de la peste (Veba Geceleri, 2021, traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes, 2022) nous emmène sur l’île méditerranéenne de Mingher, non loin de Rhodes. Une carte permet d’en situer les localités et aussi les quartiers d’Arkaz, à la pointe sud de l’île.
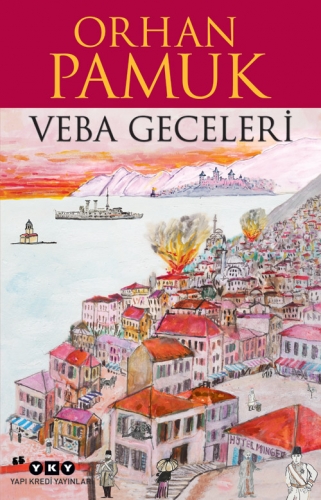
L’introduction de Mîna Mingherli annonce « un roman historique et une histoire en forme de roman ». Des recherches historiques sur l’épidémie de peste de 1901 et surtout l’étude des lettres écrites à sa sœur par la princesse sultane Pakizê, fille du sultan ottoman Mourad V (remplacé puis emprisonné par son frère Abdülhamid II) ont inspiré Les nuits de la peste – « L’art du roman repose sur le talent de raconter notre histoire comme si elle avait été vécue par d’autres, et l’histoire des autres comme si nous l’avions vécue », précise-t-elle.
Le soir du 22 avril 1901, un vapeur « non programmé » arrive à Arkaz : l’Aziziye, battant pavillon ottoman, parti d’Istanbul pour la Chine, avec à son bord une délégation de dix-sept personnes en mission pour le sultan. Parmi elles, sa nièce Pakizê et le Dr Nuri, un médecin sanitaire de trente-huit ans, qu’elle vient d’épouser – un couple heureux. L’inspecteur général, chimiste et pharmacien, Bonkowski Pacha, soixante ans, a embarqué à Smyrne, où l’épidémie de peste a été endiguée en six semaines. Il est chargé de contrôler la bonne application de la quarantaine sur l’île de Mingher.
On y compte déjà quinze morts dans les quartiers musulmans, moins respectueux des mesures que les quartiers grecs. « Accepter ces règles, c’est accepter de s’occidentaliser, et plus on va vers l’Orient, plus la chose se complique », confie l’inspecteur au médecin, qu’il appelle « mon pacha », un titre auquel le Dr Nuri n’est pas encore habitué.
De leurs cabines, les passagers admirent la Montagne Blanche, « surgissant tel un fantôme au milieu des ténèbres qui assiégeaient dans son dos la Forteresse d’Arkaz. » Au large du port sans débarcadère ni quai « dignes de ce nom », ils admirent ce paysage « énigmatique » au clair de lune, puis aperçoivent les chaloupes envoyées par le gouverneur de Mingher.
Celui-ci nie la présence de la peste sur l’île et ne veut pas informer la population comme le souhaitent les médecins sanitaires. Le gouverneur Sami Pacha place ceux-ci « sous protection » pour surveiller leurs agissements. L’assassinat de Bonkowski Pacha qui a réussi à échapper à la surveillance va entraîner un nouvel ordre de mission pour le Dr Nuri, appelé à le remplacer. Ils débarquent, accompagnés du major Kâmil, un « fils d’Arkaz », chargé de la sécurité de la princesse.
A l’évolution de la situation, catastrophique du fait du déni et des atermoiements, s’ajoutent l’enquête sur le crime commis et beaucoup d’autres ingrédients, médicaux, politiques, sociaux, religieux, historiques, en plus de la découverte d’une île chérie par ses habitants. Grâce à la confiance sans faille entre Pakizê et son mari, elle qui ne peut sortir de leur demeure, pas plus que du palais où elle vivait à Istanbul, se tient au courant des événements et en rend compte dans ses lettres à sa sœur, qui deviendront de précieuses archives. Elle avait promis de lui écrire « tout ce qu’elle verrait, entendrait et ressentirait durant son voyage ».
L’auteur mêle à l’action principale – l’épidémie, décrite avec beaucoup de réalisme dans tous ses aspects (maladie, quarantaine, rumeurs, conseils sanitaires, hôpitaux débordés, croyances, inhumations…) et avec toutes les difficultés (notamment pour que responsables et médecins s’accordent) – plusieurs relations amoureuses, des rivalités politiques et des abus de pouvoir, la censure, des règlements de comptes et même une révolution nationaliste.
Le roman d’Orhan Pamuk comporte de belles descriptions des paysages et de la nature sur l’île aux roses (l’eau de rose est une spécialité de Mingher). Les librairies y proposent des ouvrages en grec, en turc et en français, la langue minghérienne n’étant connue que des natifs de l’île. « Des années plus tard », le dernier chapitre des Nuits de la peste, résume la suite, une fois l’épidémie vaincue : le voyage en Chine, la destinée de Pakizê et de sa famille, le sort de l’île jusqu’à nos jours.
Ecrite avant l’épidémie de Covid-19, cette œuvre littéraire phénoménale et palpitante mêle fiction et histoire plus qu’on ne l’imagine, je ne vous en dis pas plus. « Cette fresque somptueuse signée du Prix Nobel 2006, qui évoque le basculement d’un monde, aux résonances très contemporaines, a le mérite d’exister quand l’agonie du monde ottoman, magnifique sujet s’il en est, est si peu traitée dans la littérature turque. » (Marc Semo, Le Monde des Livres)
 « Il sait tout ce qui se joue la première fois. Le premier pas. Les premiers mots. Ce qui s’inaugure et ce qui ne se dévoile pas. Tout est là, en même temps. Dans la première séance. Combien de fois est-il revenu à ses intuitions premières quand il n’y voyait plus clair. Aux fulgurances qu’on a quand on découvre la démarche, la façon de se poser sur le divan, de bouger les mains pendant la première séance ou de rester immobile. Les frémissements sur un visage. »
« Il sait tout ce qui se joue la première fois. Le premier pas. Les premiers mots. Ce qui s’inaugure et ce qui ne se dévoile pas. Tout est là, en même temps. Dans la première séance. Combien de fois est-il revenu à ses intuitions premières quand il n’y voyait plus clair. Aux fulgurances qu’on a quand on découvre la démarche, la façon de se poser sur le divan, de bouger les mains pendant la première séance ou de rester immobile. Les frémissements sur un visage. »