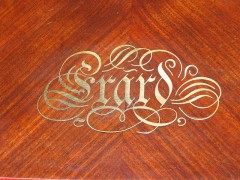Jean-Paul Kauffmann a évoqué, dans La maison du retour, la fusion entre un homme et une maison au milieu des pins. Courlande (2009) n’est pas vraiment un récit de voyage. Plutôt une exploration à la fois personnelle et historique. L’écrivain partage avec nous sa quête d’une vérité cachée dans un pays de la vieille Europe, à la manière d’un « puzzle ».

Kazdanga - Vues anciennes de Courlande © Andris Tomašūns, izstrādāja DSP
http://www.latvija20gadsimts.lv/apkopojums/pilsetas-un-vietas/kazdanga0/
« La Courlande appartient à ma propre histoire. Je suis parti à la recherche d’un nom. Je me suis lancé à la poursuite d’un souvenir. » Trente ans après, Kauffmann se souvient de « Mara du Canada », une beauté nordique rencontrée à Montréal, à vingt-deux ans. Il n’était pas le seul à tenter d’attirer son attention dans la librairie où elle travaillait. C’est l’achat d’une biographie de Louis XVIII qui déclenche la curiosité de la jeune femme : « C’est extraordinaire. Il a vécu chez moi. » (Louis XVIII s’était réfugié en Courlande.) Dès lors, Kauffmann n’aura de cesse de récolter des informations sur cette région.
Mara l’autorise à lui faire la cour. Canadienne anglophone (ses parents ont fui l’Allemagne à la fin de la deuxième guerre, puis ont émigré au Canada, l’occupation soviétique se prolongeant en Lettonie), elle lui fait remarquer que Le coup de grâce de Yourcenar se déroule dans un château de Courlande. Quand elle l’invite chez ses parents pour la fête de la Saint-Jean – « Cette célébration du solstice d’été est la plus grande manifestation lettonne » –, la mère de Mara et ses filles portent des couronnes de fleurs, « un spectacle rare » : « Que de beauté ce soir-là ! » Une semaine après, Mara devient sa maîtresse. Après avoir prolongé son séjour pour elle, il a fini par rentrer en France. Ils se sont promis de s’écrire, il rêvait qu’elle vienne l’y rejoindre.
Depuis lors, tout ce qui a trait à la Courlande s’imprime dans sa mémoire. Sa femme, Joëlle, le taquine à ce sujet, mais le jour où il lui annonce un reportage en Courlande, elle l’accompagne. Une lointaine cousine alsacienne lui a parlé de la « poche de Courlande » et de son père disparu là-bas en 45. Elle n’a jamais retrouvé sa tombe et insiste pour qu’il rencontre un Allemand qui repère des sépultures et identifie les morts, le « Résurrecteur ».
Dès sa descente d’avion à Riga, le doute le prend : « La Courlande, est-ce une bonne idée ? » Laissant sa femme découvrir l’art nouveau dans la capitale, il visite, à l’écart, un village reconstitué à la gloire du patrimoine letton. Déception. A sa femme qui l’interroge, il répond faute de mieux : « C’est le contraire de l’Italie » (pour lui, « une concentration unique du beau »).
Dans une Skoda Favorit rouge 1988, les voilà en route – « route sans ornements, paysage rectiligne de forêts ». Sa femme est plus enthousiaste que lui, trouve la forêt majestueuse, la lumière différente. A Liepaja, « l’ancienne Libau », premier rendez-vous manqué avec le Résurrecteur, mais une lectrice de français, qui a passé son temps libre à étudier le letton, lui montre le port, longtemps abandonné mais qui commence à redonner des signes de vie.
Le directeur du magazine, inquiet de ses réponses laconiques au téléphone, insiste pour qu’il aille visiter les châteaux des « barons baltes » dont il lui avait parlé. Kauffmann les connaît déjà un peu à travers les romans de Keyserling. Kazdanga sera leur premier château en Courlande – « La concision courlandaise contre la profusion italienne. Ce n’est pas tout à fait nous, mais le moule est le même. » Le parc est grandiose. A Laidi, d’autres visiteurs les ont précédés. Pas des Français, il les reconnaîtrait – « une manière froide d’être agité, quelque chose d’à la fois saccadé et contrôlé, une façon de bomber le torse et de prendre un air harassé. Il n’est pas donné à tout le monde d’avoir un style si contradictoire. »
Un homme, son épouse et leurs deux enfants, s’en vont dans une voiture immatriculée en Allemagne. Ils se revoient dans un « Flatotel postsoviétique », en pleine nuit, réveillés par les cris de la mère qui a besoin d’une aide urgente pour sa fille. Joëlle, médecin, soigne la petite. En remerciement, « le Professeur » les invite au restaurant. Dans une salle éclairée par la « belle lumière de juin », ils font connaissance. Cet homme d’une quarantaine d’années visite la Courlande pour la seconde fois. Il instruit de futurs designers, « des hommes concrets, créateurs de formes nouvelles ».
Au château de Pelci, où ils se sont donné rendez-vous, les attend un pique-nique d’une abondance étonnante dans ce pays où les magasins offrent un choix assez sommaire. La conversation du Professeur révèle une grande culture historique , « il a en outre cette qualité rare de ne pas chercher à imposer son point de vue. » Tout heureux de pouvoir conduire la Skoda, il les emmène au vignoble de Sabile, sur la « colline du vin ». Les villageois sont surpris de l’entendre parler le letton. Ils décident alors de gravir ensemble le coteau jusqu’au sommet. Moment de plénitude – « L’effort nous a allégés. » Des sons à la fois « doux et tendus » montent du village. « Je me sens en communion avec le monde. » Instant parfait, « première vraie vision de la Courlande », « une représentation familière sans châteaux, sans histoire, sans rameaux d’or. Ce pourrait être n’importe où en Europe. »
Les visites communes se multiplient, Joëlle Kauffmann taquine son mari : « Tu dois t’y faire, il connaît parfaitement son sujet. C’est une chance pour toi. » Le Professeur, jamais à court de ressources ou d’anecdotes historiques, est un « compagnon de voyage rêvé ». Lorsque celui-ci embarque avec sa famille sur un ferry, Kauffmann a le sentiment que pour lui aussi, « la fête est finie ».
C’était avant de découvrir « la maison du lac », une maison isolée « au milieu des forêts enneigées », très moderne, complètement ouverte sur le paysage. Ils décident de prolonger leur séjour – « La vérité de ce pays, c’est l’hiver », disait le Professeur. L’évocation des « Frères de la forêt », groupes de résistance aux Soviétiques, lui rappelle l’oncle de Mara, qui en faisait partie. Ce n’est que longtemps après son retour en France qu’il aura de ses nouvelles.
Et la Courlande où sa femme et lui ont connu « une digression exceptionnelle » dans leur mode d’existence se rappellera à lui en la personne de Vladimir, un jeune rocker russophone qui les avait guidés dans Karosta, à qui, à sa demande, il a envoyé un dictionnaire anglais-letton, et qui débarque carrément chez eux. Apprenant que le reportage n’a jamais été publié, le jeune homme n’hésite pas à lui intimer d'écrire un livre.
Courlande est le récit curieux, aux sens positifs du terme, des pérégrinations d’un humaniste. Un livre de bonne compagnie qui donne un corps et une âme aux syllabes si fluides, en français, d’une région d’Europe : Kurzemē, la Courlande.