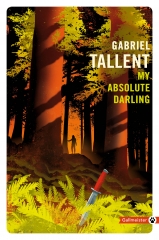Colère et douleur. En racontant l’enquête d’un vieux flic sur deux meurtres commis le même jour à Rouiba, Boualem Sansal donne dans Le serment des barbares (1999) un roman impitoyable sur les lendemains de l’indépendance en Algérie. Dans une prose formidable où rien n’est dit à moitié mais plutôt dix fois qu’une, l’écrivain qu’un diplôme d’ingénieur en 1972 a mené jusqu’au service du ministère de l’Industrie (avant d’être limogé en 2003, mais il vit toujours près d’Alger) a vu son pays sombrer dans la corruption et l’obscurantisme au cours de la seconde moitié du XXe siècle.

Au début de Romans 1999-2011, cinq romans rassemblés dans la collection Quarto, une préface de Jean-Marie Laclavetine et une chronologie des années 1900 à 2015. Surpris et enthousiaste quand il reçoit le manuscrit de Sansal envoyé par la poste, « dans la vie d’un éditeur, un cadeau inoubliable », celui-ci présente l’auteur algérien qui donne dans Le serment des barbares, sans nostalgie ni plainte, un récit flamboyant, comme un torrent de rage envers ceux qui ont divisé la nation et transformé l’indépendance en guerre civile, volé sa liberté au peuple, utilisé l’islam à des fins politiques, armé les terroristes.
« Le cimetière n’a plus cette sérénité qui savait recevoir le respect, apaiser les douleurs, exhorter à une vie meilleure. Il est une plaie béante, un charivari irrémédiable ; on excave à la pelle mécanique, on enfourne à la chaîne, on s’agglutine à perte de vue. Les hommes meurent comme des mouches, la terre les gobe, rien n’a de sens. » (Incipit)
A Rouiba qui « jadis, il y a une vie d’homme, (…) embellissait l’entrée est d’Alger », on est passé de la quiétude, de l’opulence, entre vergers et lauriers-roses, de l’ivresse au désenchantement. Rouiba est devenue le « fleuron de l’industrialisation » et de la misère. Routes défigurées, clôtures aveugles entre lesquelles on vit sans horizon – « l’enfer est dans ses rues ». On y enterre Si Moh, un commerçant richissime, qu’on dit tué par un islamiste – il en aurait eu « marre de se faire pomper par les moudjahidin ».
A l’autre bout du cimetière, on enterre Abdallah Bakour, 65 ans, sans femme ni profession, assassiné le même jour dans sa bicoque. C’est uniquement de cette affaire-là, l’affaire Bakour, que l’inspecteur de police Larbi a été chargé. Veuf, en fin de carrière, on ne lui confie plus que les « faits d’hiver et d’été ». Il interroge le jeune frère du défunt, Gacem Bakour, dans son entreprise de maçonnerie. Si Larbi prend Abdallah en sympathie : cet ancien ouvrier agricole dans un domaine colonial, paradis « bouffé » par le béton, a été égorgé dans la maison où il s’était installé à son retour de France, tout près d’un cimetière chrétien qu’il entretenait avec soin.
Boualem Sansal fait une description dantesque de l’extension industrielle d’Alger, du chantier interminable de l’hôpital de Rouiba, terres fertiles pour la corruption : « Quand le bien avance, le mal accourt. » Larbi n’est pas de ceux qui acceptent « de voir se marchander ce qui ne peut se vendre : l’humanité ». Sa visite au légiste lui apprend deux choses : celui-ci n’a pas vu le cadavre de Bakour, mais bien le rapport sur Moh, « tué d’une rafale de klach dans le flanc, six balles lâchées de trois pas, et deux coups de pistolet tirés à bout touchant dans la pompe » plus un ou deux coups de poignard dans le cœur – pas la manière courante.
Cinq policiers trouvent la mort dans une embuscade islamiste. Epopée de la violence sous toutes ses formes, Le serment des barbares éclaire tous les recoins du naufrage national. Larbi souffre de cette « barbarie sans nom », du saut raté dans la démocratie. « L’assassinat du président Boudiaf l’avait entraîné dans un autre abîme. En disparaissant, sa femme avait emporté ce que trente années de vie commune avaient emmagasiné de tendresse. La mort du Héros avait détruit le fragile espoir d’un peuple n’ayant jamais vécu que l’humiliation, qui se voyait menacé du pire et qui, miraculeusement, s’était mis à croire en ce vieil homme providentiel, inconnu de lui parce que effacé de sa mémoire par trente années de brouillage organisé. »
Coup terrible pour les Rouibéens – « C’était la première fois que la foudre islamiste frappait aussi fort leur ville ». Les brigades spéciales antiterroristes débarquent. Avec les barrages et les abus des « ninjas », les trafics de la mafia, il y a de quoi virer au noir. Mais Larbi s’accroche à son enquête, fait son rapport au jeune juge qui instruit l’affaire Bakour : Gacem n’est pas clair, qui se dit ruiné mais dépense sans compter ; le crime sans rien déranger dans la maison ressemble à une exécution. Larbi veut fouiller dans le passé de Bakour.
Autour de cette enquête, le fil rouge du Serment des barbares, Boualem Sansal fait revivre une terrifiante succession d’attentats, de crimes, de vengeances, d’intimidation des « fous d’Allah », d’abus de pouvoir et de fraudes diverses, sans parler (bien qu’il en parle) du sort des femmes dans cette galère – le négatif du monde auquel on rêvait au Café de la Fac à Alger quand on était jeune et honnête. Larbi aime y retrouver un ami historien.
La première charge de Sansal contre l’islamisme en Algérie au XXe siècle ouvre les yeux sur le passé du terrorisme et son ampleur. Il ne cesse de le dénoncer, de L’enfant fou de l’arbre creux à 2084. Avec un dynamisme époustouflant, une ironie incisive, ce premier roman rend avec force les ambiances urbaines et les misères humaines, l’attachement à un pays qui s’enfonce dans les cercles de l’enfer, où le malheur guette ceux qui veulent rétablir la justice et la paix.
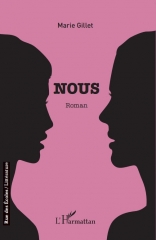 « Eh bien, on va faire connaissance, d’accord ?
« Eh bien, on va faire connaissance, d’accord ?