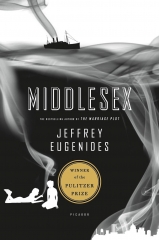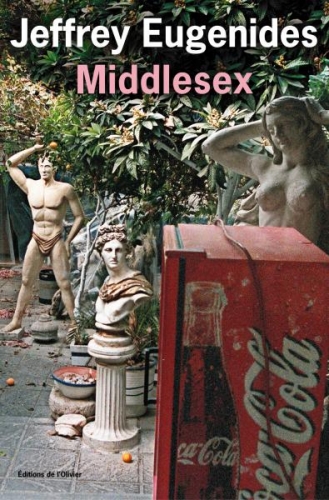« Nous avons déplacé les bornes, maîtrisé le ciel et la terre.
Notre raison a fait le vide.
Enfin seuls, nous achevons notre empire sur un désert.
Délibérément, le monde a été amputé de ce qui fait sa permanence :
la nature, la mer, la colline, la méditation des soirs. »
Camus, L’Eté (1954)
Yves Marry et Florent Souillot citent cet extrait au début de La guerre de l’attention. Comment ne pas la perdre, un essai paru en 2022. « C’est un dérèglement qui n’a rien de naturel, une vague de la force et de la hauteur d’un tsunami, que personne n’a vue venir. Une marée de silicium et de coltan qui a tout recouvert. Cette vague, ce sont les écrans. » En moyenne, chaque foyer en compte sept. Ce bond technologique a changé la société, y compris dans des pays restés longtemps à l’écart de l’occidentalisation. La multiplication des équipements a aussi allongé le temps passé devant les écrans, à communiquer et à se divertir dans le « techno-cocon ».
L’association « Lève les Yeux ! » créée par les auteurs en juin 2018 a pour objectif une reconquête de l’attention. Ce livre, acte de résistance contre sa captation de plus en plus élaborée au profit d’intérêts privés, vise à décrire tous les aspects du problème et à proposer des solutions. Surtout auprès des jeunes, les premières victimes. C’est pourquoi l’association intervient dans les écoles primaires, par exemple à l’aide d’un jeu de société, « Planète déconnexion ».
Les dégâts chez des enfants exposés à des contenus traumatisants et chez des jeunes devenus accros aux vidéos, aux jeux vidéo et aux séries sont connus : moins de sommeil, de concentration, plus d’irritabilité, de sédentarité et d’obésité, de myopie, sans parler de la baisse du QI et du langage. Violence virtuelle, accès à la pornographie, primes à la nudité ou aux postures sexy sur les réseaux pour récolter plus de likes. Même les bébés cherchent les stimuli audiovisuels d’un smartphone, nouveau doudou, au détriment des stimuli sociaux fondamentaux comme les regards et les sourires.
Depuis 2020, en France, la « numérisation de l’éducation » est en marche, malgré son coût économique et écologique colossal. Non évaluée, ni remise en question, même si aucun progrès n’est décelé. Les inégalités se renforcent : les riches mettent leurs enfants dans des établissements privés qui valorisent l’accompagnement humain plutôt que dans le public de plus en plus « numérisé ».
Plus largement, l’essai dénonce la marchandisation des émotions : « clasher », être saillant, permet d’être vu, suivi, de recevoir des offres marketing. On pousse les gens à devenir « accros » à l’attention des autres. On encourage à « noter » tous les services. L’empathie diminue, le sadisme augmente, l’insensibilité et l’isolement aussi. Les émotions prennent le dessus sur les arguments, incitent aux mobilisations éphémères plus qu’à l’action démocratique.
La survalorisation des faits divers et des témoignages déteint sur les médias, les journaux télévisés suivent la tendance. 97% de la publicité va aux Gafam, la presse écrite en souffre. Les représentants politiques font de même : « parole courte, rapide, émotionnelle » et répétée, mise en scène… La guerre de l’attention analyse les procédés de la technologie « persuasive » et décrit ce nouveau capitalisme attentionnel basé sur l’accumulation de données transformées en revenus facturables à des annonceurs.
La manipulation mentale est vieille comme le monde, elle connaît désormais une rapidité et des proportions inédites. Notre vision du monde basée sur la causalité se contente de plus en plus de simples corrélations, nos démocraties imparfaites risquent de se transformer en régimes autoritaires technocratiques. La suite ? Après les humains, les objets connectés… grâce à la 5G.
Contre cette dérive « inégalitaire, antidémocratique et écologiquement insoutenable », comment réagir ? Le coût énergétique de l’expansion numérique explose. Pour éviter l’impasse, il faut d’abord consommer moins d’énergie. Pour retrouver un mode de vie « juste », il faut se déconnecter et réactiver les liens familiaux et sociaux.
Marry & Souillot appellent en premier lieu à protéger les enfants : pas d’écran avant cinq ans (recommandation de l’OMS), maximum une heure d’écran par jour entre 6 et 12 ans, pas de smartphone avant 15 ans (comme la fille de Bill Gates). Pas d’écrans le matin, ni pendant le repas, ni avant de s’endormir. Fin du numérique imposé dans l’éducation. Les écoles doivent redevenir des « havres de déconnexion ». Pour l’apprentissage, opter pour des livres plutôt que pour des écrans.
L’attention est un bien commun à défendre, à protéger. Tout le monde a droit à des espaces sans écrans ni publicité. La pub en ligne devrait être régulée et taxée. Droit à la déconnexion, droit à des guichets administratifs « humains », moratoire sur la 5G, l’essai ouvre plein de pistes de réflexion et de voies pour agir. Il importe de refuser cette captation généralisée de l’attention par les écrans et de donner l’exemple aux enfants de tout ce qui stimule l’attention et libère en profondeur.