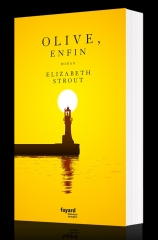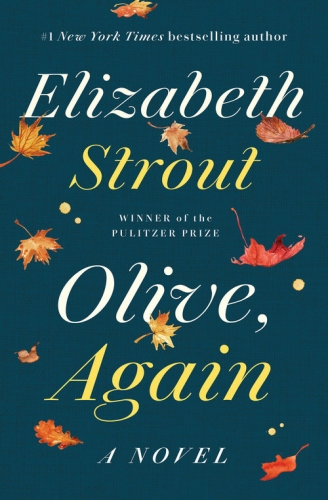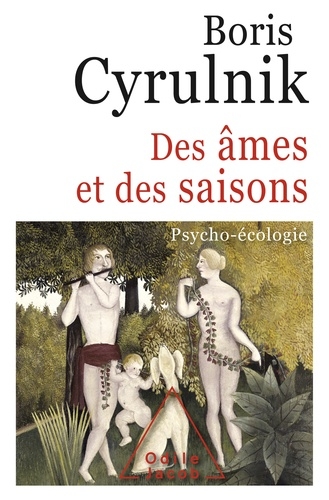Lydie Salvayre, dans Marcher jusqu’au soir, écrit sur sa nuit ratée au musée Picasso. Elle avait refusé d’emblée la proposition d’Alina Gurdiel (qui a lancé la collection « Ma nuit dans un musée »), mais après quelques jours elle a fini par l’accepter, par passion pour L’Homme qui marche de Giacometti. Elle n’avait jamais vu la sculpture en vrai, l’exposition Picasso-Giacometti lui donnait l’occasion de la regarder toute une nuit, seule, à l’aise.
L’épigraphe – « Qu’est-ce que l’art ? Prostitution. » (Baudelaire, Fusées) – annonce déjà ce qu’elle déclare dès la première phrase : elle n’aime pas les musées, qu’elle critique avec véhémence. Et lorsqu’elle se retrouve sur un lit de camp posé près de L’homme qui marche, elle ne ressent rien, « rien qu’une morosité vague et une appréhension » dont elle ignore la cause.
Elle se rend dans les salles attenantes « que le silence et l’absence de toute présence humaine rendaient sinistres ». Aucune grâce, aucun vertige en regardant les sculptures. « Toutes, je l’avoue, me laissèrent ennuyée. » Elle note dans son carnet : « REGARDER CES ŒUVRES M’EST UNE CORVEE ET JE ME FAIS VIOLENCE EN CONTINUANT CETTE EXPERIENCE A LA CON. »
Penser à Giacometti l’aide un peu, elle aime « infiniment » sa légende comme celles « de Baudelaire, de Van Gogh, de Kafka, d’Artaud, de Woolf… ». Elle raconte comment Giacometti a rencontré, à dix-neuf ans, en Italie, un homme qui l’a invité à l’accompagner jusqu’à Venise, mort dans un petit hôtel de montagne où ils passaient la nuit, et puis vécut une autre expérience du même genre quelques années plus tard : « Désormais la mort prendrait demeure en lui, assombrissant son regard sur les êtres et le monde. La fragilité de la vie et son caractère éphémère deviendraient la matière même de son œuvre. »
Ni émotion (Lola Lafon) ; ni inspiration (Zoé Valdés) ; ni récit personnel à la Leïla Slimani, mais un thème en commun, celui des peurs réveillées par l’expérience d’une nuit solitaire dans un musée. Déçue, désemparée, Lydie Salvayre se met en colère et mêle expressions vulgaires et imparfaits du subjonctif : « Je me foutais de l’art. Qu’on ne m’en parlât plus ! Qu’on m’en délivrât une fois pour toutes ! »
Au fond, Lydie Salvayre déteste l’art et les « dévots de l’art » – sa critique des visiteurs de musée et de la « mondanité » de l’art m’a parfois fait penser au Goût des autres, le film d’Agnès Jaoui – et c’est ce qu’elle déclare à Bernard, son compagnon, qui lui téléphone pour voir comment ça se passe. Familier de ses emballements, il attend patiemment et se tait. Beaucoup de retours à la ligne :
« Je savais bien, me dit Bernard.
Tu savais bien quoi ? lui dis-je, agacée.
Je savais bien que tu avais une âme espagnole, me dit-il en riant.
Pourquoi tu dis ça ? lui dis-je sèchement.
Repose-toi, me dit-il sur ce même ton calme qui m’exaspérait. Bonne nuit ma chérie. »
Dans Marcher jusqu’au soir, l’exaltation emporte tout sur son passage. Heureusement, Lydie Salvayre a des choses intéressantes à dire sur Giacometti qu’elle admire : « son absence de jugement moral devant les êtres et les choses, son empathie si grande à leur endroit, sa capacité à trouver tous les visages pareillement beaux – regarder un visage était une aventure qui valait, disait-il, tous les voyages du monde […] ».
Entre élans lyriques et grossiers surgissent des souvenirs de ses parents, des questions et un sentiment d’humiliation diffus (comme chez Annie Ernaux). Salvayre revient sur un dîner où elle a entendu l’épouse d’un cinéaste chuchoter à son sujet : « Elle a l’air bien modeste », une « écharde empoisonnée » qu’elle convertira en roman : dans Pas pleurer, elle met cette phrase condescendante dans la bouche d’un « maître » jugeant une fille de quinze ans qui lui est présentée comme bonne (sa mère, offensée à jamais).
Références littéraires et anecdotes alternent avec de multiples interrogations sur son incapacité à jouir de l’art, de la beauté, qu’elle met sur le compte de son origine sociale. J’ai été, je le reconnais, agacée par les redites, les excès de langage ou de contradiction dans Marcher jusqu’au soir. Le texte m’a paru forcé, mais il a reçu beaucoup d’éloges. Cette nuit au musée a été pour Lydie Salvayre l’expérience d’une « anxiété inexplicable » et elle finira par comprendre et expliquer pourquoi. Une autre visite au musée Picasso, de jour, des mois après, sera l’occasion d’une réconciliation – pour finir sur une note positive ?