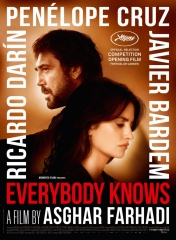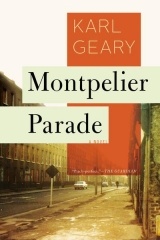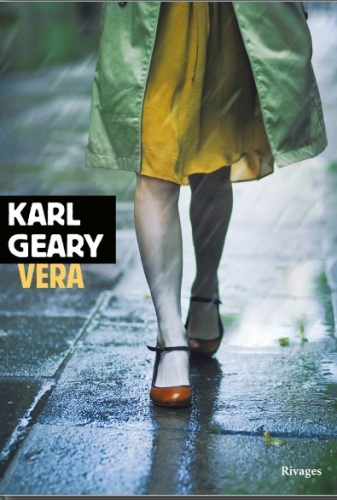On pense à Tchekhov en ouvrant Ma province de Maxime Ossipov (traduit du russe par Anne-Marie Tatsis Botton, Verdier, 2009), deux récits d’un médecin installé « dans la petite ville de N*, chef-lieu d’une région limitrophe de Moscou ». Un peu à Boulgakov aussi. Le même éditeur a publié ensuite ses Histoires d’un médecin russe (2014).

Rue Lénine à Taroussa en 2014 (Wikimedia commons)
« Le cent-unième kilomètre » commence par un constat accablant : « chez les malades, comme d’ailleurs chez beaucoup de médecins, ce qui frappe avant tout, c’est qu’ils ont peur de la mort et n’aiment pas la vie. » Malgré le pouvoir de l’argent et de l’alcool, les cas de mort violente, le désintérêt, le manque d’amis, l’arriération mentale, l’abandon des vieux, il exerce dans son pays natal où il ressent « la liberté d’aider beaucoup de gens » et « la soif d’agir », apprécie les rencontres et la sensation d’être chez lui quand on le salue.
Sa situation s’améliore avec l’arrivée d’un jeune « collègue et ami » : mortalité à l’hôpital divisée par deux, plus de moyens pour soigner. Les difficultés restent nombreuses, notamment à cause de l’absence de médecin traitant, de ligne de conduite. Les gens, souvent ignorants, croient que tout peut être résolu avec de l’argent. Il faut aussi composer avec « les autorités (ceux à qui on ne peut pas dire non) ». Et soigner des « bandits » comme des « frangins » (membres de groupes d’intervention spéciaux).
Ce qui le réjouit, c’est de « réaliser certaines choses pas plus mal qu’en Occident », bref de « se conduire en médecin ». De rencontrer des gens qui, chacun, représentent la Russie à leur façon. « Qu’est-ce qui unit ces Russies différentes, qu’est-ce qui les empêche de se disloquer ? Dans mes pires instants, je pense : l’inertie, et elle seule. »
Pourquoi « Le cent-unième kilomètre » ? Ossipov dit ceci sur le site de la Librairie du Globe : « Mon père était écrivain. Je l’ai vu se débattre toute sa vie entre éditeurs censeurs et correcteurs soviétiques. Peut-être est-ce de là que m’est venu le désir, non d’avoir un pouvoir sur les mots, mais du moins d’en disposer librement. » En 2005, le besoin de retrouver le contact direct avec des patients s’impose, il décide alors de partir en province.
« Mon grand-père était médecin. Envoyé en 1932 au Belomorkanal, puis libéré en 1945, il est toutefois interdit des 100 km. Il s’est donc installé à 117 km au sud-ouest de Moscou, à Taroussa où il est mort en 1968. » (Il était en effet interdit, pour les anciens prisonniers du Goulag, de vivre à moins de 100 km d’une grande ville.) » Ossipov s’est établi à son tour à Taroussa.
Autre registre pour le second récit, « La rencontre », une fiction centrée sur les sentiments. Natacha et Génia travaillent dans le milieu musical : « Natacha réussissait un peu mieux : un orchestre, pas le pire, des tournées, alors que Génia bossait avec des chanteurs, des chefs d’orchestre, il accompagnait même des figurants. » Elle joue du violon et c’est à l’école de musique qu’ils se sont rencontrés. Elle est devenue sa femme mais fait chambre à part, ne veut pas d’enfants. Génia en souffre un peu, se montre patient.
Un coup de fil efface tout, musique et passé : Génia a fait une chute mortelle, on demande à Natacha d’apporter ses papiers. Après les funérailles, elle ira parler au père Iakov, un Juif converti. Elle voudrait faire quelque chose pour Génia, mais que pourrait-elle faire ? Flash-back. Ossipov raconte le passé de Génia et sa rencontre avec Natacha telle que lui l’a vécue. On change encore de point de vue avec un autre personnage, Sergueï Ilitch, un médecin obsédé par la sténocardie grave de sa mère, toujours sur le qui-vive. Le récit va d’une rencontre à l’autre, d’un coeur à l’autre.
En une centaine de pages, Ma province de Maxime Ossipov plonge les lecteurs dans une Russie provinciale où tout, finalement, ramène à la vie ou à la mort. On y sent l’amour de la médecine, la volonté d’être utile, mêlés au désenchantement politique. « De son écriture sèche, ironique, dépourvue de toute trace de romantisme, Ossipov dépeint un monde en perdition », écrit Raphaëlle Rérolle dans Le Monde. Au milieu des problèmes subsiste pourtant chez le médecin « une joie profane ».