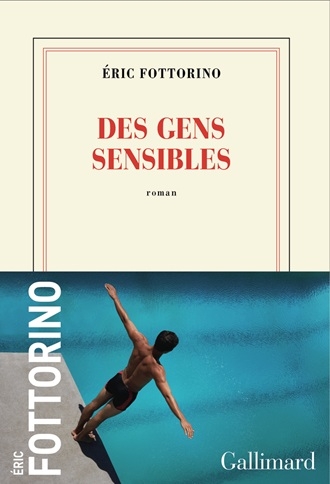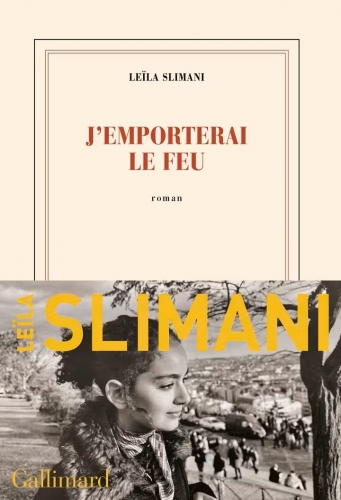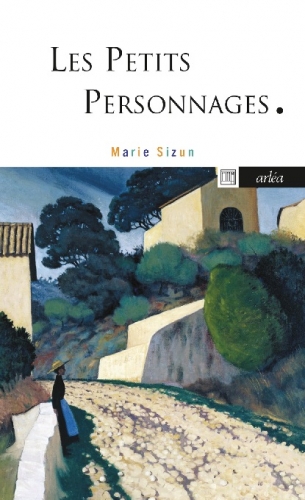« J’avais vingt ans et j’avais écrit le plus beau roman du monde. C’est Clara qui le disait. Je croyais tout ce que disait Clara. » Eric Fottorino, qui a consacré bien des romans à explorer les silences de sa vie familiale – dans Dix-sept ans, ceux de sa mère qui avait cet âge-là quand il est né –, commence ainsi son dernier roman, Des gens sensibles.
C’est ce titre qui avait été proposé pour le premier roman de Jean Foscolani aux Editions du Losange, rue du Samovar, trente ans plus tôt. Au printemps 1994, Charles Follet avait ajouté en acceptant son manuscrit : « Pour la presse, vous verrez avec Clara. » Bientôt l’auteur avait compris que dans sa vie d’écrivain, le personnage le plus important n’était pas cet « éditeur à l’ancienne », mais « ce couple improbable que formaient Saïd et Clara ».
Saïd, « l’écrivain que tout le Maghreb adulait », vivait chez Clara « quand il s’échappait d’Algérie où le poursuivait une meurtrière folie ». L’attachée de presse avait quinze ans de plus que « Fosco », comme elle l’appelait, et un visage marqué par le manque de sommeil, l’alcool, les cigarettes, les mauvais souvenirs. « Le cœur de Clara ne battait que pour la littérature. Elle ne cherchait pas à plaire, encore moins à séduire. Elle était belle d’avoir renoncé à l’être. » C’était elle qui le lancerait.
D’abord, il fallait faire entendre son nom, l’introduire dans le milieu des « faiseurs d’opinion », aller à la rencontre du Tout-Paris littéraire. Convoqué chez elle avant une soirée au Saint-James, il avait été surpris par son bel appartement classique, le sol jonché de « cadavres de livres » et de « feuilles éparses » au pied de son fauteuil de cuir. Clara dormait peu, lisait toute la production du Losange et tout le reste, des heures d’affilée : « Tant de livres et si peu d’écriture, maugréait-elle. »
Très vite, elle s’était retrouvée entourée au Saint James, une coupe de champagne à la main ; ses amis « guettaient ses oracles et ses bons mots ». Fosco ignorait alors en la regardant se tenir droite, « presque raide », le grave accident de voiture et les plaques de cuivre fixées sous la peau de son dos. Clara le présentait, conseillait de ne pas oublier son nom ni le titre de son roman à paraître.
Ensemble, ils étaient allés accueillir Saïd à l’aéroport, qui « croyait trouver la paix dans l’anonymat de Paris » comme « tant d’artistes kabyles de cette période », mais craignait que la protection policière autour de lui n’attire l’attention. Sa famille menacée avait dû s’exiler au Maroc et même là, son fils aîné venait de se faire écraser par une voiture tous feux éteints à Tanger. Clara avait organisé une soirée entre amis dans le Marais, ils en étaient sortis par une porte secondaire et Fosco les avait emmenés dans sa vieille Ford, d’abord au hasard dans Paris la nuit, puis jusqu’en Normandie – Saïd avait envie de voir la mer.
Ils sont aux ordres de Clara, « fille de sorcière », qui veut que Saïd lise le manuscrit de Fosco, qui attend de Fosco parti chez sa mère à Royan qu’il lui donne le numéro de la cabine téléphonique la plus proche, etc. Ses appels téléphoniques n’en finissent pas, elle a tant à raconter. Elle lui dit que Saïd est intrigué par sa quête des origines – sa mère ne lui a rien dit de son père – et dit « qu’il vaut mieux tout savoir de son histoire, même si elle est terrible. »
Clara et sa voix rauque, Saïd et sa voix plus sourde, son air sombre. Depuis l’arrivée de Fosco, leur duo est devenu trio : quand Saïd repart, Clara invite le romancier à rester. Contrairement à lui qui commence à récolter de bonnes critiques dans la presse, eux ne se laissent jamais photographier. Lorsqu’ils s’étaient retrouvés à deux pour un « vrai couscous », Saïd qui l’avait lu s’étonnait de sa peau claire pour un Berbère (la seule chose que lui ait dite sa mère à la peau laiteuse : tu es le fils d’un Berbère), ajoutant qu’il avait connu des visages comme le sien en Kabylie.
Eric Fottorino fait raconter par Foscolani ces liens profonds qui se sont formés autour de son premier roman, ses errances dans Paris à la recherche des souvenirs de cette fin du XXe siècle sans internet ni téléphone portable (il cite Modiano en épigraphe). Fosco confronte ses impressions d’alors et celles d’à présent quand il rencontre ceux qui les ont bien connus, Saïd et Clara, ces « gens sensibles » qui ne sont plus. L’un d’eux lui révélera sur Clara des choses qu’il n’avait jamais soupçonnées. Des gens sensibles rend hommage avec délicatesse à ceux qui croient vraiment au pouvoir des mots. On n’oubliera pas cette Clara.