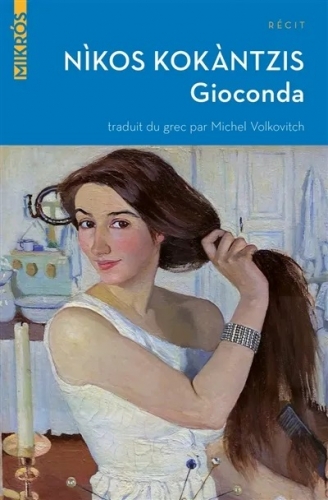C’est l’annonce du décès de Maryse Condé (1934-2024) en avril dernier et son évocation à La Grande Librairie, puis le billet d’Aifelle, qui m’ont conduite vers Le cœur à rire et à pleurer (1999), où l’écrivaine guadeloupéenne raconte ses souvenirs d’enfance. Sans fard, que ce soit dans le portrait qu’elle fait de sa famille, de son milieu, d’elle-même. « La petite dernière » d’une famille de huit enfants, elle dédie son livre à sa mère, la grande figure de sa vie : celle-ci n’était pas peu fière d’avoir échappé au destin de sa propre mère en devenant institutrice et en faisant un mariage avantageux avec un veuf qui « avait construit sa maison haute et basse rue de Condé ». Son père avait soixante-trois ans quand Maryse Condé est née, sa mère quarante-trois.
La deuxième guerre mondiale les avait « privés de qui comptait le plus pour eux : leurs voyages en France. » Les compliments des garçons de café au terrasse – « Qu’est-ce que vous parlez bien le français ! » – les faisaient soupirer, eux qui étaient « aussi français qu’eux » (son père) et même « plus français » (sa mère). Ils étaient « plus instruits », avaient « de meilleures manières », lisaient davantage. Comme Maryse ne comprenait pas leurs réactions, elle s’était tournée vers son frère Alexandre (Sandrino) qui lui avait fourni une réponse à creuser : « Papa et maman sont une paire d’aliénés. » Elle s’était fabriqué une définition d’une personne aliénée : « une personne qui cherche à être ce qu’elle ne peut pas être parce qu’elle n’aime pas être ce qu’elle est ». Pour ne pas l’être, elle devint « répliqueuse et raisonneuse ».
Née un Mardi gras, tandis que les masques envahissaient La Pointe, son « premier hurlement de terreur résonna inaperçu au milieu de la liesse d’une ville. Je veux croire que ce fut un signe, signe que je saurais dissimuler les plus grands chagrins sous un abord riant. » Forte de sa bonne réputation, sa mère l’inscrit dans une école payante tenue par des sœurs « fort cultivées ». « Dans notre milieu, toutes les mères travaillaient et c’était leur grande fierté » d’échapper aux tâches manuelles « qui avaient tellement défait leurs mères ». Maryse y rencontre celle qui sera sa meilleure amie, Yvelise, « aimante, rieuse comme une libellule, de caractère aussi égal que le mien était lunatique ». Elles étaient « de même couleur, pas trop noires, pas rouges non plus, de même hauteur, pareillement gringalettes […]. »
Dans la même classe, assises côte à côte, Maryse était la première, Yvelise la dernière. Leur maîtresse, dont Maryse était la « bête noire » à cause de son indiscipline et de ses moqueries, donna pour sujet : « Décrivez votre meilleure amie. » Maryse reçut « huit heures de colle » à cause des « méchancetés » qu’elle avait écrites. « J’étais le digne rejeton d’une famille où l’on pétait plus haut que ses fesses, d’une famille de nègres qui se prenaient pour ce qu’ils n’étaient pas. » Leur amitié, heureusement, perdura.
Ils habitaient « une rue digne, habitée par des notables, parfois aussi par des gens aux revenus modestes, toujours de parfaites manières. » Pour décrire leur mode de vie à la Guadeloupe, leurs histoires de famille, leurs vacances, Maryse Condé recourt aux expressions locales, au créole, surtout à l’oral. L’attachement à sa mère, Jeanne Quidal, « une très belle femme », transparaît dans toutes les anecdotes qu’elle raconte. La réputation « d’un personnage de légende », mais peu aimée « malgré ses charités inlassables » – « Car la base de son caractère était l’orgueil. Elle était fille d’une bâtarde analphabète qui avait quitté La Treille pour se louer à La Pointe. » Son intelligence exceptionnelle en fit « une des premières enseignantes noires ». A dix ans, sa benjamine compose son portrait pour l’anniversaire de sa mère, en s’attachant « à représenter de mon mieux un être aussi complexe ». Un désastre.
A treize ans, elle est élève au lycée Fénelon à Paris ; son professeur de français, de réputation communiste, lui demande de faire un exposé « sur un livre de votre pays ». Le sujet la plonge dans la confusion, elle n’en connaît pas. Son frère lui indique La Rue Cases-Nègres de Joseph Zobel – c’était la Martinique, « l’île sœur de la Guadeloupe ». Elle dévore le livre. Son « engagement politique » est né « de de moment-là, de cette identification forcée au malheureux José. La lecture de Joseph Zobel, plus que des discours théoriques, m’a ouvert les yeux. […] J’étais « peau noire, masque blanc » c’est pour moi que Frantz Fanon allait écrire. »