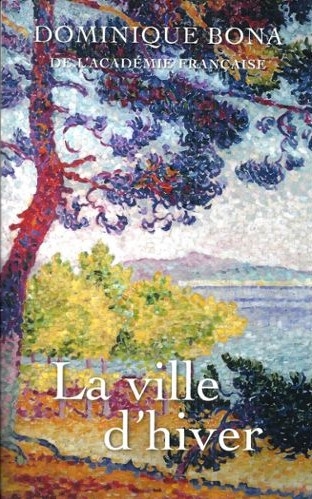Paysages avec figures absentes de Philippe Jaccottet (1925-2021) – un titre choisi au hasard pour l’aborder – a paru sous le titre Paysages de Grignan en 1964, en guise d’introduction aux gravures de Gérard de Palézieux (1919-2012) à la bibliothèque des Arts de Lausanne, signale une note de Poésie/Gallimard. En voici l’incipit.
Je n’ai presque jamais cessé, depuis des années, de revenir à ces paysages qui sont aussi mon séjour. Je crains que l’on ne finisse par me reprocher, si ce n’est déjà fait, d’y chercher un asile contre le monde et contre la douleur, et que les hommes, et leurs peines (plus visibles et plus tenaces que leurs joies) ne comptent pas assez à mes yeux. Il me semble toutefois qu’à bien lire ces textes, on y trouverait cette objection presque toute réfutée. Car ils ne parlent jamais que du réel (même si ce n’est qu’un fragment), de ce que tout homme aussi bien peut saisir (jusque dans les villes, au détour d’une rue, au-dessus d’un toit). Peut-être n’est-ce pas moins utile à celui-ci (en mettant les choses au pis) que de lui montrer sa misère ; et sans doute cela vaut-il mieux que de le persuader que sa misère est sans issue, ou de l’en détourner pour ne faire miroiter à ses yeux que de l’irréel (deux tentations contraires, également dangereuses, entre lesquelles oscillent les journaux et beaucoup de livres actuels). Des cadeaux nous sont encore faits quelquefois, surtout quand nous ne l’avons pas demandé, et de certains d’entre eux, je m’attache à comprendre le lien qui les lie à notre vie profonde, le sens qu’ils ont par rapport à nos rêves les plus constants. Comme si, pour parler bref, le sol était un pain, le ciel un vin, s’offrant à la fois et se dérobant au cœur : je ne saurais expliquer autrement ni ce qu’ont poursuivi tant de peintres (et ce qu’ils continuent quelquefois à poursuivre), ni le pouvoir que le monde exerce encore sur eux et, à travers leurs œuvres, sur nous. Le monde ne peut devenir absolument étranger qu’aux morts (et ce n’est même pas une certitude.)
Pour une première rencontre avec un poète, quel bel accueil ! Lecture à poursuivre.