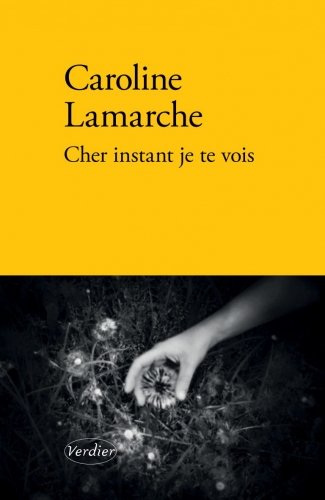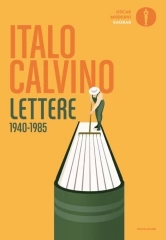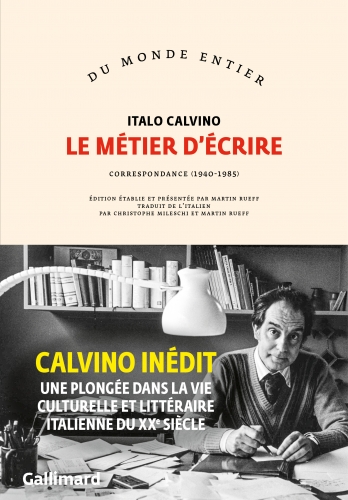Cher instant je te vois : à son dernier récit publié cette année, Caroline Lamarche a donné un très beau titre, emprunté à un poème de Samuel Beckett cité en épigraphe :
« cher instant je te vois
dans ce rideau de brume qui recule
où je n’aurai plus à fouler ces longs seuils mouvants
et vivrai le temps d’une porte
qui s’ouvre et se referme »
En vers libres, les phrases s’interrompent le temps d’un passage à la ligne, un blanc sépare les séquences. Caroline Lamarche raconte la maladie, l’amitié, après avoir clairement annoncé son sujet dès le début :
« Un poème par jour, Margarida, c’est peu
et c’est beaucoup pour notre tendresse captive
de ton corps mangé par le crabe sournois. »
Margarida Guia « s’est éteinte le 19 juillet 2021 à l’âge de 48 ans. Créatrice sonore, compositrice, performeuse à la voix étonnante, elle rayonnait dans de multiples domaines. Artiste merveilleusement singulière, elle fut aussi, pour tous ceux qui l’ont connue, une amie inoubliable. » Caroline Lamarche la présente en ces termes sur son site en lui rendant hommage.
« Je sais tout de toi par les mots que tu me laisses
enregistrés sur ton téléphone portable. »
Le chapeau chic acheté dans la Galerie du Roi, son métier de compositrice avec un micro à bout de bras, ses chiens, sa vie de comédienne, les souvenirs : c’est une sorte de portrait que l’écrivaine dessine au fil des pages, en même temps qu’elle reprend les mots reçus de l’amie, le temps qu’il fait, et les étapes du cancer du sein d’abord sous-estimé, puis aggravé.
« Le poème est un flacon de larmes
artificielles et bienfaisantes.
Je l’ouvre trois fois par jour, verse quelques gouttes sur moi-même,
stratégie palliative, discipline minuscule,
un mot après l’autre, mais
ce sont tes mots, Margarida,
que l’aube me voit relire
avec mes larmes de la veille. »
Un tel récit ne se résume pas. On le lit souvent le cœur serré, on sourit quand les échanges entre les deux amies se font joueurs. Caroline Lamarche raconte le quotidien, les lectures, écritures, rencontres, les saisons. Elle déroule le fil de leur amitié, s’arrête aux instants précieux d’un mot, d’un geste. D’autres vers de Beckett se glissent dans le texte, toujours à la pointe de l’exactitude. Les deux amies savent l’issue fatale, mais entretiennent leur lien autant que possible.
Lamarche, notre contemporaine, je l’ai découverte comme beaucoup en 1996, quand le prix Rossel lui a été attribué pour Le jour du chien. On peut lire sur Objectif plumes sa biographie et un portrait par Jeannine Paque dans Le Carnet et les Instants sous le titre : « Caroline Lamarche : une subversion sans tapage ». A la Wittockiana, j’avais admiré la manière dont Kikie Crèvecœur avait illustré ses Trognes pour un livre d’artiste. Le très beau Cher instant je te vois incite à pénétrer plus avant dans son œuvre.