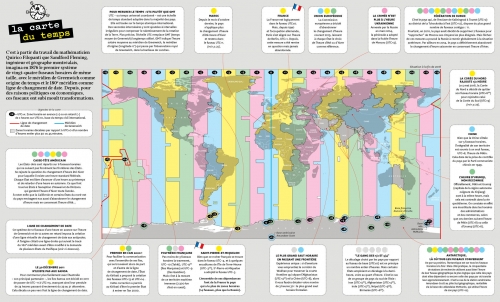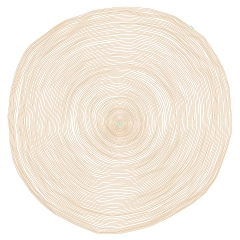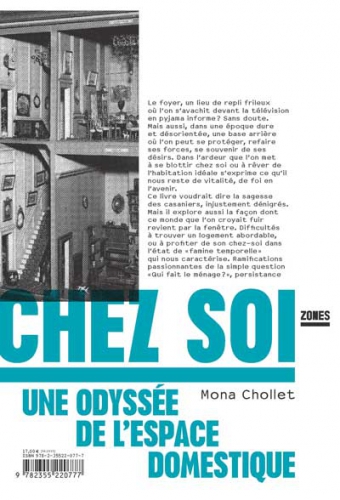Que faut-il pour contrer un blocage vis-à-vis d’un écrivain ? Une autre lecture. Dora Bruder m’a donné envie de retourner dans l’univers de Patrick Modiano. Encre sympathique (2019) s’ouvre sur une épigraphe idéale de Maurice Blanchot : « Qui veut se souvenir doit se confier à l’oubli, à ce risque qu’est l’oubli absolu et à ce beau hasard que devient alors le souvenir. »
L’incipit aussi donne bien le ton : « Il y a des blancs dans cette vie, des blancs que l’on devine si l’on ouvre le « dossier » : une simple fiche dans une chemise à la couleur bleu ciel qui a pâli avec le temps. Presque blanc lui aussi, cet ancien bleu ciel. Et le mot « dossier » est écrit au milieu de la chemise. A l’encre noire. » Le seul dossier que le narrateur a conservé de son passage à vingt ans dans « l’agence de Hutte ». Il le rouvre un demi-siècle plus tard.
Sa première mission avait été d’enquêter dans le voisinage d’une disparue, Noëlle Lefebvre, dont Hutte avait la carte des PTT retrouvée à son domicile, avec photo et adresse, destinée à retirer du courrier au guichet de la poste restante. La concierge ne l’avait plus revue depuis plus d’un mois, à la poste il n’y avait aucun courrier pour elle.
A la terrasse du café où on la connaissait, l’enquêteur avait été abordé par un homme de son âge à qui le patron avait signalé qu’il cherchait Noëlle. Celui-ci voulant savoir à quel titre, il lui avait montré alors la carte des PTT, prétendant être un ami à qui elle confiait son courrier poste restante. Gérard Mourade, étonné, se demandait si son mari, Roger Behaviour, avec qui Noëlle habitait rue Vaugelas, était au courant de cette correspondance.
Songeant à cette première rencontre lors d’un après-midi de printemps, le narrateur se rend compte qu’il ne lui en reste que des bribes « après un si grand nombre d’années ». L’agence enquêtait pour le compte d’un client, « Brainos, 194, avenue Victor-Hugo ». C’est ce nom qu’il avait communiqué à Mourade qui voulait savoir où lui l’avait connue, mais le nom ne lui disait rien.
Tout de même, certains renseignements s’étaient glissés dans leur conversation : Noëlle travaillait chez Lancel, place de l’Opéra ; Roger pratiquait « un peu tous les métiers » ; Mourade suivait des cours de comédien et faisait de la figuration dans des films pour payer ses cours. Sur une impulsion, le narrateur-enquêteur avait improvisé : Noëlle et lui étaient nés dans la même région, « un village aux environs d’Annecy, Haute-Savoie. »
Encre sympathique comporte de multiples indications de lieux, on n’en attend pas moins de cet arpenteur de Paris. Les nuances des couleurs y sont très précises aussi : « bleu Floride » pour l’encre des lettres envoyées à Noëlle poste restante, « un bleu très clair », « bleu outremer » des yeux de Hutte se désintéressant bientôt du dossier qu’il lui a confié, le client ne s’étant plus manifesté.
Dix ans plus tard, en attendant son tour chez le coiffeur, l’enquêteur était tombé sur le nom et une photo de Gérard Mourade dans un annuaire de cinéma. En s’en souvenant, il s’aperçoit qu’il a bien eu « un trou de mémoire » concernant ces dix années, lui qui ne tient ni journal ni agenda. « Désormais, il faut, dans la mesure du possible, que je m’efforce de respecter l’ordre chronologique, sinon je me perdrai dans ces zones où s’enchevêtrent la mémoire et l’oubli. »
Une employée de la maroquinerie de l’Opéra lui a confié sa déception après le départ sans avertissement de son amie. Il a pris un verre avec un ami d’Annecy plus vu depuis des années et lui a parlé de la disparue. A Rome, il suit une Française dans la galerie « Gaspard de la Nuit ». Modiano plonge à la recherche du temps passé et ramène dans ses filets non seulement des noms et des lieux, mais surtout des rencontres. Son exploration de la mémoire et de ses pièges est envoûtante.

https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/la-grande-librairie-saison-12/1069891-speciale-patrick-modiano.html
(mise à jour 26/6/2020)
« A mesure que je tente de mettre à jour ma recherche, j’éprouve une impression très étrange. Il me semble que tout était déjà écrit à l’encre sympathique. » Si le titre désigne d’abord ces traces invisibles sur le papier, l’encre n’apparaissant « que sous l’action de la chaleur ou d’un réactif chimique » (TLF), il dit aussi l’attrait du narrateur pour révéler ses personnages et, en particulier, cette femme dont il suit les traces. Pourquoi cette obsession ? Je me garderai de dévoiler son aboutissement. Dans L’Obs, Jérôme Garcin considère Encre sympathique comme un roman « brumeux et magnétique. »