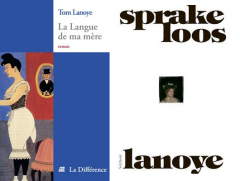Ce n’est pas la Tinker Creek d’Annie Dillard, c’est un beau domaine près d’Anvers, au nom mythique pour les amoureux des lettres belges : Missembourg. (Dans un bol à thé, j'en conserve deux noisettes, cueillies là par une amie très chère.) Marie Gevers (1883-1975) y est née, y a vécu toute sa vie, y a écrit entre autres Vie et mort d’un étang, Madame Orpha, Paix sur les champs, La Comtesse des digues, et ce Livre des douze mois que je viens de relire : Plaisir des Météores (1938), dédié « aux habitants des contrées soumises au Gulf-Stream ».
Marie Gevers n’est jamais allée à l’école. Elle apprend le français avec sa mère dans Les aventures de Télémaque (Fénelon) et le calcul avec un instituteur, à domicile. Beaucoup d’enfants de la bourgeoisie flamande étaient alors élevés exclusivement en français. Son fils Paul Willems sera lui aussi écrivain. Son neveu Frédéric Gevers, pianiste.
Plaisir des Météores est tout entier tourné vers le climat. « Les météores ? On a pris l’habitude de ne nommer météores que les astres errants, les étoiles filantes ou la foudre. Or, tous les phénomènes qui se passent dans l’atmosphère répondent à ce beau nom. La grêle, le brouillard et les pétales de la rose des vents sont des météores, ainsi que le givre, le grésil et le dégel, l’arc-en-ciel et le halo lunaire, et aussi, les silencieux éclairs de chaleur où se libère l’angoisse des nuits de juillet ; météores enfin le rougeoiement des couchants et les lueurs vertes de l’aube. »
« Janvier et la glace » ouvre l’année, avec ses nuits de gel où « le ciel et la terre n’appartiennent qu’aux astres ». Marie Gevers aime épier la gelée, la surprendre au moment où elle épouse les bords des mares et « sertit jusqu’à chaque tige des roseaux morts, et jusqu’au plus infime brin de la plus légère des touffes d’herbes ! » Le froid ravive les souvenirs d’enfance, à guetter le moment où la glace sera assez solide pour porter les patineurs. Après le dégel, il est rare que le mois de février « ne nous fasse don de sept jours de printemps », et la voilà qui les guette et les raconte, pour vérifier ce vieux dicton.
Un vent d’est rappelle la fameuse fièvre – 41 ° – d’un voisin : femme affolée, curé, médecin… qui comprend que le thermomètre a pris la température de la cheminée ! Bien sûr, Marie Gevers écrit ici avant tout le livre des saisons : « Les matins nous offrent des météores changeants et l’heure de l’équinoxe varie de l’aube à la nuit, mais on parvient toujours à découvrir le moment mystérieux où naît le printemps. » Pâquerettes, vols d’alouettes, boue, feuillaison, almanachs champêtres… Avril autour des étangs, du ruisseau porteur de messages : « Le soir, il envoie dans les prés et enroule aux arbres des rubans de brume dont seuls les peupliers émergent. »
« La maison, le jardin étaient mon univers, mon paradis. On ne disait même pas : notre maison, notre jardin. L’absolu ne demande pas à être affirmé. » Sa mère lui montre des bergeronnettes qui construisent leur nid dans la boîte aux lettres, y appose un écriteau pour prévenir le facteur de n’y rien glisser. « Jamais le mois de mai ne parvient à épuiser toutes les beautés dont il dispose. » Arcs-en-ciel, « nuits lunaires, éclairées de rossignols », rosée… Mais les saints de glace sont les « maîtres de l’anti-mai », et le manque d’eau.
Variations de la lumière, anecdotes, saveurs, Marie Gevers déroule en ce journal météorologique mille observations du ciel, des éléments, de la flore et de la faune dans le grand jardin de Missembourg. Les hommes y passent, à l’arrière-plan. Collectionneuse de mots pour dire tout ce qui la touche, elle s’attarde sur « azur », énumère les surnoms des plantes, cherche le « bel origan » dans un dictionnaire de botanique, prête un caractère aux arbres. Tantôt conteuse, tantôt poète, mémorialiste de Missembourg, Marie Gevers écrit Plaisir des météores en amoureuse de la vie sous toutes ses formes, traverse pour nous l’automne, retrouve les jours et les nuits de neige. Mais n’avançons pas trop vite, accueillons les plaisirs du jour…
« Quand vous verrez le matin s’avancer en faisant la roue, quand midi s’arrondira, bleu et vert, dansant dans la chaleur, quand l’étang se couvrira de nénuphars, pour se garantir du soleil trop altéré de l’après-midi, pensez que mai vous a donné tout ce qu’il pouvait, à travers les obstacles entassés par l’anti-mai. Ce que ce mois n’a pu vous livrer, reste en stock, dans ce lieu d’azur où nous avons pénétré, et qui est peut-être bien le lieu des souvenirs laissés dans le cœur des hommes par tous les mois de mai de leur enfance.
Les matins bleu-paon appartiennent à juin. »