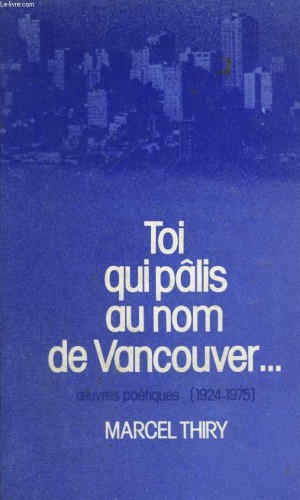Marcel Thiry (1897-1977), poète voyageur, puis poète marchand, s’est engagé à dix-huit ans comme soldat avec son frère dans une unité belge d’autos-canons en soutien des forces russes : Petrograd, Tsarkoïé-Selo, Moscou, Kiev, Tarnopol... Quand la Révolution d’Octobre éclate, c'est le signal du retour par la Sibérie, Irkoutsk, Kharbine, Vladivostok – « les trente mois de notre jeunesse les plus ardents et les plus riches en souvenirs, et nous garderons d’elle, des peuples russes et de la vie russe un amour plus fort que l’amertume des rêves et des déceptions. » Défilé sous une pluie de roses à San Francisco, puis les soldats visitent Salt Lake City, New York, avant Bordeaux, Paris, Liège où Thiry va étudier le droit.
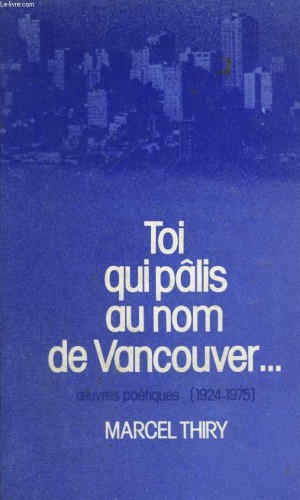
« Je me souviens encor de vos rouges falaises,
Folkestone, et du vert des pelouses anglaises
Et du balancement respirant d’un steamer,
Et, passé les semaines vastes sur la mer,
Je sais encor l’arrière-saison boréale
Où parurent, parmi la pâleur idéale
Et l'haleine du Pôle angélisant le ciel,
Le Nord, le gel, et les clochers d'or d'Archangel.
Je me souviens encor du nom fier d'Elverdinghe
Et des bons compagnons durcis par la bourlingue
Près de qui j'ai dormi mes plus justes sommeils ;
Je me souviens de continents et de soleils
Qui jalonnèrent les trois ans de France en France,
Et dans sa fin d’enfance et son indifférence,
Du soldat maigre, oisif et sale que j'étais. »
Dès 1912, Marcel Thiry publie ses premiers vers dans la revue Belgique-Athénée. Il admire Henri de Régnier, Verlaine, et après la guerre, l’Apollinaire d’Alcools. Sa voix – sa voie – propre se fait entendre en 1924 dans Toi qui pâlis au nom de Vancouver, titre du recueil et d'un célèbre poème plusieurs fois remanié.
« Toi qui pâlis au nom de Vancouver,
Tu n'as pourtant fait qu'un banal voyage ;
Tu n'as pas vu la Croix du Sud, le vert
Des perroquets ni le soleil sauvage.
Tu t'embarquas à bord de maint steamer,
Nul sous-marin ne t'a voulu naufrage ;
Sans grand éclat tu servis sous Stürmer,
Pour déserter tu fus toujours trop sage.
Mais qu'il suffise à ton retour chagrin
D'avoir été ce soldat pérégrin
Sur les trottoirs des villes inconnues,
Et, seul, un soir, dans un bar de Broadway,
D'avoir aimé les grâces Greenaway
D'une Allemande aux mains savamment nues.
(Marcel Thiry, Toi qui pâlis au nom de Vancouver, 1924)
Après Plongeantes Proues et L’Enfant prodigue, le thème du voyage laissera la place à une autre source d’inspiration. A la mort de son père en 1928, Thiry reprend ses affaires (commerce de bois et de charbon) et sa poésie aborde des thèmes plus rares chez les poètes : le commerce, les bureaux. Le ton change. Ce sera pour un autre billet.