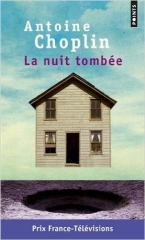Quitter la Belgique par temps gris et pluvieux pour un séjour dans le Midi, rouler tout un dimanche avec France Inter dans les oreilles pour se mettre dans le bain français – « On va déguster » nous a donné envie de citrons à l’aller, de fines herbes au retour –, c’est avoir rendez-vous souvent, passé Lyon, avec un ciel d’azur qui fait rêver des plages, de la mer et des sentiers du littoral où s’enivrer d’ambiances méditerranéennes. Mais il a fallu cette fois composer certains jours avec les nuages et la pluie ; en mars, il est vrai, le printemps tout neuf est encore timide.
Qu’elle est belle, la côte varoise ! Ci-dessous une vue d’ensemble, prise du massif du Cap-Sicié vers les Sablettes (La Seyne-sur-mer), la presqu’île de Saint-Mandrier et à l’arrière-plan, la baie de Toulon. Puis le petit port du Brusc, toujours sympathique ; les nouveaux pontons y accueillent de plus en plus de bateaux. A Sanary-sur-mer, le port est en chantier, mais il y reste tant de beaux endroits pour se promener et contempler, du haut de la falaise ou depuis la montée du calvaire.
A Bormes-les-Mimosas, la végétation luxuriante enchante de tous côtés. Formes exotiques, parterres soignés, fleurs aux couleurs éclatantes, glycines… Les arbres de Judée y étaient déjà bien en fleurs. En cette saison où les flâneurs ne sont pas très nombreux encore, les chats de rencontre se montrent très sociables.
J’ajoute à ces quelques photos de vacances celle de cette tourterelle qui s’est trouvé une place originale pour faire son nid – tranquille. A bientôt pour un aperçu de la suite : après la côte varoise, ce sera la Drôme provençale.