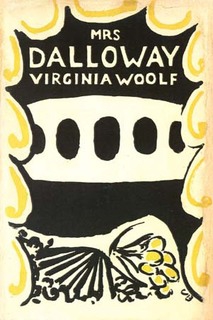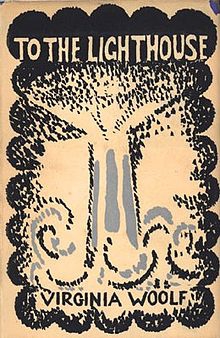Le Journal de Virginia Woolf de 1923 à 1927 éclaire la création de ses œuvres célèbres : Mrs. Dalloway (qu’elle appelle longtemps Les Heures) et La Promenade au Phare – et puis Orlando, inspiré par Vita Sackville-West, qui prend forme comme une histoire amusante à écrire, une détente par rapport aux essais. Le Journal aborde tant de sujets que je m’en tiendrai aux signets glissés çà et là dans ce volume trois.
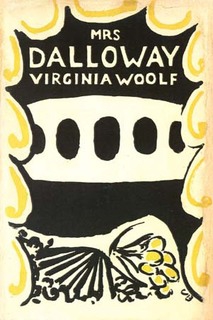
Quelques jours après la mort de Katherine Mansfield, Virginia décrit sa réaction : « A cela, j’ai ressenti – quoi au juste ? Un brusque soulagement ? Une rivale de moins ? Puis de la confusion à constater si peu d’émotion. Et peu à peu un vide, une déception ; et enfin un désarroi auquel je n’ai pu me soustraire de tout le jour. Lorsque je me suis mise au travail, il m’a semblé qu’écrire n’avait aucun sens. Katherine ne me lirait pas. Elle n’était plus ma rivale. Puis un sentiment plus généreux me vint : Ce que je fais là, je le fais mieux qu’elle ne l’eût fait, mais où est-elle, elle qui faisait ce dont moi je suis bien incapable ! »
En mars, Leonard Woolf devient directeur littéraire de La Nation : inattendu, et une sécurité financière bienvenue. A la fin du mois, ils se rendent en France puis en Espagne où ils séjourneront une semaine en Andalousie chez Gerald Brenan, un voyage d’un mois pendant lequel Vanessa s’installe avec sa famille à Monk’s House.
Le reproche fait à Virginia par certains de ne pas savoir créer de personnages la préoccupe : a-t-elle le pouvoir d’exprimer la réalité ? n’écrit-elle que sur elle-même ? « J’aurais beau répondre à ces questions dans le sens le moins favorable, il ne m’en resterait pas moins cette fièvre d’écrire. » – « Pour en revenir aux Heures, je prévois que ce sera une lutte terrible. Le thème est si étrange et si puissant ! » (Elle veut y exprimer la vie et la mort, la raison et la folie, critiquer le système social.)
Une autre fièvre la prend : « il nous faut quitter Richmond pour nous installer à Londres ». Elle voudrait en convaincre Leonard. A quarante ans passés, ses talents « ne vont plus se recharger d’eux-mêmes », la vie en banlieue ne la satisfait plus, elle a l’impression de « passer à côté de la vie ». Leonard « détient le vieil obstacle inébranlable : (sa) santé. » Virginia imagine tout ce qu’elle pourrait faire si elle n’avait pas chaque fois un train à prendre pour aller en ville et s’aventurer « parmi les humains ».
« Aller toujours de l’avant, voilà mon principe pour vivre, et je m’efforce de le mettre en pratique, quoiqu’en paroles plus qu’en actions, je l’avoue. Ma théorie est que, lorsqu’on atteint quarante ans, on accélère le pas ou on ralentit. Inutile de dire ce que je préfère. »
Un jour d’octobre, « à des fins psychologiques », elle raconte « un soir de pluie et de vent » où elle n’a pas trouvé Leonard à la gare. Folle d’angoisse, surtout après l’arrivée du dernier train qu’il était censé prendre, incapable d’attendre, elle décide de se rendre à Londres. A peine le billet acheté, voilà Leonard, « plutôt gelé et d’assez mauvaise humeur » – elle va se faire rembourser et pendant qu’ils rentrent, elle se dit : « Dieu merci, c’est fini. J’en suis sortie. Terminé. » L’expérience a été si étrange et intense qu’elle en souffrira quelques jours, elle a senti « comme une menace latente ».
3 janvier 1924 : « Demain je monte à Londres, à la recherche d’une maison. » Le 9, elle signe un bail de dix ans pour le 52, Tavistock Square : « Londres, tu es le joyau des joyaux, le jaspe de la gaieté. »* – musique, conversations, amitiés, panoramas de la ville, livres, éditions, un je ne sais quoi d’essentiel et d’inexplicable, tout cela est maintenant à ma portée, alors que j’en ai été privée depuis août 1913, lorsque nous avons quitté Clifford’s Inn pour une série de catastrophes qui faillirent mettre fin à mon existence et qui, j’ose le penser, auraient fait le malheur de Leonard. » (* William Dunbar, Hommage à la Cité de Londres)

Tavistock Square
Les Woolf se réinstallent à Bloomsbury à la mi-mars, dans cette grande maison de quatre étages où ils occupent les deux derniers, des avocats louant le reste, et la Hogarth Press le sous-sol. 5 avril : « Pourquoi tant aimer cette ville ? Elle est pourtant cruelle et son cœur est de pierre. » Les commerçants ne les connaissent pas, il faut s’habituer au bruit. Le Journal en pâtit, les notes s’espacent. Et puis, l’euphorie revient : « Londres vous ensorcelle. J’ai l’impression de poser le pied sur un tapis magique, de couleur fauve, et d’être aussitôt transportée en pleine beauté, sans même bouger un doigt. Les nuits sont étonnantes, avec tous ces portiques blancs et les larges avenues silencieuses. »
Les Heures l’accaparent – « Et j’apprécie de pouvoir l’écrire à Londres, un peu parce que, comme je l’ai dit, toute animation me soutient, et parce qu’avec mon cerveau d’écureuil en cage, c’est une bonne chose que d’être empêchée de tourner en rond. Et puis je gagne infiniment à rencontrer des êtres humains quand je veux, sans attendre. Je puis entrer ou sortir en flèche, échapper ainsi à ma stagnation. » – « Leonard n’apprécie pas tellement que je me poudre le nez et que je dépense pour ma toilette. Tant pis ! J’adore Leonard. »
Vita et elle sont de plus en plus proches. Son père l’invite à Knole en juillet – « Sa Seigneurie habite au cœur d’un énorme gâteau. » « Tous ces ancêtres et ces siècles, tout cet argent et cet or ont produit un corps parfait. Vita fait penser à un cerf ou à un pur-sang – sauf le visage, avec sa lippe ; elle n’est pas non plus d’une intelligence très vive. Mais pour ce qui est de son corps, il est parfait. » Virginia trouve sa nouvelle Séducteurs en Equateur « assez intéressante. Il est vrai que j’y vois mon propre visage. » « Oui, je l’aime bien, je la prendrais bien dans ma suite de façon permanente (…) »
Mrs. Dalloway se termine – « Elle était là. » Au printemps 1925, les Woolf se rendent à Cassis. Au retour, Virginia replonge dans le courant, écrit, lit : « Ce qu’il y a de remarquable chez Proust, c’est cette combinaison d’extrême sensibilité et d’extrême acharnement. (…) Il est aussi solide qu’une corde de violon et aussi subtil que la poussière des ailes du papillon. » Certaines préoccupations reviennent. La mort : « J’aimerais quitter la pièce tout en parlant ; inachevée, une phrase banale resterait en suspens sur mes lèvres… » L’argent : « J’ai entrepris de gagner trois cents livres avec ma plume cet été, de quoi installer une salle de bain à Rodmell et un fourneau bouilleur. » Le succès de Mrs. Dalloway la rend plus dépensière : robe, collier de verroterie, nouvelles bottines pour se promener dans la campagne.
Un mal de gorge, un rhume, et elle se réfugie « au plus profond de (sa) vie, c’est-à-dire de cette entière confiance entre L. et (elle) » où reprendre des forces. En décembre, elle s’impatiente : aucun signe de Vita. Le 21, après trois jours à Long Barn avec Leonard : « J’aime Vita. J’aime être avec elle, j’aime son opulence (…) Bref, elle est ce que je n’ai jamais été : une vraie femme. » Vita fera naître Orlando, « jeune noble ».
Elle lui écrit si souvent que le Journal de 1926 ne commence que le 19 janvier, et le nouveau cahier, le 8 février, toujours en vue de ses mémoires – « A soixante ans j’entreprendrai d’écrire ma vie. » Virginia Woolf travaille à La promenade au phare : « j’écris maintenant plus vite et plus librement qu’il ne m’a jamais été donné de le faire dans toute ma vie ».
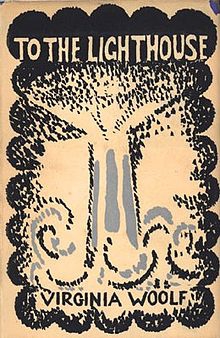
Le Journal de 1927 sera encore plus court, et aussi ses cheveux coupés : « J’ai pour la vie les cheveux courts. » Voyages à Cassis, en Italie. L’enthousiasme de Nessa pour La promenade au phare l’émeut : « Elle dit que c’est un portrait étonnant de notre mère ; par un portraitiste suprême. » Virginia se réjouit d’être enfin prise au sérieux, de peut-être devenir « un écrivain célèbre ». Elle dispose de son « premier argent personnel » et les Woolf, de leur première automobile. « Un automne très heureux. »
Relire le Journal de Virginia Woolf – 6
Relire le Journal de Virginia Woolf – 5
Relire le Journal de Virginia Woolf – 4
Relire le Journal de Virginia Woolf – 3
Relire le Journal de Virginia Woolf – 2
Relire le Journal de Virginia Woolf – 1
 Sur un mur du château de Grignan, une œuvre d’Andrea Mastrovito a pris place en 2015 : The unnamed feeling (L’indicible sentiment).
Sur un mur du château de Grignan, une œuvre d’Andrea Mastrovito a pris place en 2015 : The unnamed feeling (L’indicible sentiment).