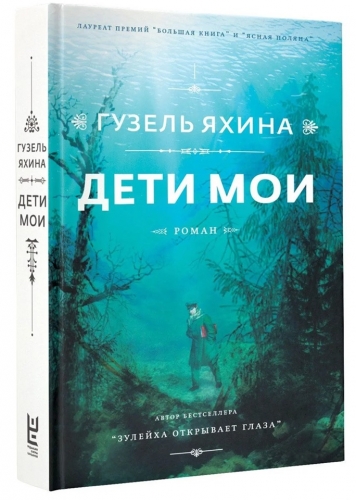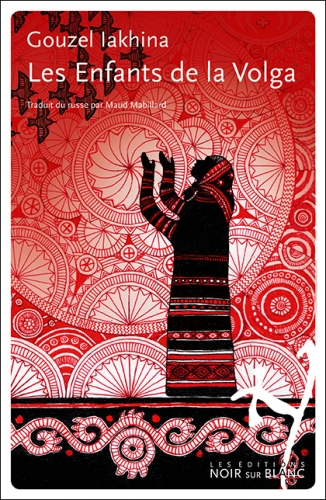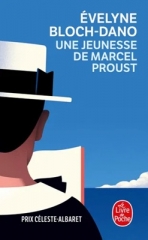Que des Allemands aient été invités à cultiver sur les rives de la Volga par Catherine II, dans les environs de Saratov, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, que leur territoire soit devenu une république socialiste soviétique florissante puis soumise aux réquisitions, à la guerre, à la famine, et ses habitants finalement déportés en 1941 par Staline vers la Sibérie ou le Kazakhstan, je l’ignorais avant de lire la note liminaire de Gouzel Iakhina aux Enfants de la Volga (2021, traduit du russe par Maud Mabillard).
Ce roman passionnant que la romancière russe (née en 1977) a dédié à son grand-père, « enseignant d’allemand dans une école de village », s’il suit cette trame historique, raconte d’abord l’histoire d’un village au bord du fleuve, Gnadenthal – la steppe sur la rive gauche, des montagnes sur la rive droite : « La Volga divisait le monde en deux. » Ou plus exactement l’histoire d’un maître d’école, le « Schulmeister Jakob Ivanovitch Bach », qui vit sans bruit mais écoute le « vaste monde ».
Chargé de sonner la cloche à six heures, à midi et à vingt et une heures, il repeint au printemps le cadre des fenêtres et la porte de l’école dans un bleu ciel lumineux, enseigne quatre heures le matin et deux heures l’après-midi (la poésie allemande est sa passion), avant de faire ses « visites » à la Volga ou à Gnadenthal, en alternance, curieux de tout, choses et gens. Seules les tempêtes troublent sa vie calme : il les aime et sort, exalté, quand les éléments se déchaînent.
Un jour, il est invité sur l’autre rive par un riche fermier, Udo Grimm, qui lui envoie un bon rameur kirghize pour traverser le fleuve. Il veut que Bach instruise sa fille de presque dix-sept ans, Klara, mais sans la voir : elle restera cachée derrière un paravent. Bach ne veut pas de ces conditions et repart, mais soudain tout le retient sur la rive droite, les éléments l’empêchent de retraverser la Volga et lui font rebrousser chemin. La voix timide et sensible de son élève finira par le captiver et ces mots dans le livre qu’il lui a glissé sous le paravent pour l’entendre lire : « Ne m’abandonnez pas. »
Ainsi naît la belle histoire d’amour de Bach, 32 ans, pour la jeune Klara. L’annonce du départ des Grimm pour l’Allemagne le terrasse. Mais un soir, Klara, d’une beauté « aveuglante », est à sa porte et va vivre désormais sous sa protection. Le pasteur refuse de les marier, les villageois veulent renvoyer le maître d’école. Quand Klara s’enfuit, il la suit sur l’autre rive, dans la ferme laissée par son père. Ils finissent par y dormir ensemble sous l’édredon, bientôt le désir d’enfant la mine. De l’autre côté de la Volga, la guerre sévit et avec elle viennent la folie, la faim, les cadavres abandonnés. Bach prie avant de les jeter dans le fleuve.
L’intrusion de trois hommes à la ferme, un jour, va changer leur vie. Ils finissent par trouver Klara cachée sous le lit et abusent d’elle. Bach en devient mutique. A Gnadenthal, on célèbre la naissance de la République socialiste soviétique des Allemands de la Volga. Klara est enceinte, sans que Bach sache de qui ; elle accouchera d’une fille. Bach vivait pour Klara. Quand celle-ci meurt, la nouvelle-née n’a plus que lui.
Il doit retourner au village pour lui ramener du lait. Surpris à en voler dans une étable, il est amené devant le commissaire Hoffmann, le délégué du nouveau pouvoir, un bossu épris de littérature et de culture populaire. Bach ne parle pas mais écrit, dans une belle calligraphie allemande, qu’il a besoin de lait. Hoffmann lui en donnera en échange de vieux dictons, de textes sur la vie quotidienne des colons allemands, et finalement de contes de son invention.
Le résumé de ces péripéties ne dit rien de ce qui enchante le lecteur des Enfants de la Volga : l’évocation poétique des paysages, des saisons, des émotions de Bach. Travailleur, il s’occupe de la ferme, de la petite Anna, puis d’un jeune voleur qui dit s’appeler Vaska. L’ancien maître d’école ignore tout un temps qu’Hoffmann, le propagandiste, retouche ses contes en les signant Hobach dans un journal. Bach finit par remarquer que « ce qu’il écrivait se réalisait », les bonnes choses et aussi les mauvaises…
Un souffle épique traverse le destin de Bach et de ses enfants, sa fille et son « fils adoptif ». La manière dont il les éduque et dont ils lui échappent peu à peu fait le sel de ce récit où les années de malheur finissent par se succéder pour les riverains du fleuve. Bach tombe et se relève, possédé par son amour paternel sans limite, sa peur pour eux – il ira jusqu’au bout de ses forces. Gouzel Iakhina a écrit un roman formidable où la force des sentiments, la beauté de la nature tiennent tête aux réalités du monde et de l’histoire. Je vous le recommande.