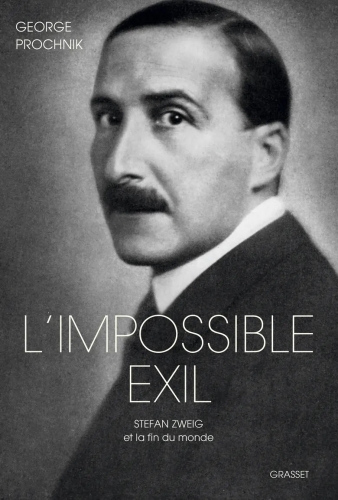On retrouve Nathan Zuckerman, le double de fiction de Philip Roth (1933-2018), dans son roman La Contrevie (1986, nouvelle traduction de l’anglais (Etats-Unis) par Josée Kamoun, 2004). « Fabriquer de la fausse biographie, de la fausse histoire, confectionner une existence à demi imaginaire à partir de la vraie pièce de théâtre qu’est ma vie, c’est ma vie. Il faut bien qu’il y ait un certain plaisir à faire ce métier, et c’est là-dedans qu’il se trouve. Aller déguisé. Jouer un personnage. Se faire passer pour ce que l’on n’est pas. » (L’art de la fiction) Le lecteur aussi y prend plaisir, tant il lui en fait voir de toutes les couleurs (à Zuckerman & au lecteur).
D’abord il s’agit d’Henry, le frère de Nathan, un dentiste, qui souffre d’un problème cardiaque. Le traitement lui permet de vivre normalement, excepté les troubles de l’érection qui ne lui permettent plus de rapports satisfaisants ni avec Carol, sa femme, ni avec son assistante. Le médecin déconseille l’opération, risquée, mais Henry ne supporte pas, à trente-neuf ans, de vivre sans sexe.
Sans transition, voici Zuckerman dans le New Jersey, avouant à sa belle-sœur qu’il n’est pas arrivé à composer d’éloge funèbre. Il a passé la nuit à écrire non le discours attendu mais ce que lui a raconté Henry : d’abord sa liaison avec Maria, une patiente qu’il aimait vraiment, puis avec son assistante. Nathan l’avait enguirlandé d’envisager l’opération : Henry et Carol ont trois enfants. Devant le cercueil, il se rappelle « le gosse de dix ans, en pyjama de flanelle », qui était sorti une nuit et avait marché pieds nus jusqu’au carrefour, où heureusement un ami de la famille avait aperçu le « petit somnambule ».
Zuckerman est surpris, lorsque Carol prend la parole à la cérémonie, de l’entendre dire, pour que tout le monde le sache et peut-être pour atténuer « la violence de ce coup terrible », qu’Henry aurait très bien pu vivre sans se faire opérer, mais qu’il n’avait pas accepté le traitement qui « l’avait radicalement affecté dans sa virilité » : il voulait « retrouver la plénitude et la richesse » de leur relation de couple. » Il en était mort.
La veille au soir, Nathan avait relu ses notes sur son frère. Carol ne se doute pas des confidences que son mari lui avait faites sur Maria, sa patiente devenue comme « son autre épouse », finalement rentrée dans sa famille à Bâle, puis sur Wendy, une « jeune blonde menue » de vingt-deux ans, devenue son assistante et sa maîtresse – elle avait insisté sur l’importance de la bouche à Henry dès son entretien d’embauche...
Au chapitre 2, « La Judée », Zuckerman arrive en Israël où il n’est venu qu’une fois, en 1960, pour un débat sur « le Juif dans la littérature ». Dix-huit ans plus tard, il prend contact à son arrivée avec Shuki, qui avait été l’attaché de presse de Ben Gourion et le lui avait fait rencontrer. Nathan se souvient surtout du père de Shuki, alors encore ouvrier soudeur à Haïfa, stupéfait qu’il ne veuille pas rester en Israël, et de leur discussion passionnée.
On est surpris de lire ensuite que, huit mois après un pontage réussi, Henry Zuckerman avait encore « des crises de désespoir terrible », une dépression en lien avec l’opération – le médecin les avait mis en garde, Carol et lui. Parti faire de la plongée avec des amis à Eilat, sur la côte, des vacances « thérapeutiques », Henry était resté en Israël au lieu de continuer jusqu’en Crête avec eux. A Jérusalem, « il avait connu l’expérience qui avait changé sa vie. » Cinq mois plus tard, « il n’était toujours pas rentré. »
Nathan ne vit plus à New York mais à Londres, marié à une Anglaise, Maria, divorcée de son ex-mari trop indifférent à leur petite Phoebe, dès sa naissance. Inquiet du sentiment anti-israélien des amis anglais de Maria, Nathan s’est laissé rassurer par sa réaction – « C’est des conneries » – et par sa virulence à les contredire. Il est en Israël pour découvrir ce que fait son frère dans une colonie à Agor, dans les montagnes de Judée, où il a suivi Mordecai Lippman, son « héros » sioniste (que Shuki considère comme un abruti quasi fasciste).
Les impressions de Zuckerman au Mur des Lamentations ne manquent pas d’intérêt. Il y rencontre un jeune Américain qui se dit « son plus fervent admirateur ». Quant à Henry, désormais Hanoch, il le retrouve à l’école hébraïque de la colonie d’Agor. On interroge le frère écrivain sur ses impressions, sur le sionisme ; il répond à tous sans détours, discute avec Lippman, dit son désaccord total avec le choix de la force pour contrer les pierres jetées aux Juifs par les Arabes. Henry ne comprend pas que son frère aîné doute de son bonheur d’être là, avec des gens qui « font l’Histoire ».
On découvre ensuite le rocambolesque retour en avion de Nathan Zuckerman, sans son frère convaincu de construire là-bas « une contre-vie ». Comment la maladie du cœur le touche à son tour et le met devant le même choix entre impuissance ou opération. Comment on découvre le vrai et le faux de tout ce qui nous a été raconté précédemment. Mais ne « divulgâchons » pas.
Les vives discussions au sujet des Juifs et d’Israël dans La Contrevie n’encouragent pas à l’optimisme. Elles sont d’autant plus percutantes à lire en cette année « d’horreur au Proche-Orient » (voir l’analyse de Mona Chollet sur son blog). L’auteur donne la parole à toutes les parties et son héros exprime un point de vue radicalement critique. Philip Roth fait preuve encore une fois dans ce roman tragi-comique d’une verve phénoménale. Comme l’écrit Michel Braudeau dans Le Monde, « L’écrivain se porte à lui-même la contradiction. Un cabinet de magie digne de Nabokov. »