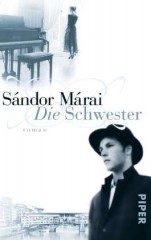Purge a révélé Sofi Oksanen. La romancière, de mère estonienne et de père finlandais, ressuscite à nouveau les années sombres de l’Estonie occupée dans son dernier roman, Quand les colombes disparurent (Kun kyyhkyset katosivat, traduit du finnois par Sébastien Cagnoli, 2013). Des cartes aident à situer l’action dans la « RSS d’Estonie (aujourd’hui république d’Estonie) », à Tallinn et aux environs, entre 1941 et 1966.

Les noms des personnages sont des repères précieux pour s’y retrouver dans cette intrigue morcelée et non chronologique où chaque séquence s’ouvre sur un timbre daté en vignette près de l’indication du lieu. Roland et son cousin Edgar portent en 1948 la chemise de l’armée finlandaise pour reconquérir leur pays, l’Estonie, contre l’Armée rouge. Roland rêve de voir les hommes de son pays porter un uniforme estonien et aucun autre. Par prudence, il a détruit le portrait de Rosalie, sa fiancée ; Edgar, lui, ne semble guère penser à sa femme Juudit.
« Mon cousin bénéficiait de beaucoup d’indulgence parce qu’il était une grande gueule invétérée. » Edgar a quitté l’Armée rouge (il parle couramment le russe) pour rejoindre les patriotes dans leur combat contre l’occupant ; nerveux sur le champ de bataille, il fomente des tas de plans d’avenir. Roland, lui, s’est donné en secret pour devoir de noter « des preuves des ravages commis par les bolcheviks » qui lui serviront quand la paix reviendra.
En 1941, Edgar porte encore l’uniforme russe quand Juudit subit la destruction de Tallinn avant l’arrivée des Allemands. Elle n’a pas voulu suivre sa belle-mère à la campagne, dans la ferme des Arm, où Rosalie continue à traire les vaches malgré la terreur. Presque toute sa famille s’est réfugiée chez la tante Leonida – « dans des moments pareils, il était bon d’être entouré de ses proches. »
Juudit, dans la guerre, souffre surtout du désastre de son mariage. Elle joue le rôle de l’épouse assagie devant tout le monde, alors que son mari n’a d’égards pour elle qu’en public et ne la touche quasi plus depuis leur nuit de noces, « un calvaire ». Une bombe sur la tête et tout s’arrangerait, mais Tallinn « branlante, brûlante et fumante » reste debout : « Juudit était en vie et l’Armée rouge s’était évanouie. » Place à la Wehrmacht accueillie sous une pluie de fleurs.
« Juudit ne voulait pas rencontrer de femmes qui parleraient du retour de leurs maris à la maison, ou dont les fiancés, pères et frères étaient déjà sortis des forêts ou avaient déserté des troupes rouges d’Estonie ou du golfe de Finlande. » Même à Rosalie, elle n’ose parler de ses problèmes intimes, comme si elle était fautive. Ni au médecin, consulté pour se rassurer sur sa santé : « Chère madame, vous êtes née pour enfanter. »

Roland s’étonne du comportement d’Edgar : celui-ci n’a plus de véritable raison de se cacher, d’autres déserteurs de l’Armée rouge se montrent à présent au grand jour. Pour quelle raison s’est-il doté d’une nouvelle identité ? Il s’appelle Fürst à présent, un nom à consonance allemande, et continue à lire ses journaux pendant que lui donne un coup de main à l’écurie.
Edgar, opportuniste, finit par lui parler de son projet d’entrer dans la police, du travail facile et qui permettra d’éviter l’enrôlement dans l’armée allemande. Il encourage Roland à faire de même, mais celui-ci a d’autres projets qu’il se garde bien de confier à quiconque. Il continue à collecter des informations précieuses et à organiser ses notes, il va se faire engager au port pour ne pas trop s’éloigner de Rosalie et il compte sur la fausse date de naissance de ses papiers au cas où l’armée viendrait y recruter.
Comment on se débrouille, comment on souffre dans la guerre, sous l’occupation, en ville, à la campagne, c’est ce que raconte Quand les colombes disparurent. Les uns résistent, d’autres collaborent, beaucoup disparaissent. Les femmes paient leur tribut à la guerre, Rosalie d’abord, morte dans des circonstances que personne ne veut décrire à Roland. Il persuadera Juudit de faire connaissance avec un officier allemand, un contact utile, mais voilà qu’elle se trompe d’homme et, pire, tombe vraiment amoureuse de Hellmuth, un SS-Hauptsturmführer qui la traite avec douceur et rend sa vie plus confortable – pour combien de temps ?
Vingt ans plus tard, Edgar a encore retourné sa veste. Devenu le « camarade Parts », il est chargé d’écrire des ouvrages d’histoire – de la propagande soviétique – à partir des documents qu’on lui fournit. Lorsqu’il reconnaît dans un carnet en moleskine l’écriture de son cousin Roland Simson, il sait qu’il tient une piste prometteuse, essentielle pour son avenir. Il le croyait mort, il faut absolument qu’il le retrouve.
En contraste avec Roland, le juste, et Juudit, la souffrante (son personnage le plus fort aux yeux de Sofi Oksanen), Edgar, prêt à tout pour être du côté du pouvoir quel qu’il soit, est la figure la plus odieuse du roman, un labyrinthe où l’on se perd régulièrement, comme dans la forêt estonienne, avant de retrouver le fil de l’histoire, une histoire sombre et douloureuse qui ne laisse personne indemne.