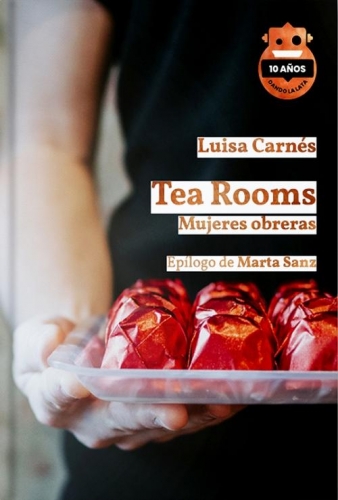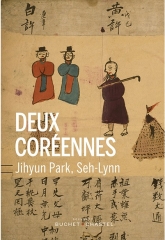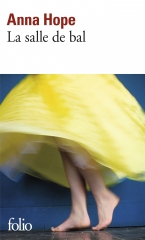Dès les premières pages de Tea rooms. Femmes ouvrières de Luisa Carnés (traduit de l’espagnol par Michelle Ortuno), j’ai reconnu Matilde, la jeune femme qui passe un entretien d’embauche dans un bureau, une des nombreuses candidates « de styles et d’âges des plus variés » à s’y présenter, puis à rentrer chez elle après avoir donné les dix centimes qui lui restent à l’achat d’un beignet chaud plutôt qu’à prendre le tramway, malgré la pluie qui s’infiltre dans ses chaussures usées. Comme je n’en avais pas parlé ici, j’ai relu ce roman trop longtemps ignoré.
Sur des palissades, on a écrit « Ouvriers ! Préparez-vous à lutter contre la guerre impérialiste ! » Chez elle, Matilde trouve « la grande pagaille de ses frères et sœurs » mais aucune odeur de cuisine, sa mère n’a rien préparé. Une enveloppe est arrivée : un certain M. F. de l’agence Rik demande à Matilde son portrait, son âge et si elle vit avec sa famille à Madrid – « Sale type » réagit-elle, alors que sa mère n’a pas compris le piège. A six, ils partagent un bout de fromage.
Ce roman publié en 1934 n’a été traduit en français qu’en 2021, dans la collection La Sentinelle qui porte « une attention particulière aux histoires et parcours singuliers de gens, lieux, mouvements sociaux et culturels ». Presque un siècle plus tard, on voudrait croire qu’en Europe en tout cas, les droits sociaux sont mieux respectés, que la faim n’est plus un problème, mais La Libre rappelait il y a peu la 12e place de la Belgique dans un classement récent sur la pauvreté infantile, avec même 21% d’enfants pauvres en région bruxelloise !
Dans son roman. Luisa Carnés n’hésite pas à opposer les conditions de vie des femmes riches et des pauvres : au printemps, les premières pensent à renouveler une partie de leur garde-robe, les autres craignent le soleil qui va éclairer davantage leurs chaussures informes et les défauts de leur tenue. Devant le salon de thé bien fréquenté où s’arrête Matilde, elle retrouve cette division entre « ceux qui utilisent l’ascenseur ou l’escalier principal » et « ceux de l’escalier de service ». A l’intérieur, entre les petites tables, des serveurs en frac, des femmes en blouse noire – « Qu’est-ce que ça sent bon là-dedans ! »
Matilde va y travailler, sous les ordres d’Antonia : nettoyer les tiroirs du comptoir, y disposer des ensaimadas et les compter, dépoussiérer, couper droit le papier, empaqueter et faire le nœud coulant autour des boîtes… Pas de temps mort, il y a toujours quelque chose à faire. Peu à peu, elle découvre la clientèle qui varie selon le jour ou l’heure, elle observe les autres employés, leur caractère, leur façon de faire. Dans le salon, l’hygiène est strictement observée, mais dans le réduit où les filles de service se changent pour se mettre en uniforme, ça sent mauvais, un « nid à punaises et à cafards ».
Tea rooms raconte leur quotidien au travail, les rivalités et les ententes, la précarité de leur situation : celle qui a sursauté devant la clientèle du dimanche – « une souris ! » – est renvoyée le soir même, elle n’aura plus qu’à se prostituer pour survivre. Au dehors aussi, l’agitation s’amplifie, on chante L’Internationale, il y a des émeutes, les forces de l’ordre sont de plus en plus visibles dans les rues. La grève menace.
Au salon de thé, deux « nouvelles » n’ont pas le même statut. Laurita, une parente du chef, qui adore le cinéma, les acteurs, les belles robes, qui aime montrer ses jambes, a tout de suite les faveurs de la responsable et tutoie tout le monde. Marta, une jolie jeune fille misérable qui a osé s’adresser directement à « l’ogre » – elle avait besoin de travailler immédiatement, sa famille n’ayant plus de quoi la nourrir –, se nourrit en cachette de restes que lui donne Antonia, qui l’a prise en pitié. Un jeune livreur n’a d’yeux que pour Matilde, mais celle-ci n’est pas du tout attirée par le mariage ou la vie de femme au foyer – « il y a aussi des femmes qui prennent leur indépendance, qui vivent de leurs efforts, sans avoir besoin de « supporter des types » ».
Luisa Carnés (1905-1964), écrivaine et journaliste engagée, dénonce l’exploitation sociale dans Tea rooms à travers le travail quotidien des ouvrières confrontées à des problèmes de toutes sortes. Dans le Madrid des années 1930 où la révolte s’organise, certaines, comme Matilde, rêvent de s’émanciper. Arts Libre annonçait hier la sortie, chez le même éditeur, de La femme à la valise, onze nouvelles « glaçantes » sur l’Espagne de la fin des années 1930, sous Franco, publiées entre 1945 et 1955 au Mexique où l’autrice s’était réfugiée en 1939 – des récits « qu’il n’est pas vain de lire en ces temps troublés. »