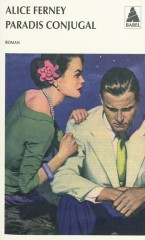La Nora d’Ibsen, à la fin de Maison de Poupée, quitte mari et enfants : « Je crois qu’avant tout je suis un être humain, au même titre que toi, dit-elle à Torvald, ou au moins que je dois essayer de le devenir. » J’ai pensé à ce personnage en refermant Les vendredis de Vincent, le premier roman de Verena Hanf, dont l’héroïne, d’origine marocaine, porte le même prénom et va se retrouver elle aussi, à vingt-trois ans, face à un choix.
Nora est l’aînée, la fille modèle aux yeux de ses parents venus s’installer en Belgique. Son père n’y a jamais trouvé de vrai boulot, sa mère a travaillé comme femme de ménage pour assurer la situation de leurs trois enfants. Pour permettre à son frère Samir de poursuivre des études supérieures, Nora a renoncé aux siennes et gagne sa vie comme aide-ménagère. « Je n’aime pas aller chez de nouveaux clients. Je ne sais pas ce qui m’attend. Peut-être qu’ils ont un chien. J’ai peur des chiens. Ils aboient, ils puent. Ils tournent autour de moi. J’ai dit à Bernard, mon chef, que je n’irai pas chez des gens qui ont des chiens. Les chats je n’adore pas non plus d’ailleurs, mais bon, je les supporte. Mieux que les chiens, même mieux que les gens bizarres. »
Sa sœur Sara, seize ans, a été tout de suite de son côté quand, lors d’un séjour au Maroc, à l’heure de la sieste, elles ont entendu une tante conseiller à leur mère de marier sa fille aînée : « Faut pas trop attendre, tu sais, pas qu’elle tombe amoureuse d’un blondinet. » Sara, Nora le sait, porte des rêves encore plus forts que les siens. Dans son agenda, elle a lu ces mots : « Je veux être femme, sans contrainte aucune, je veux vivre, aimer, goûter à tout. M’envoler au-delà du bleu, m’enfuir, vivre. »
117, rue des Roses. Nora se demande à quoi s’attendre chez le nouveau client qui fait appel à ses services, Vincent Vermeersch. Tant de gens sont bourrés de préjugés – « Ils ne sont pas vraiment méchants, juste ignorants, juste craintifs. » Mais il y a aussi des clients « ouverts, gentils, attachants ». Celui qui lui ouvre la porte a des yeux « vert-lac-de-montagne » si brillants que la tête lui en tourne. Désormais, elle va le retrouver tous les vendredis, pour trois heures de ménage, dans une maison qui sent bon le tabac et le bois. Un jour qu’elle attend avec de plus en plus d’impatience. Les cheveux bien lavés sous son voile, des vêtements choisis, pas trop chic, mais seyants, même si dans sa tête une voix rappelle que « de toute façon, c’est un blondinet, non-musulman, non-envisageable, non épousable, point barre ».
La maison de Vincent est pleine de CD, il aime la musique. Attentionné, il la complimente un jour pour son beau sourire, elle en rougit – « On ne dit pas ça comme ça à une femme voilée ». Lui propose chaque fois un petit café avant de commencer, qu’elle refuse. Un jour où il est sorti pendant qu’elle nettoie, elle chante en passant l’aspirateur, « à faire trembler les murs ». Vincent est rentré sans qu’elle l’entende : « Incroyable, votre voix, vraiment incroyable. Vous prenez des cours ? »
C’est seulement le septième vendredi que Nora accepte de boire un café avec Vincent. Son amie Laurence l’y a encouragée, puisque en Belgique où elle vit depuis qu’elle est bébé, ce n’est pas un crime de boire un café avec un client, par politesse,
et que cet homme lui plaît. Nora porte le voile pour faire plaisir à ses parents, même si ma mère n’en portait pas quand elle a commencé à travailler, mais aujourd’hui, dans certains quartiers de Bruxelles, « on se fait presque mal voir si, en tant que Marocaine, on n’en porte pas. Ma mère ne sort plus sans voile. » Nora s’est habituée à le porter aussi, « ça sécurise ». Autour d’un café, Vincent et Nora se découvrent : il compose de petites mélodies publicitaires, préférerait se consacrer à de la musique de qualité. Il l’encourage à se présenter à l’Académie, avec une telle voix, parle en passant de sa copine – Nora cache son désappointement comme elle peut.
Ce qu’elle redoutait le plus se produit : un soir, sa mère lui annonce la visite d’un oncle de Tetouan, qui tient à lui présenter Hicham, le fils d’un voisin, un bon parti, « travailleur, dégourdi, pas moche ». Nora admire ses parents, des gens « bons et intelligents », mais comment leur faire comprendre qu’elle veut se choisir un mari elle-même ? Il le faudra pourtant, Vincent a rompu avec sa petite amie, lui a avoué ne rêver que d’elle. Bonheur d’être amoureuse, bonheur d’être aimée. Quand elle se décide à parler de Vincent chez elle, ses parents sont abasourdis, inquiets, furieux surtout de sa résistance. « Faut que tu l’oublies, Nora. »
Née en Allemagne de père allemand et de mère égypto-libanaise, Verena Hanf, qui a étudié en Belgique, retrace avec simplicité et justesse la condition d’une jeune femme, fille d’immigrés, entre deux cultures. Famille, religion, traditions, comment les concilier ? Comment être soi-même ? Les vendredis de Vincent, c’est un portrait de femme au moment crucial où elle choisit son avenir, non sans douleur. La couverture choisie par les Editions du Bord du Lot, la photo d’une jeune fille voilée, n’est pas des plus heureuses, trop réductrice pour ce récit d’une centaine de pages qui recrée avec authenticité, en mots de tous les jours, le parcours et les états d’âme d’une Nora en qui tant d’autres jeunes femmes se reconnaîtront, quand l’amour s’invite dans leur vie et bouscule leurs repères.
(entre-deux)