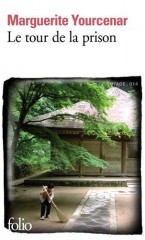Siri Hustvedt, dont je vous ai déjà présenté Les yeux bandés et L’envoûtement de Lily Dahl, a choisi un homme comme narrateur dans Elégie pour un Américain (The Sorrows of an American, 2008). Un psychiatre. Lars Davidsen, son père, vient de mourir. En triant ses papiers avec sa sœur Inga, il tombe sur une lettre signée Lisa : « Cher Lars, je sais que tu ne diras jamais rien de ce qui s’est passé. Nous l’avons juré sur la BIBLE. Ca ne peut plus avoir d’importance maintenant qu’elle est au ciel, ni pour ceux qui sont ici sur terre. J’ai confiance en ta promesse. » Que « Pappa » leur ait caché des choses ne les étonne pas trop. Inga, qui a perdu son mari cinq ans plus tôt, est particulièrement curieuse de découvrir de qui et de quoi il s’agit. Erik Davidsen, divorcé, se plonge pour sa part dans la lecture des Mémoires de son père.

De retour chez lui à Brooklyn, assis devant son bureau, il aperçoit par la fenêtre une jeune femme et une petite fille qui traversent la rue, devine « de possibles locataires pour le rez-de-chaussée » de sa maison. Miranda, la mère, d’origine jamaïcaine, a « une allure superbe » ; Eglantine, la fillette, s’exclame en le voyant : « Regarde, maman, c’est un géant ! » Le logement leur convient. « Je les regardai descendre les marches du perron, revins sur mes pas dans le vestibule et m’entendis murmurer : « Je me sens si seul ». (…) Telle est l’étrangeté du langage : il traverse les frontières du corps, il est à la fois dedans et dehors, et il arrive parfois que nous ne remarquions pas que le seuil a été franchi. »
Si son divorce l’a convaincu d’avoir été « un mari raté », le Dr Erik Davidsen estime avoir réussi en tant qu’oncle : ces cinq dernières années, depuis la mort de Max Blaustein, son beau-frère, un romancier reconnu, il est particulièrement proche d’Inga et de Sonia, sa nièce, encore hantées par les images du 11 septembre à New-York. Il a toujours veillé sur sa sœur, qui, petite, était sujette à des crises, perdait conscience un instant, et que ces absences rendaient particulièrement vulnérable auprès de ses condisciples – « Inga, dinga ! » En grandissant, elle en a moins souffert mais est restée sujette à des migraines. Sur son insistance, il va chercher aussi de son côté à identifier la mystérieuse Lisa qu’a connue leur père.
Mais ses nouvelles locataires occupent de plus en plus ses pensées, la beauté de Miranda l’obsède – elle est illustratrice et il a aperçu chez elle un dessin fascinant. La petite fille cherche son contact. Lorsqu’un jour, en rentrant chez lui, il découvre sur le seuil quatre photos polaroïd de Miranda et Eggy dans le parc, sur lesquelles on a tracé des cercles barrés, il est surpris qu’elle lui demande simplement de les jeter, sans rien expliquer. « Quelqu’un épiait Miranda, et je me demandai si c’était quelqu’un qu’elle connaissait. »
La jeune femme reste sur la réserve, le psychiatre s’efforce de respecter les distances, conscient de fantasmer sur elle. Sa sœur, elle, est terriblement troublée par la visite d’une journaliste indiscrète qui se montre plus intéressée par la vie privée de Max Blaustein que par son œuvre et menace de dévoiler des lettres à une autre femme. Inga craint surtout pour Sonia et sa fille craint pour elle, toutes deux se confient à Erik, tour à tour. D’autres incidents amèneront Miranda à raconter au Dr Davidsen quelques pans de son passé et même un jour à lui confier, exceptionnellement, la garde de sa fille.
Elégie pour un Américain croise donc tous ces fils – lecture des écrits du père, soucis d’Inga et de Sonia, vie de Miranda et d’Eggy – entre lesquels s’insèrent des séances chez le psychiatre, où nous découvrons les obsessions de quelques-uns de ses patients en plus des siennes. La trame psychologique est une des plus intéressantes du récit, d’autant plus quand Erik Davidsen observe ses propres réactions. « Le matin, je m’éveillais sous un ciel lourd et, même s’il s’allégeait en général une fois que je me retrouvais avec mes patients, j’étais conscient d’être entré dans ce que l’on appelle, dans le jargon médical, l’anhédonie : l’absence de joie. »
Dans un de ses livres, sa sœur philosophe a écrit que « Le problème, c’est que nous sommes tous aveugles, tous dépendants de représentations préconçues de ce que nous pensons que nous allons voir. La plupart du temps, c’est comme ça. Nous ne faisons pas l’expérience du monde. Nous faisons l’expérience de ce que nous attendons du monde. Cette attente est très, très compliquée. » Quel regard portons-nous sur les autres ? sur nous-mêmes ?
Siri Hustvedt s’insinue dans les fissures de toutes ces personnalités, crée comme dans ses autres romans une espèce de suspens à propos de chacun des personnages et de leurs secrets. Ambivalence des rapports familiaux et amoureux, étrangeté des vies intérieures, la romancière excelle à nous tenir en haleine. De son style, on pourrait dire ce qu’elle écrit de la voix : « Je sais que ce qu’on dit est souvent moins important que le ton de la voix qui prononce les mots. Il y a de la musique dans un dialogue, des harmonies et des dissonances mystérieuses qui vibrent dans le corps comme un diapason. »