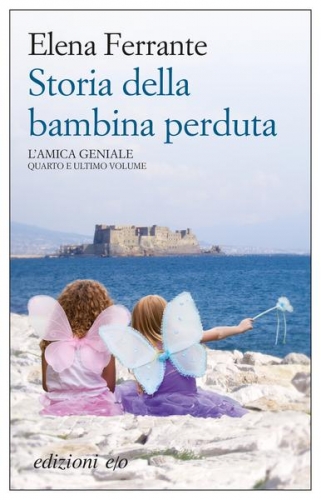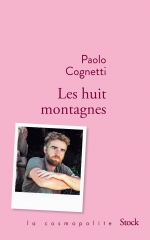Quatrième et dernier tome de L’amie prodigieuse après le premier tome éponyme, Le nouveau nom et Celle qui fuit et celle qui reste, L’enfant perdue d’Elena Ferrante mène à son terme l’histoire de Lenù (Elena) et Lila, les deux amies d’enfance napolitaines : maturité, vieillesse, épilogue.
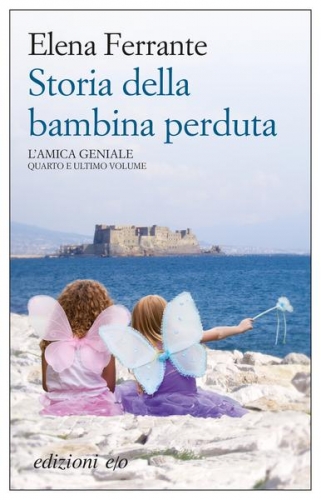
A Montpellier où elle s’est échappée avec Nino Sarratore (son amour de jeunesse, à présent son amant) qui y donne des cours, Elena Greco, trente-deux ans, comprend qu’être épouse et mère ne lui suffit pas. Furieux, Pietro Aireto (son mari) a confié Dede et Elsa, leurs filles, à sa mère. Ils ne veulent plus la voir. Alors Elena profite de son séjour en France pour aller à Nanterre où une petite maison d’édition va publier un de ses textes. Un couple d’amis français de Nino les héberge à Paris, Elena y est bientôt fatiguée des conversations incessantes et de la familiarité de Nino avec la Française. De toute manière, ils tombent d’accord sur le fait qu’ils doivent d’abord affronter chacun leur conjoint avant de commencer à vivre ensemble.
A Florence, Pietro s’absente pour le travail lorsqu’elle rentre, mais les filles d’Elena lui font bon accueil. Sa belle-mère essaie en vain de la convaincre de rester avec son mari, Elena rassemble ses affaires pour aller rejoindre Nino. Il lui a pris une chambre dans un petit hôtel à Naples, lui habite chez un collègue d’université près du Duomo. Avertie de son arrivée, Lila a déjà contacté Nino : elle veut les revoir, ce qui ne manque pas d’agacer Elena – Nino et Lila se sont aimés il y a longtemps – et son sentiment se confirme : très vite, Lila s’immisce entre eux. Elle insiste pour qu’Elena revienne vivre à Naples, lui fait rencontrer Antonio (le petit ami de son adolescence), qui la met en garde contre Nino : « S’il te fait mal à toi aussi, dis-le-moi. »
La mère d’Elena se déplace à Florence pour encourager une réconciliation, mais Elena est bien décidée à demander le divorce et la garde de ses filles. Après les avoir laissées un certain temps chez leur père, du fait qu’elle se déplace souvent pour ses conférences et pour rejoindre Nino ici ou là, elle décide de s’installer à Naples où celui-ci enseigne à l’université et d’y emmener les filles, d’autant plus qu’à Florence, Pietro s’est lié avec une étudiante.
Lila s’en mêle à nouveau et raconte à son amie d’enfance qu’elle a fait suivre Nino : contrairement à ce qu’il raconte à Elena, il n’a pas quitté sa femme et son fils et a obtenu la direction d’un important institut de recherche grâce à son beau-père. Acculé, Nino minimise les faits, reconnaît avoir menti et explique à Elena pourquoi il n’a pu faire autrement. Ecœurée, celle-ci se réfugie avec ses filles chez sa belle-sœur Mariarosa à Gênes.
Il est difficile de comprendre pourquoi Elena, même après avoir appris que la femme de Nino est à nouveau enceinte, accepte de vivre avec lui dans le grand appartement qu’il leur a loué à Naples, sinon pour échapper à son ancien quartier : « Depuis la Via Tasso, le quartier de mon enfance ne paraissait qu’un lointain tas de pierres blanchâtres, des détritus urbains au pied du Vésuve que rien ne distinguait. Et je voulais qu’il continue à en être ainsi : j’étais quelqu’un d’autre maintenant, et j’étais décidée à tout faire pour ne plus être aspirée par mon quartier. » Sera-ce possible avec Lila ?
Celle-ci, qui a lancé sa propre entreprise d’informatique, gagne très vite la sympathie des filles d’Elena. Quand Nino et elle ont l’occasion d’aller ensemble aux Etats-Unis, chacun pour son travail, c’est Lila qui va les garder et leur donner l’image de la mère idéale, même si les filles découvrent ainsi que Lila dort avec Enzo sans qu’ils soient mariés et qu’Enzo n’est pas le père de Rino, le fils de Lila, dont Dede tombe amoureuse. Puis les deux femmes se retrouvent enceintes toutes les deux : Elena, épanouie par la grossesse, est heureuse d’attendre un enfant de Nino, au contraire de Lila, malade et inquiète.
La troisième fille d’Elena s’appellera Imma (Immacolata, le prénom de sa mère) et celle de Lila, Tina (comme la poupée d’Elena tout au début de L’amie prodigieuse, quand les deux fillettes jouaient à la cave). L’une est blonde, l’autre brune. Tina sera une enfant précoce, au point qu’Elena aura des craintes à propos du développement de sa propre fille. Tremblement de terre, règlements de compte, affaires de famille, problèmes du quartier, tout le fonds napolitain de la saga d’Elena Ferrante reste bien présent dans l’histoire de cette amitié tumultueuse.
Elena doute constamment de sa réussite littéraire ; son travail d’écrivain et sa responsabilité de mère sont souvent en conflit et en pratique, c’est Lila, toujours Lila, qui lui permet de s’en sortir. Nino, le beau parleur, l’ambitieux, finira par confirmer sa mauvaise réputation et Elena, faute de moyens, devra tout de même retourner vivre dans son quartier. Le dernier volume de L’amie prodigieuse est, comme les précédents, riche en péripéties. La plus dramatique, annoncée en titre, est la disparition d’une fillette, qui va bouleverser la vie des deux femmes.
Curieuse de lire où Elena Ferrante conduirait ses héroïnes, j’ai pourtant été déçue par L’enfant perdue. Souvent prévisible voire peu vraisemblable, le récit est de plus en plus narratif et convenu, au détriment de l’analyse psychologique. Est-ce l’intention de la romancière de montrer les entraves de la vie de couple et de la maternité ? les embarras matériels au quotidien ? la déception amoureuse ? le doute permanent quant à sa valeur propre ? Est-ce de l’amitié entre Elena et Lila ou une rivalité obsessionnelle ? Est-ce dans la création littéraire qu’Elena trouve son bonheur ou dans les avantages qu’elle en tire ?
« Lila a raison, on n’écrit pas pour écrire, on écrit pour faire mal à ceux qui veulent faire mal. » Cette phrase reflète la violence que le roman décrit de bout en bout. Avec ce quatrième tome mélodramatique, dont je retiendrai l’un ou l’autre épisode marquant, comme le tremblement de terre en 1980 et les moments de « délimitation » de Lila, L’amie prodigieuse se termine sur une impression de désenchantement. Qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à me contredire si vous estimez, comme on peut le lire en quatrième de couverture, que cette saga « se conclut en apothéose ».
 « J’aimais ma ville, mais je me fis violence pour m’interdire de prendre automatiquement sa défense. Au contraire, je me convainquis que la déception dans laquelle finissait tôt ou tard tout amour pour Naples était une loupe permettant de regarder l’Occident tout entier. Naples était la grande métropole européenne où, de la façon la plus éclatante, la confiance accordée aux techniques, à la science, au développement économique, à la bonté de la nature et à la démocratie s’était révélée totalement privée de fondement, avec beaucoup d’avance sur le reste du monde. Etre né dans cette ville – écrivis-je même une fois, ne pensant pas à moi mais au pessimisme de Lila – ne sert qu’à une chose : savoir depuis toujours, presque d’instinct, ce qu’aujourd’hui tout le monde commence à soutenir avec mille nuances : le rêve du progrès sans limites est, en réalité, un cauchemar rempli de férocité et de mort. »
« J’aimais ma ville, mais je me fis violence pour m’interdire de prendre automatiquement sa défense. Au contraire, je me convainquis que la déception dans laquelle finissait tôt ou tard tout amour pour Naples était une loupe permettant de regarder l’Occident tout entier. Naples était la grande métropole européenne où, de la façon la plus éclatante, la confiance accordée aux techniques, à la science, au développement économique, à la bonté de la nature et à la démocratie s’était révélée totalement privée de fondement, avec beaucoup d’avance sur le reste du monde. Etre né dans cette ville – écrivis-je même une fois, ne pensant pas à moi mais au pessimisme de Lila – ne sert qu’à une chose : savoir depuis toujours, presque d’instinct, ce qu’aujourd’hui tout le monde commence à soutenir avec mille nuances : le rêve du progrès sans limites est, en réalité, un cauchemar rempli de férocité et de mort. »