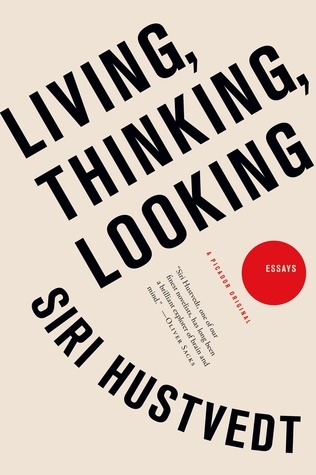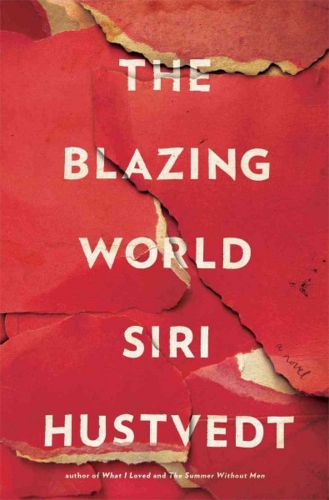Jeu savant et passionnant, Le Monde flamboyant de Siri Hustvedt (2014, traduit de l’américain par Christine Le Bœuf) pourrait passer pour un essai, à lire l’avant-propos signé I. V. Hess sur Harriet Burden, une artiste new-yorkaise retirée du monde de l’art après avoir exposé dans les années 1970-1980. En 2003, une lettre de Richard Brickman à une revue d’art révélait qu’Harry était l’auteur véritable de « Masquages », une formidable expérience artistique sur la façon dont l’œuvre d’art est perçue et valorisée.
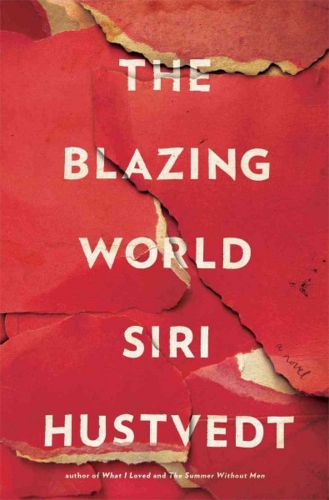
Trois hommes, de 1999 à 2003, ont accepté successivement d’exposer ses œuvres sous leur nom et de jouer le créateur pour le public et les médias : Anton Fish, Phinéas Q. Eldridge et Rune, avec un succès retentissant. Ainsi Harriet Burden a magistralement démontré le « préjugé antiféministe du monde de l’art » et les « rouages complexes de la perception humaine ». Nourrie de lectures philosophiques et théoriques, méconnue de ses contemporains, elle voyait en Margaret Cavendish, duchesse de Newcastle, intellectuelle excentrique du XVIIe siècle, son alter ego – d’où le titre du roman, que Siri Hustvedt lui a emprunté.
Ce début sérieux pourrait rebuter, et la structure fragmentée de cette fiction, mais au fur et à mesure que le puzzle de Siri Hustvedt donne chair à la vie de femme et au destin d’artiste de Harry Burden, c’est un roman captivant, bouleversant même. On fait connaissance avec elle juste après la mort de son mari, un riche marchand d’art, qu’elle a rencontré dans sa galerie à vingt-six ans (lui en avait quarante-huit) et qui s’écroule brutalement un matin, à la table du petit déjeuner.
Leurs enfants, Maisie et Ethan Lord, donnent leur point de vue de temps à autre dans le récit qui contient des lettres, des articles, des témoignages, et beaucoup de passages des carnets répertoriés alphabétiquement où Harry notait ses observations et réflexions. Dans la dépression du deuil, elle reprend goût à la vie grâce à une phrase du Dr Fertig qu’elle voit régulièrement : « Il est encore temps de changer les choses, Harriet. » A sa fille, après son déménagement à Brooklyn, elle dira : « Maisie, je me sens des ailes. »
Ce qui est étonnant, c’est que personne n’ait soupçonné le jeu des pseudonymes. Même une critique qui avait apprécié ses débuts d’artiste n’a rien deviné et, quand on lui demande après coup si elle l’aurait exposée, « croit » qu’elle l’aurait fait, bien que son travail lui semblait « trop intense ». Grande, puissante, érudite, Harry faisait peur en tant qu’artiste, tout le monde la jugeait parfaite dans le rôle d’épouse du riche Felix Lord.
Sa fille, en lisant ses notes après sa mort, se reprochera de n’avoir pas senti à quel point sa mère était malade de se savoir « affreusement incomprise » dans son métier. Les « poupées » que fabriquait Harry inquiétaient Maisie comme des signes de dépression, alors que sa mère donnait vie ainsi à son imaginaire : « Non existants, impossibles, les objets imaginaires habitent tout le temps nos pensées mais, en art, ils passent du dedans au dehors, mots et images franchissent la frontière. » (Carnet C)
Après la tristesse de la séparation avec Felix, Burden sent que sa liberté est arrivée, que personne ne la bloque plus sauf elle-même. Et pour déjouer les préjugés à l’égard des femmes artistes, dont elle donne de nombreux exemples dans l’histoire de l’art, elle se donne pour défi de changer la manière dont on perçoit ses « métamorphes ». Anton Tish, son premier masque, rencontré dans un bar grâce à un des « assistants-réfugiés » qu’elle accueille dans sa grande maison, fera « un malheur avec son installation ».
Son amie depuis douze ans, Rachel Briefman, a toujours vu en Harry une passionnée, « une omnivore animée d’une immense avidité de toutes les connaissances qu’il lui était possible d’ingérer. » Enfant, Harry admirait son père, « le philosophe-roi » dont le bureau lui était interdit. Vers seize ans, le développement de son corps « magnifique, fort, voluptueux » l’avait terriblement embarrassée. Dans Frankenstein de Mary Shelley, le monstre était son personnage préféré.
« Pourquoi les gens voient-ils ce qu’ils voient ? Il faut qu’il y ait des conventions. Il faut qu’il y ait des attentes. Sans cela, nous ne voyons rien ; tout serait chaos. Types, modes, catégories, concepts. » (Carnet A) La « grande Vénus » de Harry offre à Anton Fish, vingt-quatre ans, la reconnaissance en tant qu’artiste que n’aurait pas obtenue la mère de deux enfants adultes. Ensuite, avec Phineas Q. Eldridge qui se produit sur scène en tant que mi-homme mi-femme, mi-noir mi-blanc, la complicité est immédiate. Il l’aidera à fabriquer et exposer les « Chambres de suffocation ».
Bruno Kleinfeld, un voisin subjugué par l’allure, les manteaux et les chapeaux de Harriet Burden, finit par oser l’inviter à dîner et devient son complice intime et attentionné. Bien qu’il la pousse à signer son travail, elle reste cachée et veut choisir le bon moment pour la révélation. Son troisième avatar masculin, Rune, déjà célèbre par ses vidéos égotistes avant leur collaboration pour « Au-dessous », va bouleverser les plans de Harry de manière inattendue.
Un monde flamboyant multiplie les points de vue sur l’artiste, sur l’art, sur la réception des œuvres, entraînant le lecteur dans une exploration vertigineuse de la création et de la manière dont les autres la perçoivent. L’abondance des références littéraires et artistiques en fait une mine de sujets à méditer. Ceux qui connaissent un peu Siri Hustvedt, « intellectuelle vagabonde », fameuse épouse du non moins célèbre Paul Auster, s’amuseront de la voir mentionner brièvement son nom au passage comme celui d’« une obscure romancière et essayiste ».
Coïncidence (une expérience que les lecteurs connaissent bien) : La femme qui pleure de Picasso rencontrée dans La compagnie des artistes, la Dora Maar du « petit Picasso ardent et énergique » qui aimait faire pleurer les femmes, y fait une apparition. « Tous, nous voulons nous croire résistants aux paroles et aux actions d’autrui », c’est une illusion.
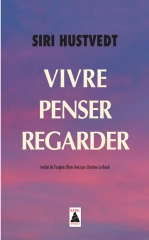 « Qu’en est-il des femmes qui écrivent ? Nous avons, nous aussi, des pères et des mères littéraires. Pendant la majeure partie de ma vie, il m’a semblé que la lecture et l’écriture sont précisément les deux lieux de la vie où je suis libérée des contraintes de mon sexe, où la danse avec l’identité de l’autre peut se danser sans obstacle et où le libre jeu des identifications permet de pénétrer une multitude d’expériences humaines. Quand je travaille, je ressens cette extraordinaire liberté, ma pluralité. Mais j’ai découvert que, dans le monde qui m’entoure, l’appellation de « femme écrivain » est encore, sur un front d’écrivain, un stigmate malaisé à effacer, qu’il demeure préférable d’être George plutôt que Mary Ann. »
« Qu’en est-il des femmes qui écrivent ? Nous avons, nous aussi, des pères et des mères littéraires. Pendant la majeure partie de ma vie, il m’a semblé que la lecture et l’écriture sont précisément les deux lieux de la vie où je suis libérée des contraintes de mon sexe, où la danse avec l’identité de l’autre peut se danser sans obstacle et où le libre jeu des identifications permet de pénétrer une multitude d’expériences humaines. Quand je travaille, je ressens cette extraordinaire liberté, ma pluralité. Mais j’ai découvert que, dans le monde qui m’entoure, l’appellation de « femme écrivain » est encore, sur un front d’écrivain, un stigmate malaisé à effacer, qu’il demeure préférable d’être George plutôt que Mary Ann. »