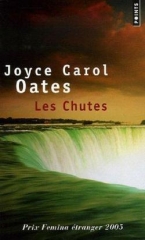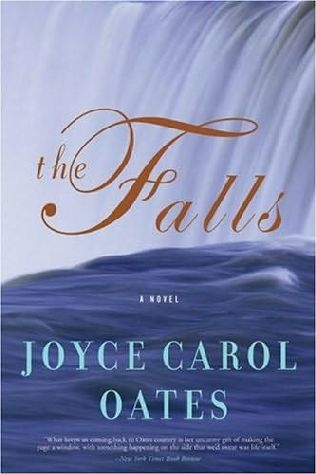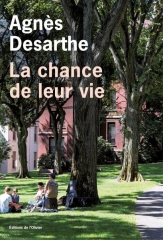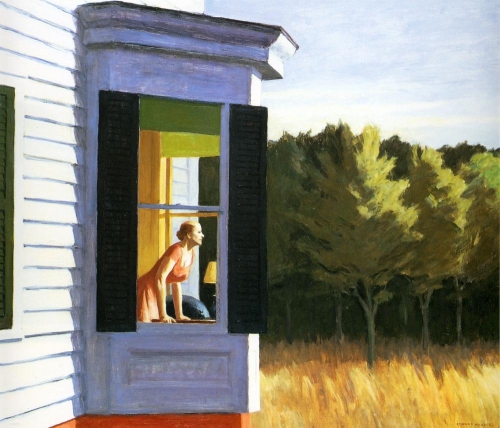Si vous avez lu jadis Les quatre filles du Dr March (1868-1869) ou vu l’une de ses nombreuses adaptations cinématographiques, vous vous laisserez peut-être tenter comme moi par le dernier film de Greta Gerwig (Little women, 2019). La romancière américaine Louisa May Alcott (1832-1888), abolitionniste, écrivaine engagée, infirmière durant la guerre, s’est inspirée de sa propre vie dans ce roman.
Saoirse Ronan, l’interprète de Jo March (en vedette sur l’affiche ci-dessus), le personnage dans lequel Louisa May Alcott a mis beaucoup d’elle-même, est vraiment magnifique dans le rôle ; plusieurs prix l’ont récompensée cette année. Jo est une jeune femme indépendante, décidée à contribuer aux frais de la maison grâce à ses écrits – le film commence quand elle se rend dans les bureaux d’un journal pour y vendre une nouvelle –, méfiante par rapport au mariage tant elle tient à sa liberté.
Le film alterne entre cette période de sa vie où elle commence à vivre de manière autonome et les souvenirs de la maison familiale, sept ans plus tôt. Les quatre filles du Dr March y étaient souvent seules. Leur mère, très soucieuse de la situation des familles pauvres, était souvent occupée ailleurs. Leur père, le pasteur March, le plus souvent absent, s’était engagé dans l’armée nordiste. (Niki s’est attardée sur ce personnage dans un billet sur March de Geraldine Brooks.) Hubert Heyrendt signale dans La Libre que le « docteur » du titre français était « une pure invention de l’éditeur français pour masquer le fait que leur père était en fait pasteur ».
L’entente entre elles protège Meg, Jo, Beth et Amy – la plus jeune, jalouse des talents de Jo –, du sentiment d’abandon : elles aiment s’amuser ensemble au grenier, préparer un spectacle d’après une pièce écrite par Jo pour Noël ou s’adonner à leurs passions. Jo écrit, Beth joue du piano, Amy dessine et peint (inspirée par May, la sœur artiste de la romancière), tandis que l’aînée, Meg (Emma Watson), la plus jolie, se montre aussi la plus coquette.
A l’adolescence, les filles March ont pour voisin un veuf esseulé dans sa magnifique maison, préoccupé par son fils Laurence, dit Laurie (Timothée Chalamet se montre ici plus fade que dans Un jour de pluie à New York de Woody Allen ; dans un petit rôle secondaire, Louis Garrel m’a paru plus convaincant.) Très indocile avec son précepteur et très intéressé par les années et venues des sœurs March, Laurie se lie d’amitié avec Jo qui l’introduit dans leur cercle, malgré les protestations des autres qui préféreraient rester entre filles. Quant au veuf, il reprendra des couleurs en écoutant Beth jouer du piano dans son salon de musique.
Nous sommes au XIXe siècle, en pleine guerre de Sécession. Le manque de moyens pèse sur cette famille quasi ruinée par la générosité du Dr March. Tante March, sa riche sœur, ne cesse de rappeler que seul un mariage avisé – c’est-à-dire avec un homme fortuné – peut leur procurer une meilleure situation sociale. Meryl Streep est parfaite dans le rôle de la tante, dragon mais bienveillante, et décidée à les aider à décrocher le bon parti. Laura Dern campe avec sensibilité la mère des filles March, une femme courageuse et attentive à leur épanouissement.
Le film n’est pas pour autant passéiste. On s’attache à ces adolescentes qui admirent le dévouement de leur mère et l’aident comme elles peuvent. On prend plaisir à observer leur complicité, à voir évoluer leur conscience d’elle-même, leur approche de la société. Elles font face à des difficultés très concrètes : aller au bal sans robe de soirée, partager un petit déjeuner, ne pas être continuellement accompagnée par les plus jeunes quand on sort, réagir sincèrement quand on reçoit une déclaration d’amour…
Les filles du Dr March est un film chaleureux, sympathique, agréable à suivre (beaux décors et costumes, facture classique). L’apprentissage de la vie, les joies et les peines, l’amitié et l’amour, la famille, les bals, le désir de s’émanciper… Le charme désuet d’une époque révolue se combine à des thèmes qui restent d’actualité, mutatis mutandis. Il me semble que les valeurs illustrées à travers cette histoire ont dû influencer par mal d’entre nous qui avons lu Alcott dans notre jeunesse et y avons trouvé un modèle de jeune femme à la fois volontaire et sensible, décidée à se réaliser pleinement – une dimension féministe avant l’heure accentuée par la réalisatrice.
Little women de Greta Gerwig est un film sans temps morts, même s’il dure deux heures et quart ; la musique parfois trop enjouée et envahissante, les changements d’époque (avec les mêmes actrices) nuisent un peu à la profondeur des sentiments. Je termine avec cette remarque de Marcos Uzal dans Libération : « Une phrase de la romancière sert d’exergue au film : « J’ai eu beaucoup de problèmes, alors j’écris des histoires gaies. »»