Un bref roman de Claire Huynen, Les femme de Louxor (2025), raconte de manière à la fois simple et saisissante le « tourisme amoureux » en Egypte : « Elles sont des centaines à Louxor. Des Occidentales qui se sont installées sur la rive ouest, après avoir tout quitté pour épouser un Egyptien qui les a séduites lors d’une croisière sur le Nil. » (4e de couverture) Pas du tout à la manière d’un reportage, mais de l’intérieur, à travers l’histoire d’une Française (la narratrice), mariée à Sayyed, et de la jeune Egyptienne, Hamsa, installée par celui-ci dans l’appartement au rez-de-chaussée de leur maison.

Quand trois mois plus tard, la jeune femme (moins de vingt ans) vient frapper pour la première fois à sa porte, avec un plat de légumes mijotés, « le regard dur déjà, au sol », elle repense à Sayyed, lui disant « dans son français chaotique auquel [elle avait] trouvé tant de charme » que « ça n’avait pas d’importance. Que cela ne voulait rien dire. Que le sexe avec elle était juste une obligation. Qu’elle ne savait pas y faire de toute façon. Que l’amour, le plaisir, c’était avec moi. Avec moi au premier étage. Que c’était là sa vraie maison. Et qu’il n’avait pas eu le choix. Que c’était comme ça. Et puis que j’avais accepté. » Elle l’avait accepté pour ne pas le perdre, et parce qu’il se disait sous la pression de ses parents voulant des petits-enfants.
Elle se rappelait comme elle avait ri la première fois que Sayyed lui avait dit l’aimer, trois jours à peine après avoir fait connaissance. Trois ans plus tôt, un peu perdue dans Louxor où elle était venue chercher le dépaysement et le soleil, après un an sans vacances, elle s’était laissé approcher par cet homme qui lui avait adressé la parole dans sa langue et troubler par son regard, son sourire.
Ce qui rend cette histoire intéressante, c’est le biais choisi par la romancière : la relation entre les deux femmes de Sayyed. Quand elle a vu Hamsa, le ventre rond, étendre son linge au jardin, elle l’a rejointe pour l’aider, puis l’a suivie pour prendre un thé au rez-de-chaussée où elle n’avait plus mis les pieds depuis son arrivée. Elle l’observe, voit pour la première fois ses cheveux, répète quelques mots d’arabe qu’Hamsa lui dit en désignant les objets. Elle avait voulu apprendre l’arabe avec Sayyed, mais très vite il repassait au français pour l’interroger sur sa vie en France. « Il me gardait pour lui. Pour lui seul. Privée de langage. »
Parmi les « méthodes bien rodées » que les séducteurs de ce genre s’échangent comme des recettes pour rendre leur proie dépendante – elle en prendra conscience après coup –, outre les compliments, il y a « la disparition » : d’abord des coups de téléphone, des lettres, puis un long silence. Et enfin un message, le soulagement pour celle qui se pensait oubliée. Malgré les avertissements de son entourage, elle y a cru, à son amour, à la boutique qu’ils auraient près du Nil… Ses phrases toutes faites, bien apprises, l’ont persuadée de sauter le pas. « Je n’ai fait que deux voyages avant de venir m’installer, de tout larguer. Deux voyages d’amour, deux séjours de promesses. »
Au début, c’est elle qui tenait l’épicerie, puis il lui avait dit de se reposer, de profiter de la maison qu’elle avait achetée pour eux après avoir vendu son appartement en France – « les touristes préféraient avoir affaire aux Egyptiens ». « C’est toujours chez elle qu’il rentre le soir. C’est par elle qu’il commence. C’est chez elle qu’il mange. Plus tard, après, il monte chez moi. » Elle s’est habituée à ce qu’il s’en aille pendant la nuit, à ne plus pleurer.
Le récit va et vient entre la cour que lui a faite Sayyed et la situation présente : un mari de plus en plus brutal qui réussit toujours à se faire pardonner ; le rapprochement avec Hamsa qui va peu à peu lui faire confiance. Elle se souvient du bonheur d’être aimée, préférée, et de son refus obstiné de croire aux histoires qu’on raconte de « femmes dépouillées, battues parfois, des amours de papier, des mariages en toc, l’arnaque grimée en bel amour » – « Mais toutes, nous étions convaincues, certaines, d’être l’exception. Que cela ne nous concernait pas. Que pour nous c’était différent. »
Ses phrases souvent simples et courtes, un rythme syncopé, des chapitres de quelques pages, Claire Huynen réussit dans Les femmes de Louxor à donner une grande intensité aux situations décrites, au ressenti de la narratrice. Je découvre la romancière belge (°1970) qui vit à Paris avec ce septième roman qui a remporté le prix Victor Rossel cette année, le prix littéraire le plus important en Belgique francophone, et aussi le Rossel des lecteurs. Je vous recommande l’entretien publié dans Le Carnet et les Instants, où elle répond aux questions de Michel Zumkir, et dans la revue de presse sur le site de l’éditeur, la critique du Soir où elle évoque son propre séjour de six mois en Egypte.
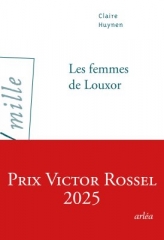 « Quatre femmes. Il m’a dit j’ai droit à quatre femmes. Puis il a ri. C’est toi que j’aime, tu le sais, je ne veux pas de quatre femmes, mais c’est comme ça ici, un homme peut avoir quatre femmes. Je ne savais rien de cela. Je me suis sentie idiote, bête de ne pas savoir, de n’avoir pas pensé à ça, de ne pas m’être renseignée, d’avoir épousé un homme qui pouvait avoir quatre femmes. Enfin trois autres. Je ne savais que mon amour, l’élan comme un impératif, le manque comme une charge lourde et ses promesses comme un appel. Un appel auquel je ne pouvais résister. »
« Quatre femmes. Il m’a dit j’ai droit à quatre femmes. Puis il a ri. C’est toi que j’aime, tu le sais, je ne veux pas de quatre femmes, mais c’est comme ça ici, un homme peut avoir quatre femmes. Je ne savais rien de cela. Je me suis sentie idiote, bête de ne pas savoir, de n’avoir pas pensé à ça, de ne pas m’être renseignée, d’avoir épousé un homme qui pouvait avoir quatre femmes. Enfin trois autres. Je ne savais que mon amour, l’élan comme un impératif, le manque comme une charge lourde et ses promesses comme un appel. Un appel auquel je ne pouvais résister. »


