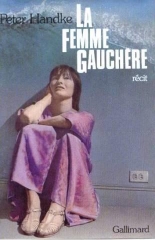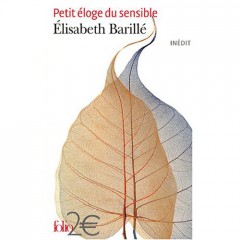Jacqueline Kelen a conquis un large public, en 2001, avec L’Esprit de solitude – une nourriture saine par ces temps qui nous confinent. Il ne faut pas nécessairement vivre seul pour entrer dans la voie qu’elle défend. L’essai s’ouvre sur une déclaration : « La solitude est un cadeau royal que nous repoussons parce qu’en cet état nous nous découvrons infiniment libres et que la liberté est ce à quoi nous sommes le moins prêts. »
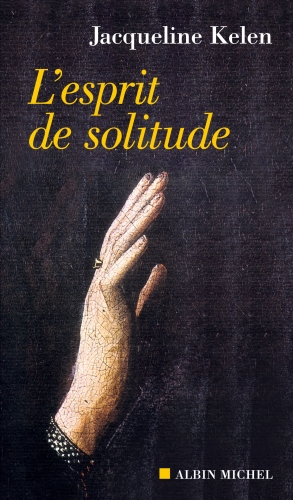
Jean van Eyck, Le mariage des époux Arnolfini (détail)
Magnifique prologue sur la solitude qui fait « tenir debout, avancer, créer ». Solitaire, Jacqueline Kelen l’est, « pour honorer la précarité humaine et ne pas démériter de l’Esprit ». Contre la société entêtée « à vouloir nier ou combattre la solitude – ce fléau, ce malheur – afin d’entretenir l’illusion d’un partage total et transparent entre humains, d’une communication étendue à la planète entière, allant de pair avec une solidarité sans faille. »
C’est confondre la solitude avec l’isolement, c’est parler trop peu « de cette conduite de vie solitaire qui favorise la réflexion et affermit l’indépendance, de cette solitude belle et courageuse, riche et rayonnante, que pratiquèrent tant de sages, d’artistes, de saints et de philosophes. » On peut choisir la solitude : « Lorsqu’on vit seul, ce n’est pas manque de chance ni absence d’amour : c’est que justement jamais on ne se sent seul, que chaque instant déborde de possibles floraisons. »
Relire, je l’observe à chaque fois, c’est redécouvrir les vibrations de la première lecture, s’arrêter aux passages cochés, en souligner d’autres auxquels on est plus sensible à présent. L’Esprit de solitude ne considère pas les situations douloureuses de l’isolement social, c’est une défense de « la vraie solitude – celle qui est à la fois remplie et légère, celle qui ouvre, rend disponible et relie ». « Habitare secum », habiter avec soi, « c’est le commencement de tout ». Ce peut être une épreuve, « invitation à se connaître, à surmonter le difficile […], dégager les couches qui obscurcissent notre véritable Moi. »
Pour éclairer ce chemin de solitude, l’essayiste recourt aux mythes, distingue le « je » de l’égo et du moi. Elle constate avec justesse que « personne ne nous apprend à être seul » et que la famille ou l’école laissent trop peu de place au silence où l’enfant peut faire face à lui-même. « Or le solitaire n’est pas celui qui n’aime pas les autres mais celui qui apprécie certains autres, celui qui en tout fait preuve d’élection et cultive les affinités. […] Il préfère toujours la rencontre particulière à la dilution dans une collectivité. »
« Le pacte de Mélusine » est un très beau récit pour illustrer le besoin de solitude dans la vie de couple. La jeune fille gracieuse que Raymondin rencontre à la Fontaine de Soif est une fée, il l’ignore. Mais il l’épouse en acceptant les conditions de Mélusine : ne pas s’enquérir de ses origines, lui laisser la journée du samedi pour elle seule. Le respectera-t-il ? En couple, il est essentiel « de se réserver de grands moments de solitude ou un lieu à part, afin de regarder l’autre différemment et le monde aussi. »
La solitude est un chemin où l’on avance avec les années, une quête que racontent de nombreux textes fondateurs : l’Epopée de Gilgamesh, l’Odyssée, des récits bibliques, des mythes à travers lesquels Jacqueline Kelen nous conduit sur la voie de l’intériorité : « c’est le silence de soi, c’est une attention au monde, une gratitude aussi. » Le solitaire ne demande pas aux autres de le rendre heureux ni ne les accuse de ses propres insuffisances. Commentant l’histoire de Perceval, elle écrit : « moi seul puis poser la juste question ; moi seul puis m’étonner, m’émerveiller, chercher le sens ; nul ne peut le faire à ma place. »
Penseurs, artistes, ermites, écrivains… On rencontre beaucoup de beaux exemples et d’explorations personnelles de la vie solitaire dans L’Esprit de solitude, des hommes et des femmes. Solitude érudite et fertile de Jacqueline Kelen : elle a écrit plus de septante ouvrages depuis 1987. Le dernier s’intitule Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien, sur la parabole du fils prodigue. Si vous avez un de ses autres titres à me recommander, je serai heureuse d’en prendre note.