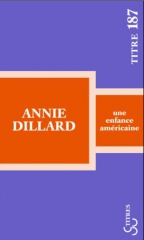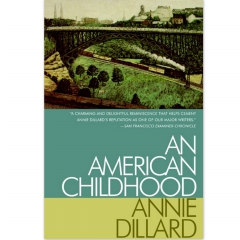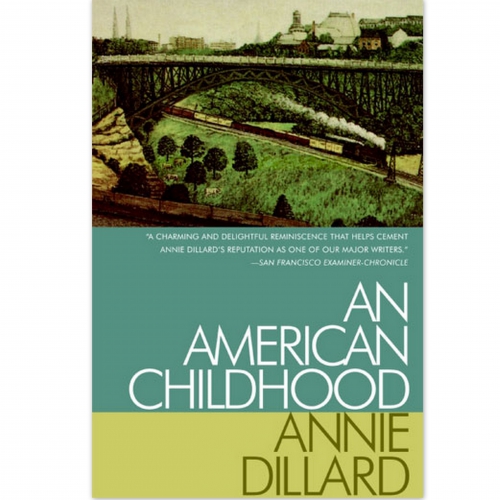Comment grandit-on ? Dans Une enfance américaine (1987, traduit de l’anglais par Marie-Claude Chenour et Claude Grimal), Annie Dillard revient sur son enfance à Pittsburgh (Pennsylvanie), où elle est née en 1945. Après avoir lu son roman L’amour des Maytree, sa vie dans l’écriture (En vivant, en écrivant), son fameux Pèlerinage à Tinker Creek, j’étais curieuse de découvrir ses débuts dans la vie. Elle y dévoile une enfance privilégiée, des racines géographiques, et surtout l’éducation que lui ont donnée ses parents.
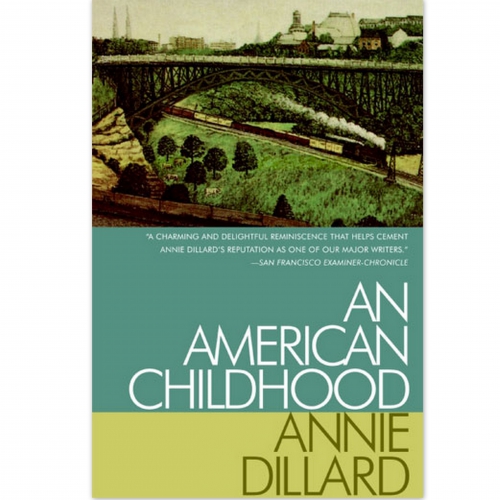
Trois grands cours d’eau arrosent sa ville natale : l’Allegheny venant du nord, la Monongahela, du sud, se mêlent à l’Ohio pour continuer vers l’ouest. « En 1955, j’avais dix ans, les lectures de mon père lui montèrent à la tête. » Après des années à lire et relire La Vie sur le Mississipi, « il partit de Pittsburgh et descendit le fleuve ». Il adorait le jazz Dixieland. Délaissant sa vie d’entrepreneur, sa femme et ses trois filles (dix ans, sept ans, six mois), il comptait gagner La Nouvelle-Orléans sur son sept-mètres. Mais après une halte dans sa famille à Louisville, Kentucky, après six semaines, « il vendit le bateau et prit l’avion pour rentrer chez lui. »
« Je commençais juste à m’éveiller, tout juste. Les choses changeaient autour de moi. Le nouveau bébé, Molly, qui était très amusant, venait d’être installé dans une ancienne chambre d’amis. Le monde extérieur dans son immensité apparut soudain et se remplit de choses qui apparemment avaient toujours été là : la minéralogie, le travail de détective, l’entomologie, les étangs et les cours d’eau, l’aviation, la société. » Le réveil des enfants de dix ans. « La conscience fond sur l’enfant comme une hirondelle de mer touche le sol l’ombre de ses pattes tendues ; très précisément, doigt après doigt. » C’est un des fils rouges d’Annie Dillard de repérer ces prises de conscience qui ont changé à jamais sa vision du monde.
Une première partie évoque le Pittsburgh de ses cinq ans, en 1950, quand « chaque femme restait seule dans sa maison, comme une pièce de monnaie dans un coffre-fort », avec leurs enfants. Sa mère s’occupait de tout, leur tenait compagnie au jardin à regarder les formes des nuages et trouver à quoi ils ressemblaient. A cette époque, Annie Dillard n’aimait pas aller au lit, « car alors une chose pénétrait dans ma chambre » – impossible de respirer normalement. Une nuit, elle comprend de quoi il s’agit : une voiture passait « et dans le pare-brise reflétait la lumière du réverbère ». La raison pouvait l’emporter sur l’imagination.
De cette année-là, elle garde aussi la vision, après une grande tempête de neige, d’une fillette du quartier patinant sur la rue, un spectacle « beau et étrange » : « Elle virevoltait sur ses patins dans le cône de lumière jaune (du réverbère) – éclairée et silencieuse. » Révélation de la beauté et du mystère à l’extérieur, tandis qu’à l’intérieur sa famille, à la fenêtre, ressentait la paix et le confort. Une des « quelques scènes flottantes de la petite enfance », avant le temps de la compréhension et de la cohérence.
La mère d’Annie Dillard, anticonformiste, avait « du goût pour les choses modernes » : table basse à la Jean Arp, mobile en fer noir dans le style de Calder, reproduction de Gauguin au mur et sur un guéridon, premier objet d’art acheté, « une sculpture Yoruba en bois, une femme abstraite à longue tête et seins pointus ». Elle aimait aussi les mots, les expressions et s’amusait à utiliser des « écossaissismes » glanés dans les vieilles familles de Pittsburgh, presque toutes « irlando-écossaises ». « Son langage était un mélange extraordinaire et imprévisible de vieilles blagues, de cris du cœur, de jeux de mots anciens et récents, de confessions théâtrales, de reparties spirituelles, de petits « écossaissismes », de refrains de chansons de Frank Sinatra, de régionalismes désuets et d’exhortations morales. »
Très tôt, Annie Dillard a le goût de la marche : « Ma mère m’avait laissée libre de me promener dans les rues dès que j’avais su par cœur notre numéro de téléphone. » Elle apprend à connaître les rues de son quartier, les parcourt aussi à bicyclette, jusqu’à Frick Park, près de deux cents hectares de bois « au cœur du Pittsburgh résidentiel » que traverse un seul sentier. Son père lui interdit d’y aller, à cause des clochards, mais elle s’y promène souvent. « Avant de vouloir lire, je voulais marcher. Le texte que je lisais, c’était la ville ; le livre que j’imaginais, c’était une carte. »
Ses parents adorent les histoires drôles, les blagues ; son père note sur un petit carnet noir celles qu’il veut retenir. « Se souvenir d’une plaisanterie était une obligation morale. » Il faut aussi savoir bien les raconter, un art à maîtriser si l’on veut faire rire. « Notre mère préférait le genre staccato, grand style. Si notre père savait baratiner, elle savait condenser. Un type va voir le psychiatre. « Vous êtes fou. – J’aimerais une autre opinion. – Vous êtes moche. »
Longtemps, avec sa sœur Amy, Annie Dillard dînait le vendredi soir chez les parents de son père, servis par Henry en veste blanche d’uniforme. Enfant unique élevée dans un certain luxe, Oma « avait quelque chose de victorien ». En robe de coton et sandales plates lorsqu’elle résidait dans leur maison au bord du lac Erié, en ville « elle s’habillait », arborait ses bijoux, portait du violet et du vert, « impressionnante ». « Si Oma avait de l’argent à ne savoir qu’en faire, nous étions persuadées, nous, d’avoir bon goût. Oma possédait une sculpture en verre soufflé bleu et vert représentant deux cygnes enlacés, pleine de bulles ; nous avions un mobile de Calder en métal noir. Oma avait un domestique et une dame de compagnie. Nous avions « quelqu’un pour nous aider ». Notre « aide » buvait dans les mêmes verres que nous. »
La deuxième partie fait place à l’histoire de Pittsburgh et à sa richesse industrielle – « Nous les enfants, nous jouions autour des énormes demeures de pierre pâle des nababs, calmes comme des tombes, légèrement en retrait dans leurs parcs ombragés. » Un manuel de dessin donne à la fillette des clés pour dessiner d’après nature : « Apprendre à dessiner, c’est en fait apprendre à voir. » Elle dessine son gant de base-ball pendant des jours et des jours. Puis à la bibliothèque, elle trouve Le Guide des étangs et des cours d’eau, plein de conseils pratiques, et l’amour de la lecture.
Ecole, uniforme, garçons, cours de danse obligatoires. « Nous étions tous là, garçons et filles, plongés par la conspiration de nos aînés dans une vérité sociale stupéfiante : nous devions faire connaissance. C’était ça le cours de danse. » Annie Dillard découvre leurs différences, les garçons accumulant des informations sur un monde extérieur à l’école, contrairement aux filles. « Quelque chose les attendait, eux les garçons, nous en avions tous le sentiment sans savoir de quoi il s’agissait. » A elle, il faudra plus de temps pour se projeter dans l’avenir : « Juste un jour, je voulais trouver une tâche qui exigerait toute la joie que je sentais en moi. »
Une collection de minéraux va décupler son goût de l’observation, puis une collection d’insectes, et aussi le microscope. « Tout m’attirait ; le monde visible m’expédiait, pleine de curiosité, vers les livres ; et les livres me renvoyaient, prise de vertige, vers le monde. » Ignorante du malheur, de la souffrance, des privations, elle pense alors pouvoir résoudre tous les problèmes qu’elle rencontrerait. « Tout était simple : il suffisait de trouver une tâche à accomplir, d’étudier le sujet à fond et de se lancer. »
Quand on lui donne à lire des livres sur la seconde guerre mondiale, elle en est bouleversée, profondément. C’est au musée d’histoire naturelle qu’elle se sent le plus à l’aise. Au musée des beaux-arts, elle voit en 1961, à seize ans, la sculpture qui a gagné le prix de l’Exposition internationale : l’Homme qui marche, de Giacometti – « ce personnage idéal dont la forme correspondait à la vie intérieure et dont le nom sonnait très indien ».
La troisième partie d’Une enfance américaine montre son intérêt grandissant pour les sciences et les arts, mais c’est le temps de la métamorphose : à ses yeux, plus rien ne va, ni en Amérique, ni dans sa famille, ni en elle-même. Elle se retrouve devant le juge pour enfants, se fait renvoyer de l’école. Annie Dillard qui aime tant sentir la vie lui chatouiller le visage « comme un gros pinceau » va bientôt vivre sa propre existence, hors du cocon familial.
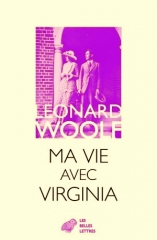 « La Guilde [Co-operative Women’s Guild] organisait des week-ends de formation ou des sessions de conférences à Londres ou dans d’autres grandes villes comme Manchester ou Leeds, et j’y allais souvent pour parler des impôts, des affaires étrangères ou de l’Empire colonial. En apparence, il n’y avait rien de commun, qu’il s’agisse de la façon de penser, de vivre au quotidien, entre l’épouse d’un ouvrier du textile du Lancashire ou d’un mineur de Durham et une habitante d’un village cinghalais. Et pourtant, je pense que les jours, les semaines, les mois, les années que j’ai passés à échanger avec ces personnes qui m’étaient étrangères, les hommes et les femmes de Kandyan, des rizières, de la jungle de Hambantota, m’ont aidé à comprendre et entrer véritablement en contact avec Mrs. Barton et Mrs. Harris. C’est une erreur de dire que les gens pauvres et primitifs sont plus « réels » que les gens riches et sophistiqués, qu’il y a davantage de « réalité » au Congo ou dans une mine de charbon qu’à Cambridge ou Cavendish Square. Mais ces gens qui vivent à nu, sans protection à la fois physique et mentale, démunis et complètement vulnérables aux catastrophes, acquièrent une sorte de simplicité cristalline, une lucidité réaliste qu’on peut lire dans leurs regards qui, pour moi, avaient un charme et une force esthétique et humaine d’une grande qualité. A Ceylan, je pense que j’ai beaucoup appris en passant du temps assis sous un arbre à parler avec un villageois ou une vieille femme – et à les écouter me répondre. Cela m’a permis de parler vraiment avec toutes les femmes du Mouvement. Et je n’étais pas mécontent lorsque l’une d’elles, après une heure d’une conférence sur les impôts, venait me voir pour me dire : « Vous êtes le seul gentleman que nous comprenons lorsqu’il nous parle. »
« La Guilde [Co-operative Women’s Guild] organisait des week-ends de formation ou des sessions de conférences à Londres ou dans d’autres grandes villes comme Manchester ou Leeds, et j’y allais souvent pour parler des impôts, des affaires étrangères ou de l’Empire colonial. En apparence, il n’y avait rien de commun, qu’il s’agisse de la façon de penser, de vivre au quotidien, entre l’épouse d’un ouvrier du textile du Lancashire ou d’un mineur de Durham et une habitante d’un village cinghalais. Et pourtant, je pense que les jours, les semaines, les mois, les années que j’ai passés à échanger avec ces personnes qui m’étaient étrangères, les hommes et les femmes de Kandyan, des rizières, de la jungle de Hambantota, m’ont aidé à comprendre et entrer véritablement en contact avec Mrs. Barton et Mrs. Harris. C’est une erreur de dire que les gens pauvres et primitifs sont plus « réels » que les gens riches et sophistiqués, qu’il y a davantage de « réalité » au Congo ou dans une mine de charbon qu’à Cambridge ou Cavendish Square. Mais ces gens qui vivent à nu, sans protection à la fois physique et mentale, démunis et complètement vulnérables aux catastrophes, acquièrent une sorte de simplicité cristalline, une lucidité réaliste qu’on peut lire dans leurs regards qui, pour moi, avaient un charme et une force esthétique et humaine d’une grande qualité. A Ceylan, je pense que j’ai beaucoup appris en passant du temps assis sous un arbre à parler avec un villageois ou une vieille femme – et à les écouter me répondre. Cela m’a permis de parler vraiment avec toutes les femmes du Mouvement. Et je n’étais pas mécontent lorsque l’une d’elles, après une heure d’une conférence sur les impôts, venait me voir pour me dire : « Vous êtes le seul gentleman que nous comprenons lorsqu’il nous parle. »