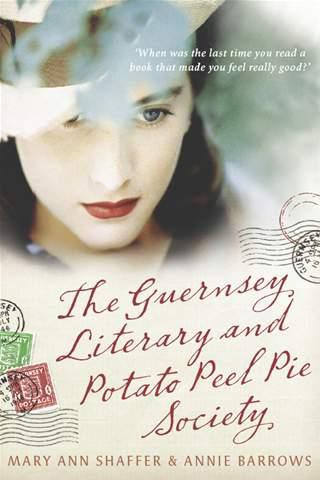Le « Cercle des amateurs de littérature et de tourte aux épluchures de patates de Guernesey » a déjà tant fait parler de lui que je vous en épargne le résumé.
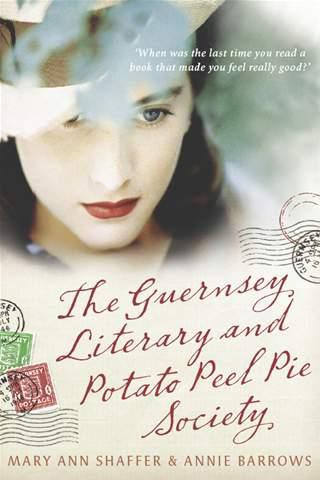
Les raisons pour lesquelles je ne l’avais pas encore lu ?
Le titre. La traductrice Aline Azoulay l’a raccourci en français : Le Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates – ça reste racoleur. J’imagine les alternatives écartées : Le Cercle littéraire de Guernesey (rien à se mettre sous la dent), Les amateurs de livres et de tourtes (un peu tarte), Le Cercle des amateurs de littérature et de tourte aux épluchures de pommes de terre (trop de « de »), etc.
On en parlait partout : le livre de Mary Ann Shaffer et d’Annie Barrows a figuré longtemps sur la liste des meilleures ventes. J’ignorais que c’était l’unique roman de cette Américaine, décédée en 2008, l’année de sa publication, un roman écrit en collaboration avec sa nièce, auteure de livres pour enfants.
Des raisons de lire ce livre ?
Il nous mêle gentiment à la vie quotidienne des habitants de Guernesey pendant et après la seconde guerre mondiale. Mary Ann Shaffer a visité Jersey en 1976 et s’est intéressée à l’histoire des îles anglo-normandes, méconnue à l’extérieur. Ce Cercle est né sous l’Occupation allemande, dans des circonstances qui éclairent son appellation biscornue.
C’est un roman épistolaire très accessible : des lettres de quelques pages, des billets courts (aujourd’hui, ce seraient des courriels). Il s’ouvre sur une lettre de Juliet Ashton, une Anglaise dans la trentaine, à son éditeur et ami Sidney Stark, qui a rassemblé ses chroniques sous le titre « Izzy Bickerstaff s’en va-t-en guerre ». Le recueil se vend très bien, beaucoup mieux que sa biographie d’Anne Brontë. De janvier à septembre 1946, il sera son interlocuteur privilégié.
Le ton : une conversation familière. Le lecteur est tout de suite dans le coup, les personnages sont bien campés, et Juliet ne manque pas d’humour. Je ne suis pas sûre qu’on s’exprimait dans ces termes il y a cinquante ans, mais l’effet de rapprochement est réussi, l’immersion rapide.
Un cercle littéraire, c’est bien sûr un bon appât pour les amateurs de livres. Mais aussi pour les autres, on le verra. A Guernesey se rassemblent des apprentis lecteurs dont la vie n’a rien à voir a priori avec la sphère littéraire, ce qui fait le sel de leurs réunions à la fortune du pot.
Juliet va découvrir peu à peu leurs rites, leur histoire, leur vie, grâce à Dawsey Adams, un adorateur de Charles Lamb. Celui-ci lui écrit après avoir trouvé son nom au verso de la couverture d’un vieux livre de « morceaux choisis ». Par Dawsey, nous ferons connaissance avec Elizabeth, la fondatrice du Cercle, véritable pivot de l’histoire, bien qu’on ait perdu sa trace depuis la guerre.
De mystérieux envois de fleurs à Juliet, son indécision sentimentale qu’elle ne confie qu’à Sophie, sa meilleure amie, sa curiosité pour les membres du Cercle de Guernesey, un livre ou un article à écrire, voilà les ingrédients romanesques. Ce serait pure eau de rose si Mary Ann Shaffer et Annie Barrows n’y insufflaient fantaisie et sympathie.
Vous avez lu Le Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates ? N’hésitez pas à compléter ce billet par vos impressions ou par un lien, si vous avez écrit sur ce roman. Vous ne l’avez pas lu ? Il est disponible en 10/18 et vous procurera un bon moment, quelle que soit votre île, surtout si vous cherchez à vous détendre et à vous distraire un peu. Lecture pour tous.