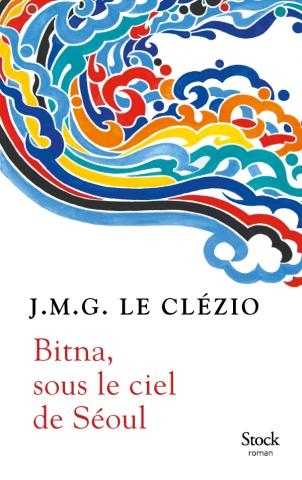Au début de Celle qui fuit et celle qui reste (traduit de l’italien par Elsa Damien), tome III de L’amie prodigieuse – « Epoque intermédiaire » –, Elena Ferrante reprend dans l’index des personnages les événements des tomes précédents. Autour de Lenù et Lila, la narratrice et son amie d’enfance, gravite tout un quartier populaire de Naples.

Le nouveau nom (tome II) se terminait sur la publication du premier livre d’Elena Greco. C’est alors, durant l’hiver 2005, qu’elle a vu Lila pour la dernière fois (sa disparition est à l’origine du récit). Lenù essaie de la voir chaque fois qu’elle passe à Naples et l’aime toujours, bien qu’elle lui fasse un peu peur.
Flash-back. Ses études universitaires achevées, à la fin des années soixante, Elena se sent mieux en dehors de Naples que dans cette ville « pleine à craquer ». Elle va épouser Pietro, le fils de la raffinée Adele Airota. Lila, encore mariée à Stefano bien qu’elle l’ait quitté, vit misérablement avec son enfant chez Enzo ; tous deux travaillent dans une usine de salaisons. Elena pense avoir fait le bon choix, « s’en aller », même si avec le temps, elle réalisera que les maux de son quartier sont aussi ceux de son pays, de l’Europe, de la terre entière.
Il y a plus de quarante ans, Elena répondait maladroitement à « l’homme aux lunettes épaisses » qui avait attaqué son livre en public dans une librairie milanaise quand quelqu’un s’était levé pour la défendre : Nino Sarratore, celui qui avait séduit et abandonné Lila, celui que Lenù aime depuis toujours en secret. Après, ils parleront de Lila, qu’il juge « incapable d’accepter les autres et de s’accepter elle-même », allant jusqu’à déclarer que « rien ne va chez elle : ni la tête ni rien, pas même le sexe. »
Voilà qui déconcerte Elena, d’autant plus que Lila a eu un petit garçon, Gennaro, et que sa relation avec Nino l’a détruite. Quand son fiancé arrive par surprise au repas organisé par Adele, elle compare sa silhouette trapue, ses cheveux touffus, sa voix grave, avec celle de Nino, « sec et dégingandé », sa voix « forte et chaleureuse ». Elle aurait aimé parler avec lui toute la nuit. Pietro, poussé par sa mère, annonce qu’il vient d’obtenir un poste de professeur à l’université de Florence.
Son futur époux est à ses yeux « un homme intelligent, extraordinairement cultivé et bienveillant », mais Elena fantasme encore sur Nino. Ses parents, à qui elle annonce la visite de son fiancé, ne manifestent ni joie ni satisfaction – ils trouvent leur fille de plus en plus étrangère à la famille. Que Pietro ne veuille pas de mariage à l’église les scandalise. Elena arrive à calmer sa mère en promettant de lui installer la télévision et le téléphone.
Une critique sévère de son roman dans le Corriere la met au désespoir, heureusement compensée par des éloges dans L’Unità. La voilà célèbre, le livre se vend bien. Tout le monde parle des pages « osées » du roman. En tournée de promotion, elle dit « la nécessité de raconter franchement toutes les expériences humaines, même (…) ce qui nous semble indicible et ce que nous nous taisons à nous-mêmes. »
A l’université de Milan, où règne une grande agitation – affiches, slogans, discussions –, elle observe le comportement des étudiantes, plus à l’aise qu’elle pour s’exprimer et réagir. Avec son « éternel désir de bien faire », n’est-elle pas à présent « trop cultivée, trop ignorante, trop contrôlée » ? Cette analyse de soi, de son comportement trop influençable, est un thème récurrent dans L’amie prodigieuse, en particulier dans ce tome-ci. Elena ne cesse de remettre en question ce qu’elle devient en se comparant aux autres.
Grâce à sa belle-mère, Elena échappe au taudis où Pietro voulait les installer à Florence. Adele leur trouve un appartement agréable, l’aide à s’habiller, se coiffer – son élégance la subjugue. De son côté, elle s’offre des cours d’auto-école et obtient son permis de conduire, elle veut utiliser la voiture de Pietro quand ils seront mariés.
Lila, la sachant à Naples, envoie chercher Lenù. Malade, affaiblie, elle lui arrache une promesse : celle d’élever Gennaro s’il lui arrive quelque chose. Elena promet. Leurs vies ont divergé, mais Lila lui manque : « Je voudrais que Lila soit là, et c’est pour ça que j’écris. » On découvre comment vit Lila, grâce à la gentillesse d’Enzo avec qui elle ne couche pas, les dures conditions de travail à l’usine où les femmes subissent en plus les brimades des hommes, son rôle de plus en plus actif dans la contestation, jusqu’à se mettre en danger.
Entre les révolutionnaires et les fascistes, la tension croît. Aux bagarres de l’enfance succèdent de véritables combats politiques où la violence est prompte à s’inviter. Lila donne des coups, en prend, et quand elle se retrouve au fond du trou, Elena fait tout pour l’en sortir. « Dans le passé, Lila avait ouvert le tiroir miraculeux de l’épicerie et m’avait acheté de tout, en particulier des livres. Aujourd’hui, j’ouvrais mes tiroirs et lui rendais la pareille, espérant lui faire partager le sentiment de sécurité qui était désormais le mien. »
Celle qui fuit et celle qui reste raconte les parcours divergents des deux femmes. Elena s’embourgeoise, tiraillée entre sa vie d’épouse et de mère et ses ambitions littéraires, Lila rue dans les brancards et rebondit de manière imprévue. Leur vie sentimentale n’est simple ni pour l’une ni pour l’autre. Riche en péripéties, ce roman d’Elena Ferrante décrit des changements de mentalité et de mœurs que nous avons traversés aussi, d’où notre curiosité pour découvrir la fin de cette saga italienne.