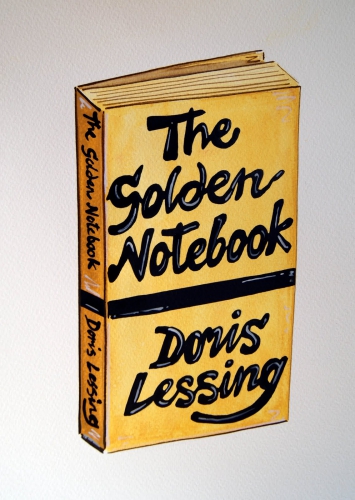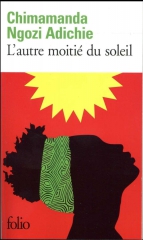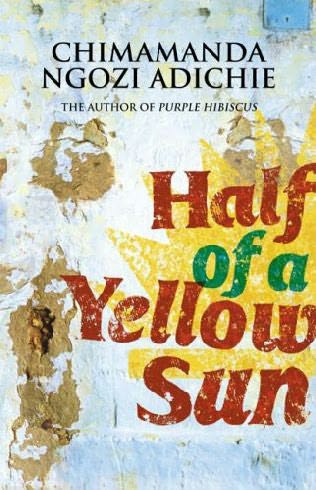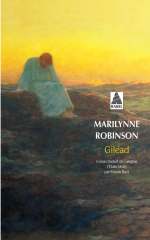Des enfants biafrais souffrant de la faim, ce sont des images du siècle dernier que nous n’avons pas oubliées. Chimamanda Ngozi Adichie, dans L’autre moitié du soleil (Half of a Yellow Sun, 2006, traduit de l’anglais (Nigeria) par Mona de Pracontal), raconte les années 60 à travers l’histoire d’un garçon nigérian, Ugwu, engagé au service d’un professeur d’université, Odenigbo, qu’il appelle « Master ».
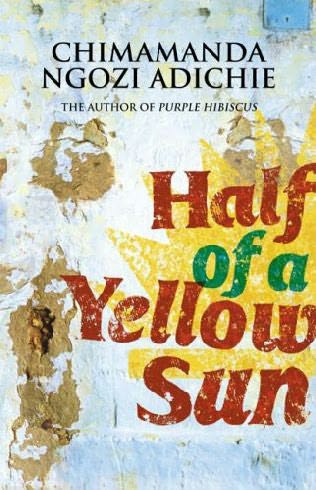
Pour ce villageois de treize ans, c’est le premier contact avec un frigo et l’eau courante, une maison avec des murs couverts de livres, une radio-pick-up, de vrais lits et non de simples nattes. Son maître l’interroge, s’intéresse à lui, montre sur une carte où se situent le Nigeria et Nsukka, la ville où il habite, au sud-est.
Très vite, il l’inscrit à l’école primaire du corps enseignant – « L’instruction est une priorité ! » – et lui explique qu’il y a deux réponses aux choses qu’on lui enseignera sur leur pays : « la vraie réponse et celle que tu donnes à l’école pour passer. Tu dois lire des livres et apprendre les deux réponses. » Le boy devra aussi cuisiner, servir, nettoyer. Le jardin, c’est Jomo qui s’en occupe.
Ugwu n’est pas traité en boy ordinaire : Odenigbo lui laisse souvent l’initiative, lui prête des livres. Quand il reçoit, le garçon apprend beaucoup de choses, notamment sur la politique, en écoutant les professeurs discuter. Parmi les invités, il y a des femmes universitaires (aux « perruques lisses et souples » qui les rendent chauves à la longue) comme Mlle Adebayo, qui ne parle pas ibo comme les autres mais yoruba, et aime tenir tête à son hôte.
Pour Odenigbo, « la seule véritable identité authentique, pour l’Africain, c’est la tribu. » Les hommes blancs ont créé le Nigeria, mais avant leur arrivée, il était ibo – ils ne sont pas tous d’accord là-dessus, on le considère comme « un tribaliste incorrigible ». Ugwu aime sa « voix grave, la mélodie de l’ibo teinté d’anglais, le miroitement des épaisses lunettes ».
Olanna arrive de Londres quatre mois après l’arrivée d’Ugwu. Le boy craignait une intruse, mais tombe sous le charme de sa « madame » et de son parler « lumineux » comme l’anglais de la radio, comme « une igname qu’on découpe avec un couteau fraîchement aiguisé, à la perfection facile de chaque tranche ». Olanna est impatiente de vivre enfin avec l’homme qu’elle aime.
Fille du chef Ozobia, riche homme d’affaires à Lagos, elle est la plus jolie des deux jumelles. Son refus d’un poste au ministère, son choix de travailler à Nsukka comme assistante en sociologie déplaisent à ses parents. Heureusement, selon son père, sa sœur Kainene « ne vaut pas juste un fils, elle en vaut deux » : elle est son meilleur soutien dans ses entreprises. Sa mère aurait préféré qu’Olanna cède aux avances du chef Okonji plutôt qu’à celles de son « amant révolutionnaire », d’autant qu’il n’est pas question de mariage.
Pendant qu’Odenigbo se rend à un colloque, Olanna emménage à Nsukka et apprend gentiment à Ugwu comment mieux faire certaines choses, l’accompagne au marché, cuisine avec lui – son apprentissage continue. Les amis d’Odenigbo étaient curieux de faire la connaissance de sa bien-aimée, ils sont ravis.
De son côté, Richard Churchill, journaliste à Londres, est introduit dans la société nigériane par Susan, une femme du monde qui qualifie les Haoussas du Nord de gens « pleins de dignité », les Ibos de « renfrognés » et avides d’argent, les Yoroubas de « plutôt sympas » mais « lèche-bottes ». Il a choisi le Sud-Est du Nigeria parce que c’est la région « de l’art d’Igbo-Ukwu, le pays du magnifique pot cordé », davantage que pour la bourse universitaire obtenue pour écrire un livre.
Susan, après quelques mois, lui offre de s’installer chez elle dans une pièce plus confortable pour écrire. C’est elle qui le présente un jour à Kainene, pas jolie mais très grande, très mince, une robe moulante, un collier coûteux au cou. Dès leur première conversation, il est séduit par son assurance, sans oser le laisser paraître.
L’autre moitié du soleil passe du début à la fin des années 60 au premier quart à du roman (environ 650 pages) et tout est bouleversé par le coup d’Etat, présenté par la BBC comme un coup d’Etat ibo. D’abord enthousiastes à l’annonce de « la fin de la corruption », les protagonistes vont bientôt devoir affronter l’insécurité, les troubles, les massacres, puis la sécession. Quand l’est du Nigeria devient la République du Biafra, Onedigbo croit à un « commencement », « notre commencement » dit-il à tous.
Fiers d’être indépendants, Odenigbo et son entourage s’engagent dans la construction de leur nouvel Etat au drapeau orné d’un demi-soleil jaune. En réalité, c’est le début d’une guerre politique, sociale, économique. Très vite, des « opérations de police » sont organisées contre des « rebelles ». Olanna a l’intention d’enseigner à l’école primaire, « son effort de guerre à elle ».
C’est de l’intérieur, avec ces personnages attachants, que nous découvrons comment la violence se rapproche peu à peu, comment les habitants se déplacent pour se mettre à l’abri, comment l’horreur les rattrape. La guerre Nigeria-Biafra a duré de 1967 à 1970. Chimamanda Ngozi Adichie alterne entre les péripéties familiales, les drames sentimentaux et l’histoire d’un peuple qui espérait la paix et connaît la famine et l’abomination.
La romancière s’est abondamment documentée pour « recréer l’atmosphère du Biafra des classes moyennes » et inventer des personnages crédibles. « Adichie rend compte de la réalité multiethnique et multilingue du Nigeria », commente la traductrice, qui s’est efforcée de rendre les différentes langues parlées : celle de l’élite nigériane, celle des gens moins instruits, l’ibo dont elle a conservé certains mots. Au bout de ce roman bouleversant, on se dit une fois de plus que si la guerre est terrible, la guerre civile l’est encore plus.
 « Et en y réfléchissant, ce que j’ai fait si souvent, je découvre que j’arrive par une porte dérobée à l’une des autres questions qui m’obsèdent. Je veux dire la question de la « personnalité ». Dieu sait si l’on nous empêche d’oublier que la « personnalité » n’existe plus. C’est le sujet d’un roman sur deux, c’est celui des sociologues et de tous les autres –ologues. On nous a tellement rabâché que la personnalité humaine s’est désintégrée sous la pression de toutes nos connaissances que je l’ai même cru. Pourtant, quand je revois ce groupe sous les arbres et que je le recrée dans ma mémoire, je comprends soudain que c’est absurde. […]
« Et en y réfléchissant, ce que j’ai fait si souvent, je découvre que j’arrive par une porte dérobée à l’une des autres questions qui m’obsèdent. Je veux dire la question de la « personnalité ». Dieu sait si l’on nous empêche d’oublier que la « personnalité » n’existe plus. C’est le sujet d’un roman sur deux, c’est celui des sociologues et de tous les autres –ologues. On nous a tellement rabâché que la personnalité humaine s’est désintégrée sous la pression de toutes nos connaissances que je l’ai même cru. Pourtant, quand je revois ce groupe sous les arbres et que je le recrée dans ma mémoire, je comprends soudain que c’est absurde. […]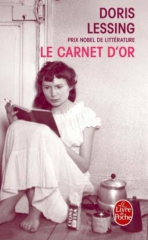 Les moments que je me rappelle ont tous cette assurance absolue d’un sourire, d’un regard, d’un geste sur un tableau ou dans un film. Suis-je alors en train de dire que la certitude à laquelle je m’accroche appartient à l’art visuel et non au roman – pas du tout au roman, conquis par la désintégration et l’effondrement ? Quel intérêt un romancier éprouverait-il à s’accrocher au souvenir d’un sourire ou d’un regard, alors qu’il connaît bien les complexités qui s’y dissimulent ? Et pourtant, si je ne le faisais pas je serais à jamais incapable de tracer un seul mot sur le papier : de même que je me retenais au bord de la folie, dans cette froide ville du nord, en me remémorant délibérément la sensation du soleil chaud sur ma peau. »
Les moments que je me rappelle ont tous cette assurance absolue d’un sourire, d’un regard, d’un geste sur un tableau ou dans un film. Suis-je alors en train de dire que la certitude à laquelle je m’accroche appartient à l’art visuel et non au roman – pas du tout au roman, conquis par la désintégration et l’effondrement ? Quel intérêt un romancier éprouverait-il à s’accrocher au souvenir d’un sourire ou d’un regard, alors qu’il connaît bien les complexités qui s’y dissimulent ? Et pourtant, si je ne le faisais pas je serais à jamais incapable de tracer un seul mot sur le papier : de même que je me retenais au bord de la folie, dans cette froide ville du nord, en me remémorant délibérément la sensation du soleil chaud sur ma peau. »