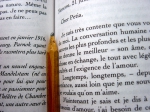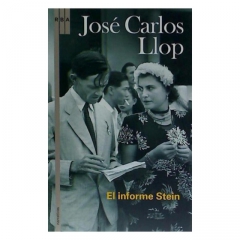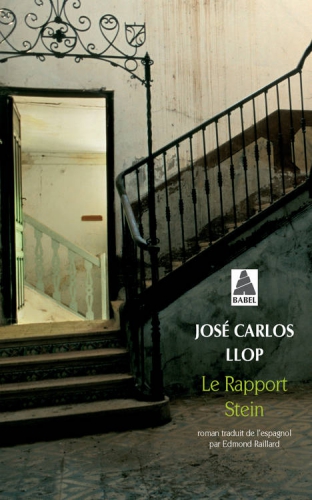Premier roman traduit en français de José Carlos Llop, Parle-moi du troisième homme (2001, traduit de l’espagnol par Edmond Railland, comme Le rapport Stein) est le récit d’un garçon, le fils du capitaine Eduardo Balmoral affecté durant l’hiver 1949 dans une garnison du Nord de l’Espagne. La première image qu’il en garde, c’est celle de ses parents dansant au milieu de la rue en revenant du cinéma où ils avaient vu Le troisième homme. « Depuis lors ma vie a été un long épilogue à la vie de Harry Lime. Depuis lors ma vie a été une suite d’accords de cithare à la poursuite de Harry Lime. »

Ils ont d’abord habité à l’hôtel Bristol, d’où il pouvait voir, de la fenêtre de sa chambre, son père revenir de la batterie sur ses skis. « Toute vie s’appuie sur la mémoire et la mémoire est pure fantasmagorie. » Luis Duncan, le seul civil de l’hôtel – « Don Luis Duncan de Rivera » sur ses cartes de visite – fumait de gros cigares ; propriétaire du cinéma et du café Mundial, il était toujours au courant de tout à propos du gouvernement ou de Franco.
Dans la garnison dirigée par le colonel Montero, flanqué d’une épouse hautaine et de deux caniches, O’Callaghan, son ordonnance (poste refusé par Balmoral) élève seul ses trois filles, Leonor, Claudia et Irene. Quand les premières lettres anonymes contre Franco apparaissent, plus que d’éventuels maquisards, elles deviennent le premier souci dans la place, sauf pour l’épouse du commandant – « Moi, ma fille, c’est Balenciaga qui m’habille ou rien ».
Les mots anonymes se multiplient, circulent bientôt sur des billets de banque chinois. Madrid envoie deux hommes, dont le capitaine Alberto Horsch avec qui Eduardo Balmoral avait été au front, « et ensemble ils avaient connu ma mère à Madrid, au cours d’un voyage que mon grand-père lui avait promis lorsque la guerre serait finie. » On soupçonne Luis Duncan.
Parle-moi du troisième homme raconte cette affaire et surtout la vie de garnison, les familles des militaires, les rencontres troublantes – Claudia sera pour le narrateur « l’impératrice de l’hiver » – et les changements dus aux arrivées ou aux départs. Le garçon est seul avec sa mère à la villa Edelweiss, son père parti en manœuvres pour dix jours, lorsqu’arrive son oncle Jaime Doval, lieutenant d’infanterie, le mari de la sœur de sa mère. Celui-ci l’emmène avec lui en France dans une Duesenberg réquisitionnée.
L’adolescent a les yeux bien ouverts, qui enregistrent tout comme une caméra. Dans la boîte à gants, il voit le même carnet de moleskine noir que celui où son père prend des notes, un appareil photo, un pistolet. A la frontière française, l’autre passeport montré par son oncle et la croix de Lorraine qu’il épingle à sa veste. Au retour, surtout, il observe l’homme muet installé sur le siège devant lui, qu’il doit ramener à Barcelone – son oncle ne remarque pas qu’en lui touchant accidentellement la tête, son neveu l’a sentie froide comme la mort. Malaise.
Changement d’atmosphère : sa mère l’emmène chez elle pour Noël, c’est-à-dire dans la maison des grands-parents sur l’île (Majorque), « la maison des femmes ». Sa grand-mère Amélia, qui a vécu aux Indes, y dirige tout de son fauteuil, les tantes, l’oncle Ramón qui vit seul à l’entresol, le grand-père qui travaille à son encyclopédie de l’art militaire, Nani la servante et sa propre mère, si différente quand elle est dans cette maison.
« Tout le monde choisit pour vivre un endroit situé à mi-chemin entre ce qu’il sait et ce qu’il peut, c’est inévitable » lui avait dit son père. Ici, c’est sa grand-mère qui l’éduque : « apprends, plus tu apprendras tôt, mieux cela vaudra, comme ça tu pourras tout comprendre, et celui qui comprend tout pardonne tout et rien ne peut lui faire de mal. » Pour elle, il importe d’être craint et de garder les apparences.
Le dîner de Noël avancé à la veille de leur départ est l’occasion pour José Carlos Llop de peindre un grand tableau de famille, et la vision inoubliable qu’en gardera le narrateur, notamment de sa mère radieuse comme jamais il n’en a été témoin : « et je sus que ma vie serait une vie parmi les ombres, une vie à poursuivre des ombres ».
Le romancier a l’art de choisir pour ses chapitres des titres qui titillent l’imaginaire du lecteur, du premier, « Ascendance viennoise », au dernier, « Le sabre de mon père ». Différentes choses vont se préciser, parfois dramatiquement, au retour à la garnison : ce qui se passe entre ses parents, les rivalités politiques et militaires, sa relation avec Claudia, l’affaire des billets anonymes. Huit ans plus tard, le garçon devenu jeune homme choisira son camp.
Parle-moi du troisième homme est un roman d’atmosphère et une succession d’images vues ou réinventées. José Carlos Llop y déploie son talent de conteur, son œil, son sens du rythme. On y croise plus d’un trio, mais pour le jeune Balmoral, c’est dans le triangle familial que tout prend racine. Dans un entretien paru au Figaro en 2006, le romancier déclarait : « La famille est le vrai roman de l’individu. Aux chapitres qui se succèdent en lui répondront les chapitres de sa relation au monde. Et quand je dis monde, ici, je veux parler de la littérature. »
 « Mon père et moi n’étions pas seuls parce que nous avions ma mère, mais parfois je doutais que notre famille fût une famille. Lorsque nous restions seuls à la maison, j’avais l’impression que nous étions deux fantasmagories silencieuses dont la vie aurait été en latence, et que cette vie n’acquerrait de sens qu’au moment où ma mère franchirait le seuil de la maison et où nous entendrions le tintement de ses clefs et le son de son parapluie dans le porte-parapluies de métal, le culot d’un obus d’une guerre ancienne et oubliée, les arbalètes et les heaumes de la tapisserie. Pendant les heures que durait son absence, chacun d’entre nous vivait au milieu de ses affaires comme un animal en état d’hibernation. »
« Mon père et moi n’étions pas seuls parce que nous avions ma mère, mais parfois je doutais que notre famille fût une famille. Lorsque nous restions seuls à la maison, j’avais l’impression que nous étions deux fantasmagories silencieuses dont la vie aurait été en latence, et que cette vie n’acquerrait de sens qu’au moment où ma mère franchirait le seuil de la maison et où nous entendrions le tintement de ses clefs et le son de son parapluie dans le porte-parapluies de métal, le culot d’un obus d’une guerre ancienne et oubliée, les arbalètes et les heaumes de la tapisserie. Pendant les heures que durait son absence, chacun d’entre nous vivait au milieu de ses affaires comme un animal en état d’hibernation. »