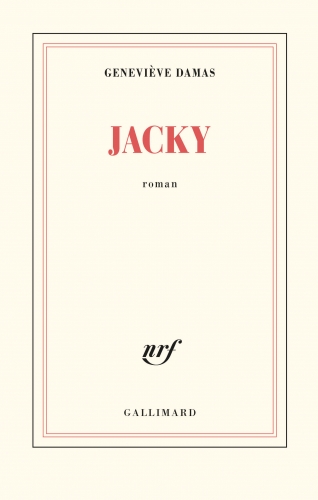« Ecrire la vie ». Annie Ernaux, cherchant en 2011 un titre pour le Quarto rassemblant son œuvre, a choisi celui-ci « comme une évidence » : « écrire la vie. Non pas ma vie, ni sa vie, ni même une vie. La vie, avec ses contenus qui sont les mêmes pour tous mais que l’on éprouve de manière individuelle : le corps, l’éducation, l’appartenance et la condition sexuelles, la trajectoire sociale, l’existence des autres, la maladie, le deuil. »
Annie Ernaux - Les armoires vides (1974) (Archives de la RTS / Vidéo YouTube)
Pour la biographie qui ouvre ce gros volume, elle a préféré au déroulement factuel « l’alliance de deux documents personnels, l’album photo et le journal intime ». Dans cette « sorte de photojournal », les clichés suivent l’ordre chronologique, mais pas les extraits, choisis en fonction des photos. Cela permet de voir et de lire un parcours familial et social à travers les photos de sa famille, des lieux où elle a vécu – le café-épicerie de ses parents et Yvetot d’abord – et d’elle-même aux différentes périodes de sa vie.
Il en ressort un leitmotiv de son œuvre : le désir de retrouver ce passé enfui ou enfoui pour le revivre dans l’écriture. « Je ne suis pas culturelle, il n’y a qu’une chose qui compte pour moi, saisir la vie, le temps, comprendre et jouir. » (1989) – « Revivre tout mais sans la douleur. Cette chose n’existe que dans l’écriture, par l’écriture. » (2001)
Les armoires vides, son premier roman publié en 1974 (à 34 ans), est un coup de poing. Durant son avortement, par une « vieille » qui brandit « une petite sonde rouge, toute recroquevillée, sortie de l’eau bouillante », la narratrice, Denise Lesur, décrit ses sensations, tout ce qui lui traverse l’esprit – rien dans la littérature qui puisse aider « une fille de vingt ans qui est allée chez la faiseuse d’anges, qui en sort, ce qu’elle pense en marchant, en se jetant sur son lit » –, la nausée, l’impossibilité de se concentrer sur quoi ou qui que ce soit, même ses parents.
« Voir clair, raconter tout entre deux contractions. Voir où commence le cafouillage. Ce n’est pas vrai, je ne suis pas née avec la haine, je ne les ai pas toujours détestés, mes parents, les clients, la boutique… Les autres, les cultivés, les profs, les convenables, je les déteste aussi maintenant. J’en ai plein le ventre. A vomir sur eux, sur tout le monde, la culture, tout ce que j’ai appris. Baisée de tous les côtés… »
Avec réalisme et dans un langage cru, elle raconte comment on vivait chez eux, la bonne marche du café-épicerie des parents avec sa « clientèle à gogo », son père tenant le bistrot, sa mère la boutique, en bonne commerçante. Elle se rappelle les histoires racontées, les conversations chuchotées, et pour elle, « la profusion, tout ce qui se mange est offert dans les rayons » où elle touche à tout, les jeux avec son amie Monette et les autres du quartier de la rue Clopart – le temps où seuls ses parents étaient « des gens comme il faut ».
La coupure a lieu à l’école libre où sa mère l’a inscrite pour qu’elle apprenne à bien se tenir, à bien causer, « la bonne éducation ». Là, elle ne reconnaît rien : il y a « un monde » entre le milieu de cette école, ses manières, son langage, et le leur. C’est le début d’un « faire comme si continuel », pour « faire comme tout le monde ». La comparaison inévitable entre les deux mène à l’humiliation – « Je me sentais lourde, poisseuse, face à leur aisance, à leur facilité, les filles de l’école libre. » L’image bourgeoise de la société véhiculée par l’enseignement reçu lui semble fallacieuse ; il y a un gouffre entre ces deux mondes.
« Au fond, c’est la faute de ma mère, c’est elle qui a fait la coupure ». Elle voulait que sa fille devienne « quelqu’un », sans mesurer combien son regard changerait sur ce milieu de « boutiquiers cracra », combien elle aurait honte de sa famille. Denise se réfugie dans les devoirs, les livres, les « dix sur dix » répétés, s’éloigne, se tait. Elle trouve ses parents supérieurs à leurs clients, mais lamentables avec ceux qui leur sont supérieurs, « minables ».
Au fur et à mesure de son excellent parcours scolaire, elle observe leur manque d’éducation, la grossièreté de leur mode de vie et de leur langage, de la maison sans entrée ni w-c. Elle n’a plus grand-chose à leur dire, bien qu’ils lui paient tout ce qui lui fait envie – « Ne pas pouvoir aimer ses parents, ne pas savoir pourquoi, c’est intenable. » Quand ses premières règles surviennent, elle se sent renaître, explore son corps, court les garçons. Premiers baisers, premières caresses, le goût du plaisir.
Devenir étudiante à la fac de lettres, avoir une chambre à la Cité universitaire, c’est le couronnement de ses grandes lectures, « la vraie supériorité » qui la libère de ses parents chez qui elle retourne de moins en moins. Entre étudiants, pas d’étiquette – on se rencontre dans les amphis, à la bibliothèque (« l’église à livres », son grand bonheur). Elle emprunte aux autres « des manières, des mots, des goûts ». Quand elle rencontre Marc, étudiant en droit, au baratin si supérieur, elle veut lui ressembler.
Plaisir de « grimper », plaisir d’être appréciée par les profs, plaisir de réussir, plaisirs du corps. Mais une fois enceinte, « la dé-fête, ça va vite ». Marc n’a plus de temps pour elle, « l’exam… » Dernières phrases, de retour dans sa chambre après l’avortement : « Je ne voudrais pas crever. La concierge est toujours en bas, le dimanche, à la Cité. »
Avec Les armoires vides, Arnie Ernaux fait une entrée fracassante dans la littérature française. Elle choque en parlant d’un sujet tabou, l’avortement (elle y reviendra dans L’Evénement en 2000), de choses qu’on ne dit pas et dont on n’a jamais parlé comme ça, dans le désarroi, l’emportement, la révolte. Elle réussit à rendre avec intensité ces choses vécues qui lui reviennent et la remplissent de sentiments contradictoires – une sorte de bilan pour mémoire, cherchant et trouvant les mots pour l’écrire.