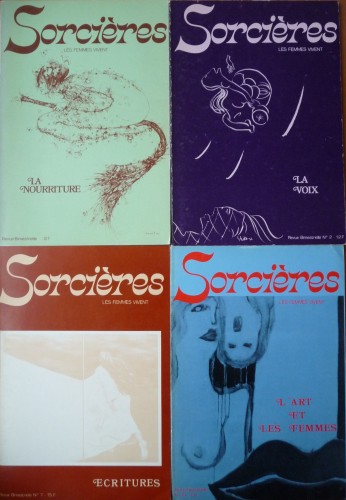Splendeurs et misères du travail, l'essai d’Alain de Botton quitte les voies de l’industrie et du transport pour nous amener à contempler un peintre au travail. Stephen Taylor peint depuis cinq ans le même chêne auprès duquel il se rend dans une vieille Citroën avec tout son matériel, à nonante kilomètres au nord-est de Londres, « submergé par le sentiment que quelque chose dans cet arbre très ordinaire demandait à être peint, et que s’il parvenait à lui rendre justice, sa vie serait, d’une façon indistincte, justifiée, et ses épreuves sublimées. » Taylor a vu ce
chêne pour la première fois, cinq ans avant, après la mort de sa petite amie. L’art de peindre les feuilles lui a été enseigné par Homme à la manche bleue du Titien, à la National Gallery : « Titien lui avait appris l’économie : comment suggérer les choses plutôt que les expliquer ».
VII. Pylones et câbles raconte un tout autre voyage, en voiture et à pied avec un installateur de pylônes pour suivre l’itinéraire d’une des lignes à haute tension les plus importantes du Royaume Uni. 542 pylônes, 175 km. Le compagnon d’Alain de Botton lui montre son encyclopédie de poche des pylônes, de toute taille et de toute forme. Il lui explique « l’effet de couronne », ce bruit intense sous la ligne, la composition du câble, nonante et un brins d’aluminium tordus comme une corde.
En le voyant noter des équations qui calculent la force gravitationnelle exercée sur le câble, Botton envie les ingénieurs pour leur langage concis et international, rêve d’un pareil code applicable aux sentiments. Comme les moulins à vent ont été magnifiés par les peintres paysagistes hollandais, il faudrait que les pylônes à haute tension et leurs câbles soient appréciés à leur juste valeur, et qu’on ne les efface plus des paysages de cartes postales.
Le chapitre sur la comptabilité a pour décor un de ces nouveaux immeubles de verre
le long de la Tamise, avec leur hall où « l’attente semble être la plus ancienne activité humaine ». Dans une entreprise de cinq mille employés, Botton a l’occasion d’observer les comportements durant une journée de travail. Réveil à cinquante kilomètres de Londres. Dans le train, lecture du journal – « Lire le journal, c’est porter un coquillage à son oreille et être assourdi par le brouhaha de l’humanité ». Au bureau, chacun joue son rôle. « Qu’il est rassurant d’être cantonné dans un certain rôle par l’idée que les autres se font de soi, au lieu d’être contraint de songer, dans la solitude du petit matin, à tout ce qu’on aurait pu être et ne sera jamais… » Le bien-être mental des employés est devenu une préoccupation majeure des patrons.
Tout autre est l’univers des inventeurs, des petits entrepreneurs. A leur salon annuel, Botton a rendez-vous avec un Iranien inventeur de « chaussures qui marchent sur l’eau », mais celui-ci est retenu à l’aéroport où on le traite comme suspect de terrorisme. Un compatriote inventeur d’une protection anti-collision vient à sa place. Admiratif de l’esprit d’entreprise, de toutes ces personnes convaincues du potentiel
de leur innovation, l’essayiste est douché par les statistiques qu'on lui communique : 99,9 % de ces candidats échouent, preuve que « nous préférons finalement l’excitation et le désastre à l’ennui et à la sécurité ». Mais il suffit d’un « Sir Bob » à la réussite stupéfiante pour ressentir devant ces héros de la réussite commerciale une envie mêlée d’un sentiment d’insuffisance.
Le dernier chapitre intitulé Aviation découle d’une commande par un journal slovène d’un article sur le Salon du Bourget. Du représentant solitaire de l’Arabie Saoudite assis au milieu d’un stand luxueux mais vide aux jeunes et timides responsables du marketing d’un nouveau jet japonais, Alain de Botton observe les choses et les gens, inlassable curieux de notre monde, philosophe intéressé par nos grandeurs et nos petitesses. Pour conclure Splendeurs et misères du travail, l’auteur, aux accents parfois mélancoliques, observe que finalement, l’importance exagérée que les mortels donnent à ce qu’ils font, « loin d’être une erreur intellectuelle, est en réalité la vie elle-même coulant en nous ».