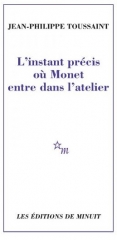Voici un livre passionnant qui m’a fait sourire tout du long. María Gainza, journaliste argentine et critique d’art, nous invite à Buenos Aires dans son premier roman, Ma vie en peintures (El nervio óptico, 2014, traduit de l’espagnol par Gersende Camenen, 2018). « Les aspects visuels de la vie ont toujours eu pour moi plus de poids que sa substance. » (Joseph Brodsky) « « Je vais regarder le petit tableau », dit Liliana Maresca après avoir pris sa dose de morphine. » (Lucrecia Rojas) Les deux épigraphes donnent le ton.
L’imaginative María Gainza mêle avec verve choses vécues et choses vues dans un récit par épisodes où la narratrice parle d’elle-même, de sa famille, de ses amis tout en racontant ses rencontres avec des peintures. « Le cerf de De Dreux » commence avec une pluie soudaine et le passage d’un taxi qui l’éclabousse. Trempée, la petite robe jaune qu’elle porte ce jour-là pour « faire visiter une collection privée à un groupe d’étrangers. C’est ce que je faisais dans la vie et c’était pas mal comme travail […] » Après l’orage, une voiture dépose un couple d’Américains, « elle en blanc et lui en noir, impeccables et parfaitement secs, comme si leur chauffeur venait de les récupérer chez le teinturier. »
L’hôtesse, qui l’a « scannée de haut en bas » à son arrivée, a le bon goût de lui prêter des « pantoufles blanches poilues », ridicules. « Tout ce qu’il me restait, c’était le trait d’esprit, le coup d’œil sagace, et j’étais plus ou moins remise en selle lorsque je suis tombée sur un cheval gris pommelé qui galopait dans ma direction sous un ciel couleur d’étain. » La femme en gris remarque l’hésitation dans son regard et décoche : « Alfred de Dreux. On ne vous en parle pas à l’université ? A propos du dix-neuvième siècle ? »
Je vous donne ces détails du préambule ironique à sa rencontre avec « La chasse au cerf » au musée national d’Art décoratif pour rendre l’atmosphère du livre de María Gainza – des illustrations permettent de découvrir les œuvres, de différents musées de Buenos Aires. « Tout l’art se joue dans la distance qui sépare ce que l’on trouve joli de ce qui nous captive. » Quand elle décrit et commente un tableau, c’est sur le même ton primesautier qui donne tant de sel à ce roman dont chaque chapitre peut se lire comme une nouvelle. Chacun raconte une histoire autour de l’œuvre d’un artiste, célèbre ou non.
Dans Ma vie en peintures, une scène de chasse peut mener à une assiette de gibier ou à la balle perdue qui a emporté une amie, un brouillard « de lin » causé par des brûlis de pâturages hors contrôle à un petit musée à l’autre bout de la ville, un coup de téléphone du frère de la femme de son premier mari au souvenir d’un feuilleton télévisé. Au passage, on découvre des ruines en tous genres et le dialogue difficile de la narratrice avec une mère issue du milieu patricien qui la considère comme « celle qui a gâché sa vie, la petite gauchiste distinguée qui vit comme une paria. »
Ce qui rend le roman très vivant, c’est ce mélange d’observations et d’anecdotes avec les considérations esthétiques d’une amatrice d’art pour qui les musées sont un but de promenade idéal, qui examine la peinture sans souci des conventions en la matière et trouve les mots pour décrire son dialogue personnel avec une œuvre.
Elle se souvient par exemple d’avoir accompagné son père avec Alexia, sa sœur de cœur, chez un peintre animalier à qui son père achète un chat hyperréaliste. Trois ans plus tard, lorsque les deux amies découvrent un autoportrait de Foujita avec son chat, elle devine immédiatement le verdict d’Alexia : « A côté de ce chat, celui de ton père a l’air empaillé. » Un séjour à Mar del Plata avec des amis surfeurs et voilà « Mer orageuse » de Courbet, « la vie avec tout son panache ». Une visite chez l’ophtalmo pour l’œil droit qui papillote et voici Rothko sur un poster dans la salle d’attente.
María Gainza montre beaucoup d’aisance à raconter quelques épisodes de sa vie et à nous rappeler en même temps, sans lourdeur ni superficialité, le parcours des peintres évoqués. Je n’ai pas encore signalé les nombreuses citations littéraires qui se glissent dans son roman comme si de rien n’était. La littérature, l’art, l’écriture, ce sont ses joies, à n’en pas douter, et elle sait les partager.
Remarqué sur les blogs d’Annie, de Keisha et de Marilyn, Ma vie en peintures présente en couverture « Jeune fille assise » du peintre argentin Augusto Schiavoni – pour María Gainza sa « copie conforme » : « J’étais comme ça à onze ans, les yeux écartés, glacials comme la pointe d’une aiguille, la mine renfrognée, le menton frondeur. » Et plus loin, cette phrase avec laquelle je conclus : « Toute interprétation n’est-elle pas aussi une autobiographie ? »