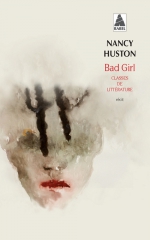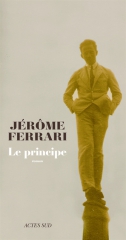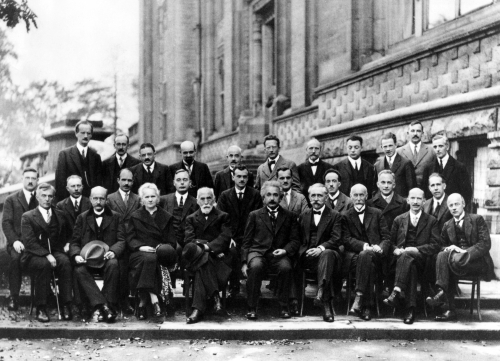On n’a pas d’âge avant de naître. Dans Bad Girl. Classes de littérature, Nancy Huston s’adresse à son « moi, fœtus » dans un témoignage intime sur les sources de soi, une « autobiographie utérine ». Première page :
« Toi, c’est toi, Dorrit. Celle qui écrit. Toi à tous les âges, et même avant d’avoir un âge, avant d’écrire, avant d’être un soi. Celle qui écrit et donc aussi, parfois, on espère, celui/celle qui lit.
Un personnage. »

Nancy Huston / Photo Fanny Dion (Elle Québec)
D’abord voici Kenneth et Alison, ses parents, qui l’ont conçue un jour de « Boxing Day » (le jour où on met les cadeaux de Noël dans des boîtes). Quand sa mère se découvre enceinte, son cœur cesse de battre. Avant d’en parler à Kenneth, « elle saute et saute et saute et saute et saute ». Dorrit, la « mauvaise nouvelle », s’accroche. Bébé Stephen, son frère, fait des siennes dans la petite maison de Calgary (Canada).
Sans se limiter à l’histoire familiale, Nancy Huston convoque sur le thème du désir ou du rejet d’enfant, de l’avortement, d’autres époques, d’autres cultures, d’autres témoignages féminins. « Plus tard, Dorrit, dans ta vie française, tu écriras un article recommandant que l’on érige un monument à l’Avortée inconnue, martyre de la société au même titre que le Soldat inconnu. »
Quand le désir sexuel conduit à une vie nouvelle, écrit Huston, celle-ci inévitablement se relie « à travers sa famille et son peuple, au passé et à l’avenir ». Autrement dit, « nous ne tombons pas du ciel, mais poussons sur un arbre généalogique ». Dorrit aura tendance à se réfugier « dans l’identité juive » qui n’est pas la sienne – elle aurait aimé « une mère juive », envahissante mais aimante, au lieu d’une mère qui l’ignore et, pire encore, va les abandonner.
L’empreinte du père, elle la reconnaît en elle-même, sa philosophie mi-chrétienne mi-pragmatique inspirée de ses insuccès financiers : la non-importance de l’argent, la priorité de l’amour et du partage, l’éducation permanente. Lui a été un père « merveilleux », « proche et attentif avec tous ses enfants ». La découverte de sa confusion mentale n’en sera que plus troublante.
Propos d’écrivains sur le terreau familial, pratiques d’artistes, citations alternent avec l’enquête familiale sur les ancêtres des deux côtés, maternel et paternel. Leurs parents ne pouvaient prévoir que Kenneth et Alison « redégringolent la pente pour se trouver aux prises avec la pauvreté, la difficulté et la violence, la boue et la folie. »
Un passage entre parenthèses : « Les gens te demanderont souvent pourquoi la famille est ton thème romanesque de prédilection, et tu les regarderas, perplexe. Y en a-t-il d’autres ? (…) De quoi d’autre un roman pourrait-il bien parler ? » Me voilà perplexe, à mon tour.
« Pour Beckett, la bio n’est rien ; seule compte la graphie. « Je n’aurais pu, écrit-il, traverser cet affreux et lamentable gâchis qu’est la vie sans laisser une tache sur le silence. » Comme lui, tu seras graphomane. Comme lui, tu abandonneras ta langue maternelle, la traiteras comme une langue morte, n’y reviendras que des années plus tard, essentiellement dans l’écrit. Comme Beckett aussi, tu auras des élans meurtriers à l’égard de tes propres idées naissantes. On conçoit… ? Mais non, voyons. On zigouille. »
La mère de Dorrit, « prototype de la Femme moderne », échoue dans son rôle de mère, pas certaine que ce soit « cela qui confère du sens à la vie d’une femme. » – « Alors accroche-toi, Dorrit, parce que cette maman-magicienne superperformante va exécuter quelques tours de passe-passe avant de prendre la clef des champs. »
Il est aussi beaucoup question de lecture (dès quatre ans et demi) et d’écriture dans Bad Girl. De musique et de piano, de chansons. « Tu t’accrocheras au son des voix humaines comme à une drogue, à une perfusion intraveineuse. Oui, c’est de la compagnie, au sens beckettien du mot. Jusqu’à ta mort, des personnages jacasseront dans ta tête. » « Classes de littérature », on l’aura compris, ce sont les souvenirs, les expériences, les ressentis – tout vécu nourrit celle qui écrit. Bad Girl creuse la question de l’origine, des influences, de la construction de soi.
Sans être un méli-mélo, ce récit souffre à mon avis du morcèlement, de redites, comme s’il fallait toujours insister pour être bien comprise. Nancy Huston avait certes besoin d’écrire ce texte pour elle-même, elle s’y adresse à elle-même, Dorrit, dans le ventre de sa mère. Quant aux lecteurs, s’ils trouveront là une foule de clés personnelles pour lire ou relire son œuvre, ils se sentent – c’est mon impression – pris à témoin de sa frustration et tenus à distance.
« Il serait hasardeux de raconter davantage ce livre fait de très courts chapitres agencés comme autant de touches impressionnistes qui peu à peu dessinent une femme, un écrivain, un personnage. Soutenu par un rythme rapide, la narration est dense, lucide, frémissante d’une douleur contenue. Essentielle sûrement pour celle qui en a écrit et pour ceux qui voudront la rejoindre au plus près. Et au plus vrai. » (Monique Verdussen, Une blessure d’enfance récurrente, La Libre Belgique, 17/11/2014)