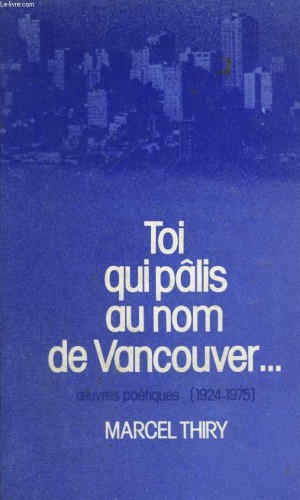Ensor, Après l’orage
Ensor, Après l’orage
« Parler d’orage et d’herbage d’avant l’orage
A quelqu’un au secret des prisons, qui le peut
Sinon celle qui sans irais-je et sans qu’y peux-je
Sait traverser, moderne aux pieds nus, le blindage,
Sait dissiper de paumes d’ange le blindage
De cette chambre forte où quelqu’un est captif ?
C’est la porteuse d’eau des mots, la narrative,
La conteuse du vert urgent quand vient l’orage,
Dit-elle, « et tout, la haie et l’ortie, a changé,
Et sache que le bleu au revers des ombrages
Devient de bronze de cloche immobile avant
Que tonne grave un premier tonnerre. Et le vent,
Le voici, je te l’ai apporté, comme il passe
Sur la figure, en linge, ou en parole, ou en
Avant-vague marine et faible et s’échouant…
Que veux-tu, si j’apporte l’Eau, que cela fasse,
L’édit de soif perpétuelle et le mur vain ? »
Vous êtes dans les murs, et moi. Mais elle vient
(On dit qu’il vaut mieux que je vous le dise,
Ma moderne aux pieds nus, c’est Poésie.
Je ne veux plus qu’on bâille que c’est difficile
A comprendre, et j’expliquerai docilement
Qu’elle est moderne étant chaque jour inventée,
Qu’elle est pieds nus parce que simplement
Ses pieds vont clairs dans la ville surhabitée,
Qu’elle rend bien, comme nous le disions à l’école,
L’odeur de l’herbe avant l’orage, ou les sonnailles
D’un troupeau invisible ; et pour nous visiter
Là où vous savez trop, comme moi, que nous sommes,
Qu’elle est seule à savoir traverser les murailles. »
Marcel Thiry, Le Festin d’attente, 1963