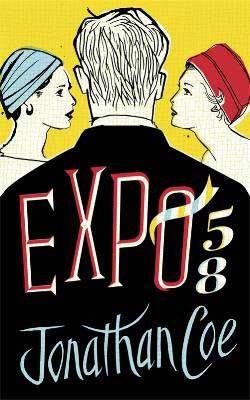« Sensation et sensualité, Rubens et son héritage » : il y a foule au Palais des Beaux-Arts pour cette exposition riche d’œuvres en provenance du monde entier, organisée avec le Musée des Beaux-Arts d’Anvers et la Royal Academy Of Arts de Londres. Pas de présentation chronologique, mais autour d’une belle sélection d’œuvres de Rubens, son héritage artistique, en six thèmes : violence, pouvoir, luxure (ci-dessous un détail de Pan et Syrinx en couverture du catalogue), compassion, élégance et poésie.
Pourquoi, comment Rubens (1577-1640) a-t-il influencé tant de peintres ? Voilà le sujet. De nombreux artistes français, allemands, espagnols, anglais, se sont inspirés de son art. Les œuvres exposées permettent d’observer comment ils reprennent et interprètent ce qui les a séduits chez le grand maître flamand. Pour découvrir ce parcours thématique, je vous renvoie au dossier de presse et au guide du visiteur (GV) sur le site de Bozar. Devant la surabondance, je renonce à toute synthèse.
Pour ma part, j’ai envie de vous parler d’un tableau qui m’a particulièrement plu parmi les « héritiers » de Rubens, dans la dernière section : La pêche de Manet (1862-63), un prêt du Metropolitan Museum de New York. C’est un paysage « animé » comme on dit pour signifier qu’il s’y trouve des personnages. Des pêcheurs, forcément : un gamin assis sur la rive, attend que le poisson morde à l’hameçon ; dans une barque, un homme tire ses filets à l’avant ; son passager au chapeau de paille, accoudé à l’arrière, observe la manœuvre d’un jeune homme armé d’une gaffe.
Inattendu, à l’avant-plan, un couple aux vêtements anciens et raffinés, éclairés d’élégants cols blancs, elle en bleu, lui en rouge. Leur chien, un chien de chasse « qui semble sorti tout droit du XVIIe siècle » (GV) observe ce qui se passe sur l’eau, au milieu de la toile. Le couple, lui, tourne le dos à cette scène aquatique et fait face au spectateur, mais en regardant de côté vers le chien, l’homme pointe le doigt dans sa direction.

Edouard Manet, La pêche, 1862-63, New York, The Metropolitan Museum of Art
La datation du tableau est incertaine. Le catalogue Manet de la fondation Pierre Gianadda (1996) cite en premier Antonin Proust selon qui « La promenade » (titre de l’étude correspondante) aurait été peinte entre 1858 et 1860 ; puis Léon Leenhoff (modèle du jeune garçon), qui y a reconnu un paysage de l’île Saint-Ouen (où la famille du peintre avait une propriété) et propose 1861, date de l’installation de Manet dans l’atelier de la rue Guyot où il a peint d’après des croquis de l’île.
L’arc-en-ciel à l’horizon, un village au loin, la flèche d’une église, des baigneuses près d’un bosquet, la signature oblique sur une barque, il y a une foule de choses à découvrir dans cette toile, « image composite, encombrée, mouvementée, diffuse, un mélange de genres, de plaisirs, de loisirs » (catalogue Gianadda), « un étrange mirage de toute beauté » (GV, qui ajoute « même si le tableau manque de vie » – vraiment ?)
Delacroix avait donné au jeune Manet ce conseil : « Il fallait voir Rubens, s’inspirer de Rubens, copier Rubens, Rubens était le dieu. » Et Rubens est bien au centre de cette peinture : l’arc-en-ciel, le chien, les jeunes arbres sont empruntés à son Paysage à l’arc-en-ciel (Louvre). Et le couple ? Ces costumes du dix-septième siècle ? Eh bien, il s’agit d’Edouard Manet et de sa future femme, Suzanne Leenhoff, représentés dans la même pose que Rubens et Hélène Fourment dans Parc du Château de Steen (Kunsthistorisches Museum, Vienne).
La notice du MET rapporte que Manet, ayant caché à son père sa relation avec Suzanne, a sans doute peint cette « variation sur un portrait de noces » entre la mort de son père en septembre 1862 et leur mariage en octobre 1863, ce qui correspond à la datation actuelle. Ce tableau riche d’emprunts à Rubens (et à Carracci) et à sa propre vie (c’est peut-être Léon, fils de Suzanne, né de père inconnu, que Manet montre du doigt, « comme pour « accepter » le garçon dans sa famille », suggère le catalogue Gianadda), était très cher au peintre. La pêche n’a jamais été exposée du vivant de Manet (1832-1883), c’était un « tableau de famille », accroché dans leur appartement.