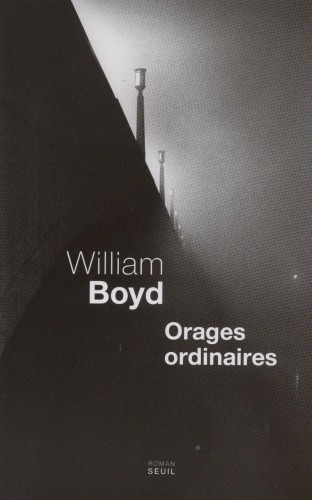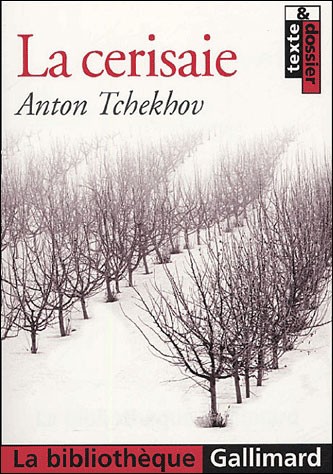Un pont dans une nuit brumeuse, photo en noir et blanc, couvre la jaquette du dernier roman de William Boyd, Orages ordinaires. Après la lecture jubilatoire des Nouvelles confessions, ce romancier anglais a pris quelque place dans ma bibliothèque. La vie aux aguets m'avait passionnée. Les premières pages de ce roman-ci m’ont déconcertée : l’impression de regarder un thriller en découvrant les faits et gestes de son héros, dans la trentaine, en costume trois pièces et attaché-case, Adam Hundred, qui s’attarde au bord du fleuve, près du pont de Chelsea (Londres), avant d’aller manger dans un restaurant italien. Il y remarque un autre « dîneur solitaire ». Les deux hommes se présentent : Hundred est climatologue, l’autre, Philip Wang, est spécialiste en immunologie. Quand Adam Hundred quitte le restaurant, il aperçoit une chemise en plastique qui a glissé entre les sièges, il y trouve un dossier, la carte du Dr Wang et lui propose par téléphone de passer le déposer chez lui.
A l’entrée d’un « imposant immeuble art déco », il signe le registre des visiteurs puis se rend au septième étage : la porte d’entrée du Dr Wang est entrouverte, mais lui ne se montre pas : « Philip Wang gisait étendu sur son lit, dans une mare de sang qui s’élargissait. » Wang, encore conscient, lui demande de retirer d’un coup sec le couteau enfoncé dans son flanc. Hundred hésite, obéit, Wang meurt presque aussitôt. Horrifié, Adam entend un bruit du côté de la salle de bain, reprend le dossier et descend aussi vite et aussi calmement qu’il le peut par l’escalier de secours. Pourquoi avoir touché ce couteau ? Pourquoi ne pas avoir appelé la police immédiatement ? Son nom est dans le registre, le couteau porte ses empreintes, il s’est enfui – quel beau coupable il fait ! Le doute n’est plus permis, ce roman de Boyd est un polar, avec tous les ingrédients du genre, et d'autres cadavres.
Très vite, le tueur est sur ses traces. Il arrive à lui échapper d’un coup d’attaché-case aux angles en cuivre lancé en plein visage de son poursuivant. Il entend les sirènes de la police se rapprocher. Se livrer ? Une « peur indéfinie » le pousse à fuir encore, à se donner du temps. Le triangle de terrain vague repéré près du pont de Chelsea constituera un abri sûr, il décide d’y dormir. C’est sa première nuit clandestine, Adam ignore encore que sa vie a complètement basculé. Il est désormais un homme traqué.
Il lui faudra changer d’apparence, d’identité, de travail pour échapper à ceux qui veulent se débarrasser de lui et mettre la main sur le dossier qu’il a emporté, pour tirer au clair les raisons du meurtre de Philip Wang. Boyd conte cette histoire aussi sous d’autres angles : il y a cette policière, Rita Nashe, écœurée par les scènes de meurtre, qui demande sa mutation dans la brigade fluviale ; il y a ce directeur général d’une société pharmaceutique, Ingram Fryzer, que la nouvelle de la mort du Dr Philip Wang, leur médecin-chef dans l’expérimentation d’un nouveau médicament contre l’asthme, quasi couplée à une commercialisation accélérée du produit au mépris des procédures habituelles, décidée « d’en haut », plonge dans un stress de plus en plus marqué.
« Les orages ordinaires ont la capacité de se transformer en tempêtes multi-cellulaires d’une complexité toujours croissante. » Un meurtre, un témoin suspect, un coupable couvert par on ne sait quelle machine secrète, l’intrigue a de quoi tenir le lecteur en suspens sur près de cinq cents pages. L’amateur de romans policiers appréciera d’emblée, le lecteur moins enclin au roman « d’action », s’il accepte le jeu, le style fonctionnel, y assistera à l’intéressante métamorphose d’Adam Hundred. Comment disparaître dans la foule, devenir personne, survivre dans Londres sans se faire repérer ?
Orages ordinaires se lit donc aussi comme un roman de mœurs, la peinture des bas-fonds alternant avec celle d’entreprises aimantées par le plus large profit possible. Une policière, une prostituée jouent les dames de cœur dans cette histoire cruelle où la moindre erreur est fatale, où la violence est omniprésente, où la résolution d’une énigme risque de coûter le prix fort. Coulisses des sociétés modernes, débrouille quotidienne, relations humaines, ce polar de William Boyd propose un divertissement « néodickensien », le dessin d’une société, d’une ville, une photographie de notre temps.