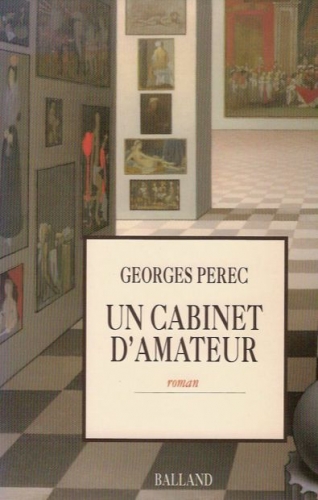L’exposition en cours à la Villa Empain, « Icônes », donne à voir et à réfléchir. On y montre des icônes anciennes (Europe, Russie), des œuvres du XIXe et du XXe où l’artiste « explore la composition frontale et sans profondeur » qui caractérise l’icône, et « l’utilisation que font les artistes contemporains du langage iconographique » (Site de la Villa Empain). De la peinture religieuse à la fabrication d’images, ce parcours invite à s’interroger sur les rapports entre icônes et art.
© Pierre et Gilles, La Madone au cœur blessé – Lio (détail), 1991 – Pinault Collection
La madone de Pierre & Gilles, une photographie peinte contrecollée sur aluminium (1991) présentée dans une niche à l’entrée du grand hall, en donne le ton : « Lio devient, dans son épais cadre doré, une Madone au cœur blessé, visage fragile et douloureux à l’impassibilité de cire et avec tout l’appareil d’une Vierge latine, assurément une icône que l’on verrait vénérée à la lumière des cierges » écrit Henri Loyrette, commissaire de l’exposition, dans l’introduction du guide offert aux visiteurs (source des citations, sauf mention contraire).
© Duane Hanson, Window Washer, 1984,
bronze polychromé et matériaux mixtes, Avec l'autorisation de la Gagosian Gallery, New York
Un rideau de pluie s’abat sur le jardin derrière le Laveur de vitres de Duane Hanson, sculpteur hyperréaliste : ses personnages « à taille humaine » sont moulés sur des modèles et habillés de vêtements de récupération. « Mon travail traite de gens qui vivent dans un désespoir silencieux. » Ouvriers ou sans-abri modelés deviennent-ils pour autant « de nouvelles icônes de notre modernité » ? N’est-ce pas confondre représentation et spiritualité ?

© Yan Pei-Ming, Deng Xiaoping, 2021
Les œuvres exposées dans les salons de part et d’autre accentuent l’impression de « postmodernité ». A gauche, un immense portrait de Deng Xiaoping par Yan Pei-Ming en guise d’hommage. A droite Wim Delvoye, « connu pour son humour », s’est amusé à placer un vitrail dans un but et de revêtir des images, détournées d’un clip, d’ornements ouvragés à la manière des icônes byzantines ornées d’or ou d’argent. Commentant le refus d’exposer ce « clin d’œil aux icônes » essuyé à Moscou, Delvoye s’étonne : « pour une fois », dit-il, il n’y avait aucune ironie dans son travail.
© Annette Messager, Icone, 2013,
Avec l'autorisation de l’artiste et de la Marian Goodman Gallery, NY/Paris/Londres
Dans l’escalier, Icone (sans accent) d’Annette Messager, en fil de fer et filet noir, dénonce la cruauté des stéréotypes sexistes par les déchirures, la chute – des lambeaux. Impression forte de noirceur. A l’opposé des icônes véritables exposées à l’étage, lumineuses. Impressionnante, La Sainte Face du Christ sur le voile de Véronique (1649), une gravure sur cuivre de Claude Mellan, considérée comme son chef-d’œuvre, a été « réalisée en un seul sillon creusé en spirale, dont les épaississements créent l’image ». Non loin sont accrochées des œuvres de Sarkis (Sarkis Zabunyan), un artiste plasticien d’origine arménienne très présent dans l’exposition.

Claude Mellan (1598-1688), Sainte Face du Christ sur le voile de Véronique, 1649,
gravure sur papier, The Phoebus Collection, Anvers
Des citations sont inscrites sur les murs, comme celle-ci : « Ce que le livre est aux gens instruits, l’image l’est pour les analphabètes ; et ce que la parole est à l’ouïe, l’image l’est à la vue » (Jean de Damas dans son discours « Défense des icônes », quand apparaît l’iconoclasme au VIIIe siècle). La pièce suivante présente des icônes religieuses anciennes de toute beauté, de « Paraskeva », patronne des femmes, à « Déisis » où le Christ est représenté entre la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste.
Paraskeva, XVIe siècle, tempera sur bois, collection privée, Bruxelles
Puis l’on passe aux artistes des XIXe et XXe siècles qui ont repris à l’icône la frontalité des visages, le refus de l’accessoire et « toujours quelque trace du sacré ». Dans l’ancienne salle de bain bleue de la Villa Empain, deux beaux petits dessins au crayon et à la gouache, Christ au brin de bruyère et Madone aux deux hermines, prêtés par le musée des Beaux-Arts de Quimper, m’ont fait découvrir la peinture mystique et décorative de Charles Filiger.

© Charles Filiger, Madone aux hermines, vers 1903,
crayon et gouache sur papier, Musée des Beaux-Arts de Quimper
Le Portrait de Max Elskamp (1884) par Henry Van de Velde le représente « telle une figure solaire ou christique ». Elskamp, poète flamand d’expression française, célébrait une Flandre « heureuse, animée par la piété ». Dans la même chambre, « La dame blanche » d’Octave Landuyt, peintre gantois, est plutôt inquiétante avec ses figures figées. Les deux hommes devant cette dame sont-ils de bons ou de mauvais anges ?
© Titus Kaphar, Created in his Likeness, 2020, peinture à l’huile et goudron sur toile,
Fondation CommA, avec l’autorisation de la galerie Maruani Mercier, Bruxelles
J’en resterai là bien que le parcours, très divers, ne soit pas terminé. Parmi les œuvres contemporaines (voir la liste des artistes sur le site de la Villa Empain), une salle rassemble plusieurs œuvres de la série « IKON » de Sarkis, dont un étonnant « Retable » en vitrail et leds. J’ai trouvé très interpellante la peinture à l’huile et au goudron de Titus Kaphar, « Created in his Likeness » (Créé à son image, 2020), ouverte à de multiples interprétations. Une exposition à voir jusqu’au 24 octobre.