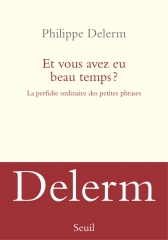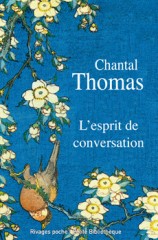Dans la même collection, sur fond de ciel bleu, un Bouvreuil sur une branche de cerisier en fleurs (Hokusaï) annonce L’esprit de conversation de Chantal Thomas. Essayiste (Comment supporter sa liberté, 1998) ou romancière (Le Testament d’Olympe, 2010) cette spécialiste du XVIIe siècle donne ici une centaine de pages sur l’art de converser. Swift, déjà, déplorait que la conversation soit tombée si bas alors que la plupart des hommes pourraient être agréables s’ils ne se laissaient mener par leur orgueil, vanité, mauvais caractère et autres vices « résultant d’une mauvaise éducation ». « Mais, remarque Chantal Thomas, la conversation, les formes de politesse, la délicatesse, ne sont-elles pas des choses que, depuis toujours, on n’évoque qu’au passé ? »

Le déjeuner des dames (école d’Abraham Bosse)
A Kyoto, en décembre, pour échapper à la musique de Noël « sirupeuse » des grands magasins, il suffit de s’éloigner du centre, de marcher dans les ruelles moins éclairées pour retrouver la nuit et entendre « le son feutré des pas, le tintement léger des bicyclettes, un chat qui miaule… » De même, nos messages rapides, inachevés, télégraphiques, nous tiennent à distance du « lent polissage d’un art parfait de s’exprimer. »
Chantal Thomas examine d’abord ce qu’il en est aujourd’hui des « bonheurs de conversation », « échappées belles hors des emprises mortifères de l’ennui, de la bêtise, de l’agressivité. » Quel plaisir quand la conversation « fait naître tout à coup les idées » (Claudel) ! Quel gâchis, « le volume sonore d’un imbécile dont la bêtise triomphale devient identique à l’air qu’on respire » ! Certes, les « discoureurs impénitents » ou les radoteuses nous lassent, mais « il suffit d’une personne avec laquelle une entente privilégiée s’installe, et l’on perd toute notion du temps et du contexte. »
Comment était-ce dans ces salons d’autrefois où résonnaient « des voix qui, un jour, furent vivantes et dont nous ne savons désormais rien » ? Pour s’en rapprocher, Chantal Thomas en évoque trois, du XVIIe au XIXe siècle, avec la marquise de Rambouillet, Mme du Deffand, Mme de Staël. Catherine de Vivonne (1588-1665), marquise de Rambouillet, de santé fragile, reçoit dans sa « Chambre bleue », couleur nouvelle pour l’époque, où elle aime lire, son occupation préférée. Les habitués de son salon « jouent à se donner des noms, à reprendre des situations romanesques, à en développer de nouveaux épisodes. » C’est une sorte de théâtre où on aime avec plus de douceur et de délicatesse que dans la vie réelle, un lieu à l’antithèse de l’espace conjugal, où ses amis tressent pour sa fille préférée La Guirlande de Julie.
Dans le salon de Mme du Deffand, « tendu d’une moire piquée de nœuds rouges », de petits chiens courent un peu partout. A cinquante ans, vers le milieu du XVIIIe siècle, elle a quitté le libertinage pour « commencer une nouvelle vie », convaincue que, la jeunesse finie, on se doit de « posséder son propre espace et ne plus dépendre de la générosité de quiconque. » Tout ennuie Mme du Deffand devenue aveugle, pessimiste invétérée. « Tout sauf le bonheur de la langue, écrite ou parlée. » C’est pourquoi sa société choisie est une drogue qui la sauve du mal de vivre.
Le quatrième chapitre est le plus long, consacré à « Mme de Staël ou le génie de la conversation ». Dans son roman Delphine (1802), celle-ci dresse de ses personnages des portraits « en conversation » : Delphine y brille « spirituellement et verbalement » – c’est, écrit Chantal Thomas, « dans la littérature française, une des premières fois où la puissance intellectuelle d’une femme est davantage soulignée que sa beauté. » Sa trop grande énergie à discuter est jugée inconvenante, comme sera considérée « trop libre » l’étincelante Corinne (Corinne ou l’Italie, 1807).
« Le don de recueillir et d’exalter les idées, un équilibre entre sens de l’écoute et enthousiasme, timidité et audace, justesse de repartie et chaleur oratoire », telles sont les qualités accordées par Mme de Staël à l’esprit d’une femme. La société sanctionne alors cette passion, cette ardeur, ces « germes de rébellion ». Napoléon l’a condamnée à l’exil, elle tente de recréer à Coppet son salon parisien. C’est là que Benjamin Constant fait sa connaissance en 1794 – elle a vingt-sept ans, lui vingt-six – et c’est le coup de foudre pour « Minette » et ces conversations heureuses où on se sent « devenir plus rapide, plus intelligent, plus désirable », une « musique d’amour ».