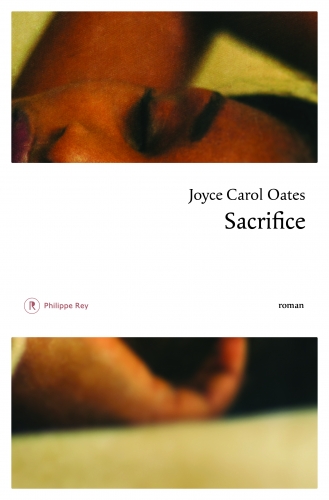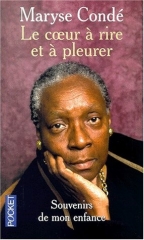Sacrifice de Joyce Carol Oates (2015, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Claude Seban) est lié, note l’autrice à la fin du livre, à son roman Eux (1969), inspiré par des « désordres raciaux urbains » de juillet 1967 à Détroit qui ont donné lieu à de nombreuses études dont elle ne disposait pas à l’époque. En revenant sur ce sujet, elle a construit son roman en donnant la parole tour à tour aux intervenants et témoins concernés par le sort de Sybilla, la fille d’Ednetta Frye (femme d’Anis Schutt, qui n’est pas le père de l’adolescente).
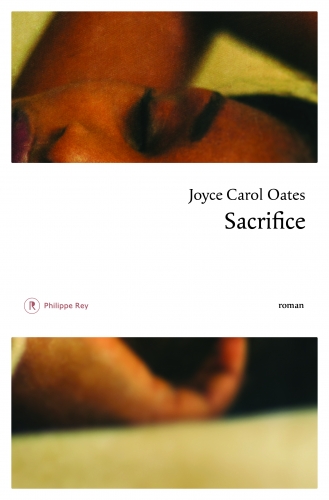
« Quelqu’un a vu ma fille Sybilla ? » Le 6 octobre 1987, à Pascayne (New Jersey), une mère angoissée cherche partout sa fille dans « le bas quartier de Red Rock », « telle une mère de l’Ancien Testament cherchant son enfant perdu ». Elle montre aux passants « des photos d’une jeune fille, sombre de peau, les yeux vifs, une coquetterie dans l’œil gauche et un sourire brèche-dent enfantin. » Ses cheveux noirs sont « épais et frisés », ses yeux en amande d’un noir brillant.
Ednetta la croyait chez sa cousine, elle apprend qu’elle n’est pas allée à l’école le jeudi et personne ne semble l’avoir aperçue nulle part. Mais elle refuse qu’on signale sa disparition ou qu’on appelle la police. Ednetta habite avec Anis Schutt, qui a fait de la prison pour « homicide involontaire » sur sa première femme. Elle fréquente l’église méthodiste. En plus de ses trois enfants, elle a élevé aussi ceux d’Anis – on a tiré en rue sur un de ses fils mort à dix-neuf ans, un autre de vingt-trois ans est en prison pour trafic de drogue.
Le lendemain, Ada, une enseignante, entend, la nuit, « un son faible entre plainte et gémissement ». Elle habite Red Rock et malgré sa mère qui lui dit de ne pas « s’en mêler », elle ne peut « ignorer quelqu’un qui appelait à l’aide ». Des pleurs viennent d’une ancienne usine en ruine, elle y va malgré sa peur, descend dans la cave. La fille « gisait sur le sol crasseux », ligotée, les cheveux pleins d’excréments. Ada est « pétrifiée d’horreur ». Dans ses vêtements déchirés et sanglants, la fille tremble de terreur, puis s’évanouit. Ada sort hurler à l’aide, un voisin appelle le 911. « Qui a fait ça à cette fille ? »
Revenue à elle, Sybilla dit avoir été enlevée, mise dans une camionnette de la police – elle a vu des visages blancs « et l’un d’eux portait un badge comme ont les flics ». Ils l’ont séquestrée, battue, violée avant de la souiller de « merde de chien » et de l’abandonner dans ce sous-sol. Quand les urgences de St. Anne trouvent l’endroit, la fille, en état de choc, mais consciente, refuse de communiquer, Ada ne peut pas monter dans l’ambulance. C’est là qu’ils voient « quelque chose d’écrit sur son corps » : « pute nègre » et « Ku Kux Klann ».
La fille ne se laisse pas examiner complètement ni prendre du sang. Quand sa mère arrive, celle-ci veut la ramener tout de suite chez elle, sans être interrogée par la police, à moins que ce soit « quelqu’un comme elle, et une femme ». Ines Iglesias, une « Hispanique au teint clair » est envoyée pour l’entretien. Sybilla refuse tout enregistrement et même de parler, mais accepte d’écrire quelques réponses sur des post-it : « flic blanc, cheveu jaunes, âge 30, tous blancs »…
JCO raconte comment l’histoire circule dans Red Rock, attire les curieux. La mère les renvoie, elle a emmené sa fille chez sa grand-mère avant le retour d’Anis, à qui elle ne raconte pas tout, elle connaît son caractère. A sa cousine qui la retrouve, Sybilla montre ses blessures, les traces des coups. Quand Anis apprend ce qui s’est passé, « l’Ange de colère » le tourmente à nouveau, lui disant de tuer un de ces flics blancs.
Le racisme de la police à l’égard des noirs suscite la méfiance des deux côtés. Même la collègue hispanique est moquée de croire à ce que raconte la fille. Une avocate du ministère d’Aide sociale demande à Ednetta d’au moins porter plainte, pour qu’une véritable enquête démasque les coupables. Mais ce sont deux frères, un prédicateur en vue et un avocat, qui arriveront à convaincre Ednetta d’alerter les médias. Le bagout du révérend – « nous allons secouer la conscience de l’Amérique blanche […], votre fille est une martyre, mais elle sera bientôt une sainte » – impressionne la mère et la victime. La « croisade » contre l’injustice est lancée.
De chapitre en chapitre, JCO montre la complexité d’une société minée par la pauvreté, les tensions raciales, la violence, la peur, le fanatisme religieux. Les faits initiaux sont déformés, mis en doute, manipulés par ceux qui cherchent à tirer profit de la médiatisation et de la rancœur populaire. Même les lecteurs, devant ces points de vue et ces déclarations contradictoires, se mettent à douter. Qui dit la vérité ? Le roman s’inspire de l’affaire Tawana Brawley, une fausse accusation de viol. Sacrifice décrit « ce cancer qui ronge l’Amérique depuis des lustres – le racisme, que Joyce Carol Oates décrypte dans ce qu’il a de plus ordinaire et de plus insidieux » (Le Temps).
 « Klariss dans l’escalier l’interrogeant sur l’histoire Sybilla Frye.
« Klariss dans l’escalier l’interrogeant sur l’histoire Sybilla Frye.