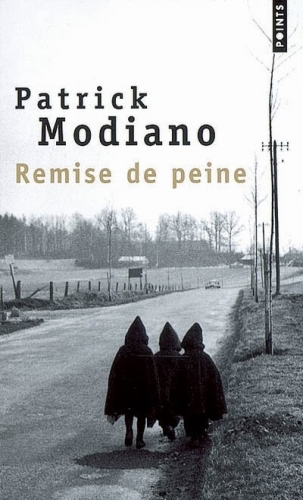Les villes invisibles (1972) d’Italo Calvino sont à présent disponibles en français dans une nouvelle traduction (2019) par Martin Rueff. Celui-ci, auteur de la préface du Métier d’écrire et aussi un de ses deux traducteurs, indique dans une note initiale que « Calvino soutient hautement son parti : Les villes invisibles sont des poèmes en prose. »
Voici comment Calvino ouvre ce dialogue imaginaire entre Marco Polo et Kublai Khan : « Il n’est pas dit que Kublai Khan accorde tout son crédit à Marco Polo quand ce dernier lui décrit les villes qu’il a visitées au cours de ses missions et de ses ambassades, mais il est certain que l’empereur des Tartares continue à écouter le jeune Vénitien avec plus de curiosité et d’attention qu’aucun de ses émissaires ou explorateurs. » (Suite de ce texte liminaire ici.)
Dès le premier texte, le merveilleux apparaît dans la description de « Diomira », ville « aux soixante coupoles d’argent, aux statues de bronze de tous les dieux, aux rues pavées d’étain, au théâtre de cristal, au coq d’or qui chante chaque matin du haut d’une tour » (Les villes et la mémoire, 1). Le deuxième confirme que les villes présentées sont presque toutes nommées d’après des prénoms féminins : « L’homme qui chevauche longuement par des terres sauvages, le désir d’une ville le prend. Il finit par arriver à Isidora, … »
L’invisibilité des villes ouvre tant au merveilleux qu’au rêve. « Isidora est donc la ville de ses rêves : à une différence près. La ville rêvée le contenait lui encore jeune ; il arrive à Isidora déjà vieux. » (Les villes et la mémoire, 2) Même les thèmes indiqués en tête de ces séquences de deux ou trois pages ont de quoi troubler – « Les villes et le désir », « Les villes et les signes », « Les villes élancées » etc. On peut y voir des interférences. « La mémoire est redondante : elle répète les signes pour que la ville se mette à exister. » (Les villes et les signes, 2)
Chacune des neuf parties du livre commence et se termine par un texte en italiques, sorte de commentaire sur les attentes de Kublai Khan et la manière dont « le Vénitien » y répond. Sans tout comprendre – la poésie n’est pas affaire de compréhension, il est vrai –, j’ai lu Les villes invisibles comme une traversée sans boussole de l’espace et du temps. « En somme, il était indifférent entre eux que les questions et les solutions fussent énoncées à voix haute ou que chacun des deux continuât à les remâcher silencieusement. De fait, ils restaient muets, les yeux mi-clos, étendus sur des coussins, se balançant dans des hamacs, fumant de longues pipes d’ambre. » (Texte d’ouverture de la deuxième partie)
Plus loin, lorsque Marco Polo précise que « du nombre des villes imaginables, il faut exclure celles dont les éléments s’ajoutent sans un fil qui les tienne ensemble, sans une règle interne, une perspective, un discours », on se souvient qu’Italo Calvino s’intéressait à l’Oulipo. Rappelez-vous ce passage de Si par une nuit d’hiver un voyageur : « On le sait : c’est un auteur qui change beaucoup d’un livre à l’autre. Et c’est justement à cela qu’on le reconnaît. Mais il semble que ce livre-ci n’ait rien à voir avec tous les autres, pour autant que tu te souviennes. Tu es déçu ? »
Dans Les villes invisibles, je suis parfois restée à distance des villes décrites, mais jamais des commentaires en italiques, éclairant les enjeux du dialogue entre Marco Polo et l’empereur de Chine. Ils m’ont aidée à aller de l’avant, à poursuivre, à me laisser aller au texte sans plus me poser trop de questions. Villes vues de loin, dans l’ensemble, avec leurs édifices, leurs habitants, leurs jardins, villes sur pilotis ou pleines d’escaliers, villes hors du temps où nous reconnaissons des éléments modernes, elles sont toutes « inventées » comme l’écrit Calvino pour présenter une réédition des Villes invisibles en 1993.
Dans ce texte (repris à la fin du Folio), il explique l’écriture du livre « pièce par pièce » et son organisation en « 11 séries de 5 textes ». Très éclairante a été pour moi l’analyse de Delphine Gachet sous le titre « Repenser l’utopie citadine : Les Villes invisibles de Calvino ». Elle y rappelle qu’en 1972, l’écrivain italien vivait à Paris et a rejoint l’Oulipo comme « membre étranger ». Il s’intéressait aux « séries de Fourier ». Calvino a opté ici pour une structure qu’un schéma inattendu fait apparaître clairement (§ 17). Dans les Cahiers d’études romanes, Perle Abbrugiati propose une autre approche intéressante : « Visions de l’Ailleurs dans Les villes invisibles d’Italo Calvino ». Ces articles donnent des clés pour mieux aborder cette œuvre si mystérieuse.