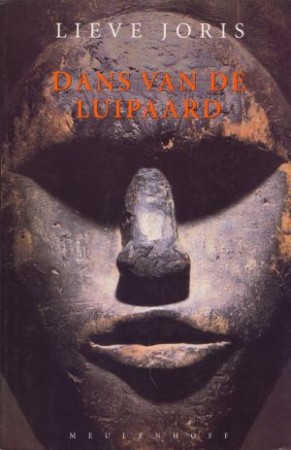Conservés dans « les armoires bleues de Neauphle-le-Château » où elle a longtemps vécu, les quatre Cahiers de la guerre de Marguerite Duras contiennent des ébauches de récits, des souvenirs, le journal de sa vie pendant la guerre et des textes divers, inédits jusqu’en 2006. Duras avant Duras.
Le cahier rose marbré, le premier, prépare Un barrage contre le Pacifique (1950), inspiré par le désastre de sa mère en Indochine. Enseignante et veuve de fonctionnaire, celle-ci avait cru leur fortune faite en obtenant du gouvernement général une concession de rizières. Toutes ses économies y étaient passées. Mais elle ignorait que la mer, régulièrement, noyait ces terres, et que les crabes auraient raison, jour après jour, des barrages qu’elle ferait construire pour protéger les plantations.

La mère et l’argent émergent de ces années-là, indissociables : « (…) ma mère nous avait inculqué un sentiment quasi sacré de l’argent. Sans lui, on était malheureux. » Quand Marguerite a quatorze ans, son frère aîné, qui étudiait en France, revient. Habituée aux coups de sa mère, « quand ses nerfs la lâchaient », elle doit subir alors la violence du frère aîné, ses injures à ce point continuelles qu’elle écrit à leur sujet : « Je ne peux les entendre sans qu’il me monte jusqu’à l’âme le goût même de ma jeunesse, elles ont le nimbe des étés passés à jamais, des colères vives et crues de mes quinze ans. »
Cette enfance sauvage ne lui permet pas de s’intégrer dans la société blanche de Saigon, où elle découvre avec étonnement « l’amabilité » - « Je la croyais l’apanage de la richesse et du bonheur. » Sourire, bavarder, Marguerite ne l’a pas appris, et au pensionnat d’Etat où sa mère veut qu’elle fasse de bonnes études - « Je croyais en ma mère à l’égal de Dieu » - son arrogance, son accoutrement (casque colonial puis feutre d’homme, escarpins noirs vernis, robes sacs décolorées par les lessives) la séparent des autres.
Elle-même se décrit comme « petite et assez mal faite », « brûlée par le soleil » et le visage ingrat, taciturne et buté où traîne un « mauvais regard que ma mère qualifiait de venimeux. » Un Annamite, pourtant, s’intéresse à elle, le personnage de L’amant (1984). Laid et ridicule aux yeux de Marguerite, Léo a le chic pour s’habiller à l’européenne, il a vécu à Paris, et surtout il possède une magnifique voiture, une Morris Léon-Bollée. Son argent fait rêver la famille Donnadieu, qui cherche à en tirer le maximum de profit, bien que la mère interdise à sa fille de coucher avec Léo, ce qui la déclasserait irrémédiablement. « Je pensais qu’un jour je ne serais plus battue ni insultée, qu’on m’écouterait, que je serais belle et brillante, riche, que je ne circulerais que dans des limousines, que peut-être quelqu’un d’autre que Léo m’aimerait. »
Dans les cahiers suivants, préparatoires de La Douleur (1985), il s’agit principalement de l’attente angoissée, interminable, du retour de Robert Antelme, que Marguerite Duras a épousé en 1939. Résistant, il a été arrêté et déporté en 1944. A la fin de la guerre, partout en France, les femmes, les mères, comme elle, guettent un signe de vie des prisonniers. Les jours passent, sans information. Certaines jouent les courageuses, d’autres désespèrent, sans honte : « Les gens qui attendent avec dignité, je les méprise. Ma dignité attend aussi, comme le reste, elle a bien le temps de revenir, s’il est mort, ma dignité n’y pourra rien. » Même lire, Marguerite n’y arrive plus. « Je n’en peux plus. Je me dis : il va arriver quelque chose ce n’est pas possible. Je devrais raconter cette attente en parlant de moi à la troisième personne. Je n’existe plus à côté de cette attente. » Plus loin, « S’il meurt, la beauté du monde meurt et il fera nuit noire sur ma terre. »
Quand il réapparaît, Robert Antelme, qui écrira L’Espèce humaine, un des livres-clés de la littérature concentrationnaire, ne pèse plus que trente-huit kilos et ne supporte qu’un peu de bouillie. Après trois semaines de repos et de soins, il recommence à manger, et c’est tout le spectacle de sa digestion qu’elle décrit crûment, en détail, fascinée par les quantités dont il se remplit, dont il se vide, dans une lente et bouleversante reconstitution de soi.
Puis viendront des heures claires, près de l’enfant qu’elle a de Dionys Mascolo (avec qui elle vit après son divorce d'avec Antelme dont elle a eu un enfant mort-né). « Il a ri de nouveau et j’ai engouffré ma tête dans la capote de la voiture pour capter tout le bruit du rire. Du rire de mon enfant. » Dionys qui peut passer des heures à regarder la mer explique « que c’était à force de regarder un même spectacle, sans cesse renouvelé, qu’on arrivait à passer de la curiosité à l’intérêt, que c’était cela, voir. » C’est lui aussi qui la met au défi : « Un jour viendra où je répondrai à Dionys une phrase définitive. Cela fait quatre ans que je la cherche, mais je ne l’ai pas trouvée. » Duras est à la recherche de la phrase juste, cette phrase dont on dit aujourd’hui, « c’est du Duras ».
« On ne dit pas devant moi du mal de Duras » explique Dominique Autié sur son blog où j’ai emprunté la photo de Duras. Pourquoi cette photo ? Parce que ce soir-là, le 28 septembre 1984, j’étais sur un lit d’hôpital, en soins intensifs, et qu’une bonne fée fit en sorte qu’on m’amène dans mon box une télévision pour me distraire de la seconde nuit que je devais y passer. Je me souviendrai toujours de cette magie : Duras, seule invitée de Pivot pour Apostrophes, concentrée sur ses réponses, parlant de son œuvre, de l’art et de la mort. Il y a parfois du concret qui nous relie à un écrivain, comme le montre bien Pierre Assouline dans une note récente à propos du manteau de Proust.