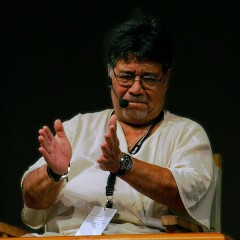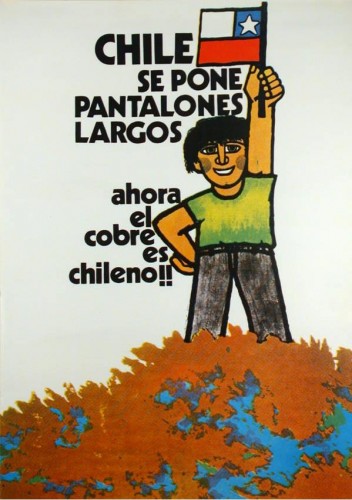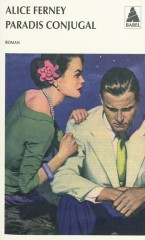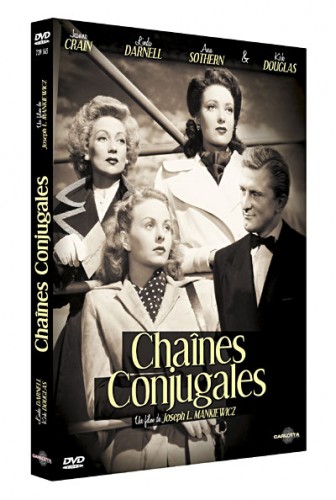Cristallisation secrète, un roman de Yoko Ogawa récemment traduit par Marie-Rose Makino, date de 1994. La romancière japonaise situe l’action sur une île, l’île des disparitions – « Je me demande de temps en temps ce qui a disparu de cette île en premier ». La narratrice, qui écrit des romans, ne peut se figurer l’époque d’avant sa naissance que lui décrivait sa mère, quand « il y avait des choses en abondance ici ». A chaque disparition, les choses s’effacent de la mémoire des insulaires au point que, très vite, leur nom même n’évoque plus rien pour eux. Sauf chez quelques-uns. Ainsi sa mère a longtemps caché dans les tiroirs d’une vieille commode un ruban, un grelot, une émeraude, un timbre, du parfum, qu'elle lui montrait en racontant leur usage autrefois.
Après avoir perdu sa mère, son père, puis sa nourrice, la jeune romancière a appris à vivre seule dans sa maison. Un matin, les oiseaux disparaissent. Tous ceux qui en possédaient chez eux ouvrent spontanément leurs cages et le lendemain, la police secrète débarque chez elle pour vider le bureau de son père ornithologue, éliminer toute trace de ce qui concerne les oiseaux. Dans sa vie, deux personnes comptent vraiment : le grand-père, un ancien mécanicien du ferry, le mari de la nourrice, qui réside à bord du vieux ferry rouillé amarré au port – il n’y a plus de ferry sur l’île depuis longtemps – et R, son éditeur, à qui elle montre régulièrement ce qu’elle écrit. C’est en se rendant chez lui qu’elle croise pour la troisième fois depuis le début du mois les traqueurs de souvenirs, ceux qui arrêtent les gens qui ont trop de mémoire, comme sa mère, emmenée il y a quinze ans. Ces policiers débusquent leurs cachettes, les repèrent même par « décryptage des gènes », selon la rumeur, et les embarquent on ne sait où dans des camions bâchés.
Son roman en cours conte l’histoire d’une dactylographe qui perd sa voix, enfermée dans une tour, emprisonnée par son amant. Un jour, la romancière reçoit la visite inattendue de la famille Inui : sa mère leur avait confié quelques-unes de ses sculptures ; comme ils craignent d’être arrêtés, ils les lui rapportent. Elle ne sait pas encore qu’elles possèdent un secret. Un autre jour, les roses disparaissent, leurs pétales jonchent la rivière. Quand elle court à la roseraie, elle découvre un cimetière
de tiges sans fleurs, le vent les a toutes emportées.
« … C’est sans doute parce que vous écrivez des romans que vous allez
trop loin, euh, comment dire, peut-être que vous pensez des choses un peu extravagantes ? » répond le grand-père quand la jeune femme s’inquiète du sort de l’île. Dans son roman en cours, la dactylo a perdu sa voix depuis trois mois. Dans sa vie, c’est l’avenir de R qui pose problème : il se souvient de tout, comme sa mère auparavant, or les traqueurs de souvenirs sont de plus en plus actifs et brutaux. Avec le grand-père du ferry, la romancière aménage une cachette dans le sous-sol de sa maison, à laquelle on n’accède que par une trappe dissimulée sous un tapis. R accepte avec reconnaissance de s’y cacher et sa femme enceinte retourne vivre chez ses parents.
Cristallisation secrète est un récit fantastique sur la mémoire et l’oubli, sur la résistance de quelques-uns au pouvoir totalitaire. Ce qui est troublant, c’est que les uns et les autres ne semblent pas choisir de se souvenir ou d’oublier, mais retiennent ou non la trace des choses en eux. Encouragés par l’éditeur, ses amis vont essayer de résister à l’érosion des souvenirs – « Vous croyez sans doute qu’à chaque disparition le souvenir s’efface, mais en réalité ce n’est pas cela. Il est seulement en train de flotter au fond d’une eau où la lumière n’arrive pas. C’est pourquoi
il suffit d’oser plonger la main au fond pour arriver peut-être à toucher quelque chose. Que l’on ramène à la lumière. C’est insupportable pour moi de regarder sans rien dire votre cœur s’épuiser. »
Mais de disparition en disparition, le trio est confronté aux aspects pratiques du secret et de la cohabitation – à la suite d’un tremblement de terre, le grand-père est venu les rejoindre –, à la pénurie qui s’installe peu à peu sur l’île, à la police secrète de plus en plus inquisitrice. Pourront-ils préserver cette vie solidaire et clandestine ? faire face
à la disparition des photographies ? des romans ? des corps mêmes ?
Yoko Ogawa, attentive aux gestes quotidiens, au concret, au langage des corps qui occupent une part essentielle dans son œuvre, prend place avec ce roman aux côtés des anti-utopistes (Huxley, Orwell, Bradbury). Son univers poétique éclaire de façon très délicate les liens qui se tissent entre les êtres, même au cœur d’un drame qui prive les personnages de leur passé et, peut-être bientôt, de leur avenir.