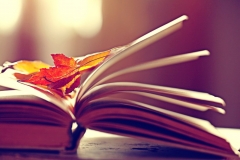C’est un roman court, concis. Me souvenant d’un billet à propos de son dernier livre sur Marque-Pages, j’ai posé la main à la bibliothèque sur Pas du tout mon genre d’Isabelle Spaak, le deuxième roman de cette journaliste et romancière belge, publié en 2006 sous une couverture mélo. (J’aurais pu intituler ce billet La seconde, mais ce serait trop glisser du côté de Colette. Voir plus loin.)

Gustave de Smet, Femme dans une chambre
Comme pour Ça ne se fait pas, son premier roman sur la mort de ses parents dans des circonstances peu communes, l’histoire familiale est une des sources de celui-ci. Il ne manque pas de personnages romanesques dans la famille Spaak. La narratrice commence par évoquer l’enfance, les vacances en famille – « A l’île de Ré, maman est joyeuse. Je ne me souviens pas d’elle aussi gaie. » Elle regarde des photos, cite en épigraphe des vers d’Apollinaire : « C’est la réalité des photos qui sont sur mon cœur que je veux » (Poèmes à Lou).
Ensuite, celle qui rêve de sentiments permanents se présente : « Je suis la seconde fille, la seconde épouse, le second violon. Je joue en sourdine une partie plus basse que le premier. » C’est par un printemps « d’une douceur inhabituelle » que la rancœur ressentie en l’absence de son amant la fait penser à Dominique Aury, plus douée qu’elle pour supporter que Paulhan passe ses vacances avec une autre (Histoire d’O.) Elle qui a horreur des cachotteries est tombée amoureuse d’un homme marié. Pas du tout son genre, en plus.
« J’ai vu ma mère mourir à petit feu, déchirée par la double vie de mon père. Que savait-elle de ces femmes silencieuses, suspendues aux cadrans des pendules ? » Les trois filles adoraient leur père, qui préférait la benjamine – « Nous étions folles de jalousie. » Il les filmait et les photographiait souvent, fabrique à souvenirs. Son amant aussi est un « obsessionnel de la photographie » et lui montre, sans délicatesse, ses photos de vacances.
Pas du tout mon genre passe du père à l’amant, de l’amant au père, du père à la mère, à l’enfance, aux grands-parents, du passé au présent douloureux d’une femme amoureuse et seule. Le roman est composé de fragments courts, d’une demi-page à deux pages, pas plus. Beaucoup de silences. Une façon de « laisser en suspens, d’offrir au lecteur la possibilité de ressentir les conséquences des situations et des phrases qui les disent », écrit Michel Zumkir (Promotion des lettres).
Isabelle Spaak y croise dans l’histoire littéraire d’autres discours amoureux, d’autres amoureuses de l’ombre. Toutes n’ont pas la patience d’une Juliette Drouet.
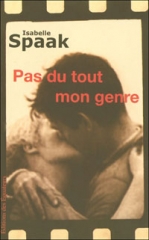 ile. Pas du tout mon genre. J’aime les regards sournois, les teints basanés, les sourcils épais, les esprits torturés, les muscles saillants, les êtres sans foi, ni parole.
ile. Pas du tout mon genre. J’aime les regards sournois, les teints basanés, les sourcils épais, les esprits torturés, les muscles saillants, les êtres sans foi, ni parole.