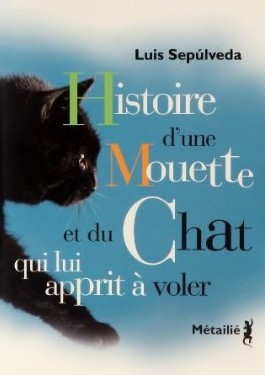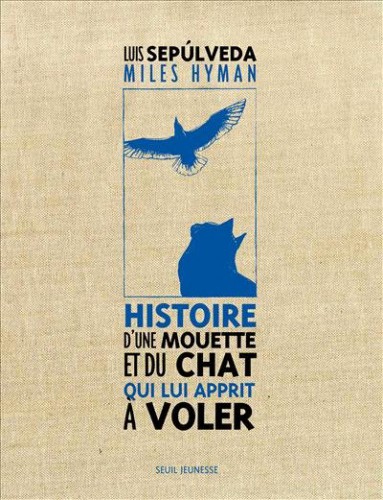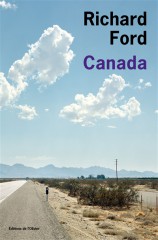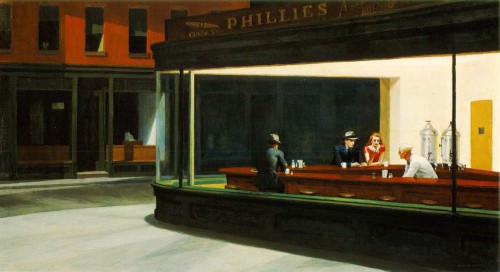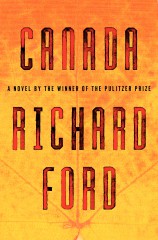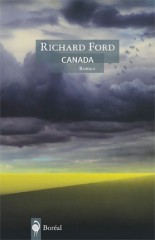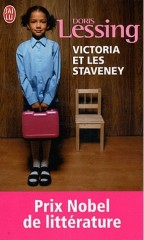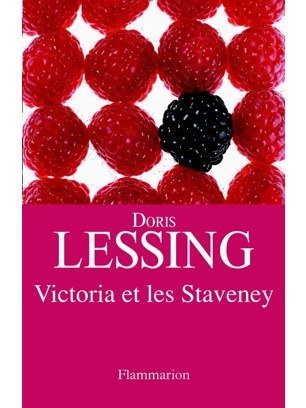C’est retrouver un peu de la magie d’enfance que d’ouvrir un livre illustré. Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler (1996, traduit de l’espagnol par A.M. Métailié) de Luis Sepúlveda est devenu un classique (traduit en 26 langues, Prix Versele, Prix Sorcières, entre autres). L’histoire a aussi inspiré un dessin animé. Les illustrations sont de Miles Hyman.
Excellent conteur, Sepúlveda nous emmène immédiatement en plein ciel, au milieu de mouettes fatiguées par six heures de vol et guettant les bateaux « à l’embouchure de l’Elbe dans la Mer du Nord » pour profiter de la pêche aux harengs et se refaire des forces. Kengah, « une mouette aux plumes argentées », plonge pour attraper un quatrième poisson et n’entend pas le cri d’alarme des autres. Elle se retrouve seule sur l’océan, prise au piège d’une vague noire et mortelle.
« J’ai beaucoup de peine de te laisser tout seul, dit l’enfant en caressant le dos du chat noir et gros. » Zorbas, à la fenêtre, aime beaucoup le garçon qui l’a recueilli après qu’il s’est échappé du panier « dans lequel il vivait avec ses sept frères », le seul chaton né tout noir avec une petite tache blanche sous le menton, et qui l’a sauvé de l’appétit d’un pélican dans le port de Hambourg.
« Pendant deux mois il allait être le seigneur et maître de l’appartement », visité tous les jours par un ami de la famille qui s’occuperait de sa nourriture et de la litière. « C’est ce que pensait Zorbas, le chat grand, noir et gros, car il ne savait pas encore ce qui allait lui tomber dessus très bientôt. »
Vous l’avez deviné, quand enfin Kengah réussit à quitter la nappe de pétrole poisseuse, elle sait qu’elle entame son dernier vol, et rassemble toutes ses forces pour arriver jusqu’à la terre ferme – c’est sur le balcon où Zorbas prend le frais qu’elle s’abat, sale, malodorante, épuisée. Le temps de lui expliquer qu’elle va pondre un œuf avant de mourir et de lui faire une triple demande : ne pas manger l’œuf, s’en occuper jusqu’à la naissance du poussin, et lui apprendre à voler. Zorbas promet, la mouette lâche un petit œuf blanc taché de bleu et pousse son dernier soupir.
Comment tenir cette promesse ? Zorbas aura besoin d’aide. Par le toit, il peut atteindre un marronnier, descendre dans la cour de l’immeuble et retrouver ses amis en prenant garde aux voitures, aux chiens vagabonds et aux chats voyous du voisinage. Nous allons donc faire la connaissance de ses amis, découvrir où ils vivent, comme Jesaitout, qui sait consulter l’encyclopédie, habite le Bazar du Port chez Harry, un vieux loup de mer, en compagnie de Matias le chimpanzé.
Zorbas s’est engagé, et nous allons le voir à l’œuvre, déployant mille ruses pour garder l’œuf au chaud et faire en sorte que son visiteur nourricier ne l’aperçoive pas, jusqu’à la naissance du poussin et aux autres problèmes qui en découlent – celui-ci ne veut pas de ses croquettes, par exemple. Je ne vous en dirai pas plus.
Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler est un conte plein d’aventures et de drôlerie, de quoi sourire tout du long. Sepúlveda y intègre des observations sur le comportement des humains, sur la vie en communauté, et des critiques sur les dérives du monde d’aujourd’hui. En adoptant le point de vue des chats, le romancier chilien offre ici une belle leçon de solidarité sans faire de morale, avec poésie et « humanité » féline.
Il l’a écrite pour consoler un peu ses enfants de la mort de leur chat, et pour ses petits-enfants, il a raconté récemment une autre vie de chat dans Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis, un nouvel hommage à l’amitié qui se joue des différences, d’après le billet de Lire & merveilles (rencontre avec Sepúlveda au Salon du Livre en 2013). Deux belles histoires à mettre entre toutes les mains.
***
P.-S. Une poule aussi rêve de voler, lui a-t-on raconté l’histoire de la mouette et du chat de Sepúlveda ?
Un lien envoyé par Colo, en espagnol, et un second, la présentation française du conte de Sun-mi Hwang (Corée) et du dessin animé qu’il a inspiré. (27/10/2014)