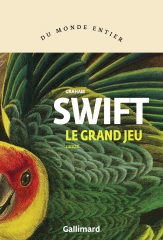Le dernier roman d’Agnès Desarthe, L’éternel fiancé, débute comme une romance d’enfance et se termine sur des larmes silencieuses, bien des années plus tard. Chaque fois que sa vie a croisé celle d’Etienne (le fiancé de toujours), la narratrice en a été bouleversée.

La première rencontre a lieu lorsqu’elle a quatre ans : les enfants de l’école maternelle vont au concert de Noël, dans la salle des mariages de la mairie. « Chez elle, il y a toujours de la musique. Elle est contente d’en entendre. Elle se récite les noms des compositeurs que sa maman et son papa aiment. Il y a Beethoven. Mais maman préfère Brahms. Il y a Schubert que papa adore, mais Lise, la grande sœur, veut toujours du Chopin. »
La mélodie s’élève quand soudain, le garçon devant elle se retourne et lui dit qu’il l’aime, parce qu’elle a les yeux ronds. Elle ne répond pas, la musique a commencé. Il insiste et pour le faire taire, elle rétorque : « Je ne t’aime pas. Parce que tu as les cheveux de travers. » Il pleure en silence, elle est sauvée. « Mais elle songe qu’ils sont à présent fiancés, à cause de la beauté de la musique ; officiellement fiancés, à cause de la salle des mariages. »
Les trois sœurs, Lise l’aînée à l’alto, Dora la cadette au violoncelle et elle au violon, comme son père, ont répété des années le Quatuor en mi bémol majeur de Fanny Hensel-Mendelssohn. Elles jouaient faux et mal, mais Lise, la meilleure des quatre, les reprenait. Leur famille n’était pas « comme tout le monde » mais cela ne les gênait pas : « Nous étions le monde et mon regard demeurait myope au reste de l’univers. » L’éternel fiancé raconte la vie de famille, l’école, la vie sans télévision ; un passé dont certains pans semblent avoir quitté la mémoire alors que d’autres s’y sont gravés avec précision.
Très vite, la voilà au lycée Gustave Courbet où elle reconnaît le garçon « intensément contemplatif » devant la fresque du hall, au rez-de-chaussée : « ses cheveux ne sont plus de travers ». Etienne est le frère de Martin Charvet, qui « capte la lumière » et réussit tout, « l’élu entre les élus », déjà en première. Elle l’adore, comme les autres, mais survient une grave maladie, l’hôpital, et elle doit redoubler la seconde. Fini le quatuor. Elle prend des cours de violon avec une dame qui répète « Eh ben, c’est pas brillant brillant » et lui conseille d’intégrer l’orchestre du lycée.
C’est à la répétition qu’elle revoit Etienne, à présent en première, qui ne la reconnaît pas. Elle s’émerveille de distinguer si clairement « toutes les voix » des instruments – « la sensation d’un tissage dont j’aurais été simultanément le fil et la trame ». Etienne tient une espèce de râpe à fromage et un peigne en métal, sorte de « güiro ». Elle le trouve changé, plus lumineux – grâce à l’amour d’Antonia, qu’il a rencontrée pendant qu’elle gisait à l’hôpital. « Antonia danse comme personne. » Elle joue de l’euphonium et l’a convaincu de rejoindre l’orchestre.
Etienne et Antonia deviennent le couple d’amoureux le plus admiré du lycée, un duo d’anticonformistes et lanceurs de modes. Tout le monde achète les bijoux qu’ils fabriquent pour les vendre aux terrasses des cafés. Le monde change. A la maison aussi, où la mère de la narratrice est tombée amoureuse du dentiste, son patron. Avec le temps, tout change. Elle-même sort à présent avec Martin, le grand frère, qui ne se doute de rien quand elle décide de l’accompagner à l’exposition d’Etienne et Antonia, pour le revoir, lui.
Il en ira ainsi d’année en année. A la sortie d’une soirée, elle qui s’est entretemps mariée (avec un autre) rencontre son « fiancé » avec un bébé dans les bras, désespéré parce que sa fille n’arrête jamais de pleurer. Etienne est en perdition. Avec la musique, un temps abandonnée, mais pas pour toujours (la chanson de France Gall m’a trotté en tête en lisant, d’où le titre de cette lecture), il reste l’autre obsession de la narratrice. Comme si sa vie à lui était plus réelle, plus fascinante, comme s’il s’inscrivait davantage dans le monde qu’elle.
L’éternel fiancé, « fausse autobiographie empreinte de merveilleux », conte une histoire douce-amère où l’on s’accorde et se désaccorde. Ce roman des sensations, des sentiments, des souvenirs épars est plein de changements de ton, de rêveries secrètes, d’images parfois floues parfois nettes, au fil d’une vie de femme. Agnès Desarthe y conjugue le récit d’une époque et une exploration de la mémoire intime.