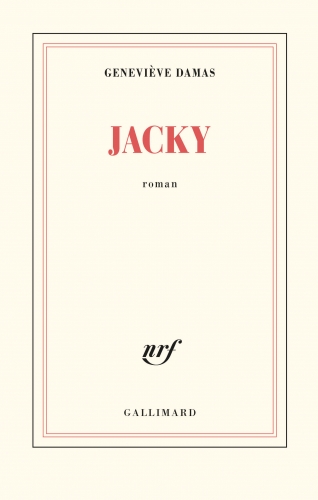Dans Crions, c’est le jour du fracas !, Héloïse Guay de Bellissen, qui sait écrire hors des sentiers battus (Dans le ventre du loup (à présent en Pocket), Le dernier inventeur), raconte avec force ce que peut l’esprit de rébellion à travers deux histoires vraies : celle de la bande dont elle a fait partie dans les années 90 et celle des adolescents du drame de 1866 dans un pénitencier pour mineurs de l’île du Levant, en face d’Hyères.

Les ruines du pénitencier sur l'île du Levant (Photo Var Matin)
La « meute de mômes » d’Héloïse, c’étaient « ceux de la Table » à La Seyne sur mer : fringues fluo, roller, joggings, pulls à capuche, Palladium aux pieds – « On avait une vie colorée et déjà des esprits contrôlés par les marques, la société de consommation nous ouvrait les bras. » Leurs parents avaient connu une société en pleine mutation après la Seconde Guerre mondiale, puis « les vagues de divorces » ont laissé de nombreuses mères au foyer « vraiment seules ».
« Alors pour nous, les adolescents, ce monde en mouvement qui ressemblait à un ouroboros signifiait clairement qu’il n’y avait pas de futur, même le mot n’existait pas à la Table. » La Table, c’est un banc de pierre circulaire où ils se retrouvaient, Rahan, Don, Seb’s, John et Yoko, Lisa, Romane, Rom’s et Grand Mika, au milieu d’un lotissement. « On détestait le monde entier et en même temps on voulait l’être, l’incarner et lui mettre le feu. »
Don et Seb’s les y rejoignent un jour après le cours d’histoire que les autres ont séché : « Eh bien, vous avez loupé un putain de cours ! » Les autres ne le croient pas, jusqu’à ce qu’ils leur rappellent leur visite à l’île du Levant l’année précédente : « Ces gamins-là, c’est nous ! Je vous jure ! Mais vous êtes trop cons pour le comprendre ! » Grand Mika récolte en retour une insulte qu’ils ne comprennent pas : « T’es qu’un Boule-de-neige, GROS Mika ! »
Boule-de-neige était le surnom du petit Léon Cazale à la colonie pénitentiaire. Avec sa sœur, ce gavroche amusait les passants sur les trottoirs toute la journée, pendant que leur mère « recevait » dans l’unique pièce de leur logement ; il volait des fruits, des fleurs à l’occasion et finit par se faire arrêter. Peu avant ses douze ans, il est envoyé en maison de correction sur l’île du Levant. Ce sera lui le narrateur de la vie au pénitencier, où on rééduque les gamins par le travail agricole et une discipline de fer.
Héloïse Guay de Bellissen reconstitue la vie de ces mineurs sur l’île du Levant et l’incendie de 1866 où treize d’entre eux ont péri, lors d’une révolte fomentée par Condurcer, seize ans, le chef des incendiaires. On découvre comment celui-ci a pris Boule-de-neige en grippe, le considérant par erreur comme un traître à sa cause. C’est Condurcer qui, le jour du drame, emmène les rebelles dans la réserve des cuisines et pousse le cri qui donne son titre au roman : « Enfants ! Crions ! C’est le jour du fracas ! »
L’alternance des deux récits est très réussie. La romancière raconte les années 1990 dans un langage argotique qui colle parfaitement à ces drôles d’oiseaux bien décidés à ne pas filer droit et à inventer leurs propres codes. Pour l’histoire du pénitencier, elle a opté pour un style classique et cite des extraits du dossier judiciaire. A nous de découvrir les points communs et les différences entre ces deux histoires qui se sont déroulées à plus d’un siècle de distance. Certains s’en sortent, d’autres pas.
Après le premier confinement, Héloïse Guay de Bellissen a eu envie d’écrire sur la période de sa vie où elle s’est sentie la plus libre. Crions, C’est le jour du fracas ! excelle à rendre la passion de la liberté et l’intransigeance de la jeunesse – on se souvient qu’elle a lu et relu Antigone – tout en montrant les impasses, souvent dramatiques, auxquelles peut mener la rébellion quand on n’arrive pas à trouver une voie possible pour exister.
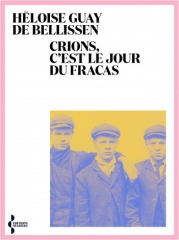 « Bon, bref, pour le rituel du feu de joie, l’initiation de Romuald avait été parfaitement réussie. Ça se passait à la plage, à quelques mètres à vol d’oiseau de la Table. C’était un moment extrêmement élaboré et que nous prenions très au sérieux. Enfin, c’est ce qu’on se disait, mais en fait ça ne l’était pas tant que ça. L’initié devait se rendre sur la plage, fringué comme son paternel et sa daronne en même temps. Par exemple, un chemisier de la mère et le pantalon du père. Nous allumions un feu sur le sable, ce qui était totalement interdit, et nous demandions à l’initié ceci :
« Bon, bref, pour le rituel du feu de joie, l’initiation de Romuald avait été parfaitement réussie. Ça se passait à la plage, à quelques mètres à vol d’oiseau de la Table. C’était un moment extrêmement élaboré et que nous prenions très au sérieux. Enfin, c’est ce qu’on se disait, mais en fait ça ne l’était pas tant que ça. L’initié devait se rendre sur la plage, fringué comme son paternel et sa daronne en même temps. Par exemple, un chemisier de la mère et le pantalon du père. Nous allumions un feu sur le sable, ce qui était totalement interdit, et nous demandions à l’initié ceci :